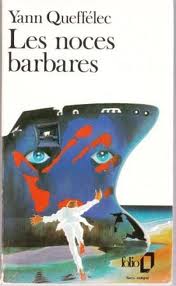
Roman de Yann Queffélec.
« À treize ans, bientôt quatorze, elle en paraissait dix-huit avec ce corps déjà mûr, cette bouche sanguine, ces yeux bleus en amande, et ces longs cheveux vermeils comme un feu sur les épaules. » (p. 13) D’être aussi jolie, la jeune Nicole Blanchard, fille des boulangers du village, devient la proie de trois militaires américains. De belles promesses en viol collectif, la vie de Nicole chavire et se brise à tout jamais. De cet épisode liminaire étourdissant de violence naît Ludovic, Ludo, un gamin qui ne cessera jamais de mendier l’amour de sa mère.
On rencontre Ludo après une ellipse de sept ans. L’enfant est cloîtré dans un grenier sordide et il guette les visites de sa mère. Légèrement idiot, il se sait banni, honni, vomi par une famille qui n’a pas voulu de lui. « Nicole avait refusé son lait ; le boulanger refusait son pain. » (p. 30) Quand Michel Bossard, dit Micho, propose d’épouser Nicole et d’assumer Ludo, un horizon se dévoile pour l’enfant. « Ce mignon qui n’avait pas de papa, avec une maman qu’osait pas l’aimer comme il faut, il a les deux maintenant. Et même un frangin. Tu vas m’appeler papa, mignon ! « (p. 61) Mais le gros bon cœur de Micho ne suffit pas à construire un foyer dans lequel Ludo et Nicole peuvent cohabiter et s’apprivoiser. Nicole voit en son fils l’incarnation de son malheur et, de haine dégoûtée en mépris sournois, elle n’a de cesse de repousser ce gamin affamé de tendresse et de reconnaissance. Ludo est envoyé dans un centre pour malades mentaux, mais il n’y trouve pas davantage sa place. C’est finalement sur un vieux cargo échoué et rongé de rouille qu’il créera son havre de paix, face à l’océan qui le fascine et dans l’attente inassouvie d’un geste de celle qui n’a jamais su être sa mère.
Ces noces barbares, c’est d’abord le viol que subit Nicole, enfant dans un corps menteur. Ludo, ensuite, sera un éternel enfant, rêvant de noces de sang avec sa mère. Ébloui d’amour, il trace sans les comprendre des dessins macabres : « son obsession favorite : un visage de femme entrevu par les doigts écartés d’une main noire. » (p. 116) Sans le savoir, il trace la ligne de son propre destin en « une allégorie du malheur : la main comme une gifle au néant, les cheveux laqués rouges pareils à du vrai sang. » (p. 204)
Ludo le mal-aimé débite un monologue muet, un souffle intérieur sans ponctuation dans lequel il rassemble ses sentiments et ses peines. Son cri silencieux est un aveu d’amour à l’indifférence incarnée. « Il écrivait à sa mère, mais n’envoyait plus les lettres. Il avait détourné son cahier de catéchisme à cet usage : journal de bord sans date où, s’adressant des réponses imaginaires, il prenait livraison des sentiments qu’on lui refusait. […] La réalité semblait courir à son rythme, il entendait en lui battre des mots qu’il s’interdisait d’écouter : on l’abandonnait. Dans ses mains calleuses, il contemplait cette évidence : on l’abandonnait. Dans ses yeux il voyait sa mère absente, il fuyait les miroirs, il fuyait sa mémoire, et vaincu fuyait ce dont il était sûr depuis sa naissance : on l’abandonnait. » (p. 257)
La détresse de ce gamin qui pousse au hasard du malheur est puissamment mise en mots par Queffélec. J’avais lu ce texte vers mes douze ans et l’impression bouleversante n’est jamais passée. Le reprendre aujourd’hui, c’est retrouver la même émotion et la même haine impuissante face à la figure maternelle. Prix Goncourt en 1985 (décidément une année exceptionnelle !), ce roman ne fane pas. Intemporel, il chante pour toujours la douleur des enfants orphelins d’amour.
