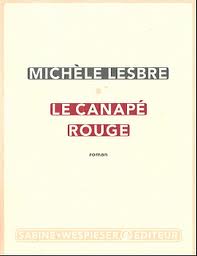
Anne a pris le transsibérien pour retrouver Gyl dont elle est sans nouvelles depuis longtemps. De cet ancien amour, il reste surtout l’habitude du souvenir. « J’étais portée par le désir, un désir que mon inquiétude à propos de Gyl attisait de jour en jour. » (p. 21) Sur les bords du lac Baïkal, c’est une rencontre manquée, mais le voyage à lui seul est une rencontre, celle qu’Anne fait avec elle-même. Partie après un homme, Anne revient plus riche qu’elle ne l’espérait, pénétrée de la vraie sagesse du voyage : « Je savais que le véritable voyage se fait au retour, quand il inonde les jours d’après au point de donner cette sensation prolongée d’égarement d’un temps à l’autre, d’un espace à l’autre. » (p. 16)
À Paris où elles vivent toutes les deux, Anne a l’habitude de rendre visite à sa voisine, une vieille dame au regard de petite fille. Clémence Barrot, superbe sur son canapé rouge, lui confie les secrets de son cœur et écoute avec avidité les portraits de femme qu’Anne partage avec elle. « Elle me plaisait beaucoup cette petite femme qui résistait si bien à la vieillesse et à tout ce qui peut en faire un désastre permanent. » (p. 85) Clémence a fait de la vie une expérience de joie, mais elle a gardé dans un coin du cœur un deuil toujours vivace. Cette douleur, Anne la comprend et les deux femmes, sans jamais la nommer ni même en parler, évoquent la difficulté de faire le deuil de l’amour. « Je pourrais tout à fait renoncer à un pays si l’homme avec qui je l’avais visité venait à disparaître. » (p. 59) Ainsi parle Anne, avec un désespoir tranquille.
L’amitié nouée entre Anne, la cinquantaine passée, et Clémence dont la mémoire s’envole progressivement est une merveille qui se réinvente à chaque rencontre. Qu’importe de répéter sans cesse les histoires du passé puisqu’elles sont si belles. En compagnie de Jankélévitch, Tolstoï ou Tarkovski, mais aussi d’Olympe de Gouges ou de Marion du Faouët, le lecteur assiste au voyage d’Anne qui avait la solitude pour tout bagage et qui revient avec la liberté que confère l’acceptation des peines. Le récit de voyage que fait Anne se décline en toute délicatesse et avec une grande poésie. L’intertextualité si souvent convoquée donne de l’écho à ce texte et on voudrait pouvoir couper dans l’épaisseur les pages d’un roman qui, humblement, dépose la lourde douceur des mots comme un baume sur les âmes errantes. Ainsi lestées, peut-être qu’elles seraient apaisées.
Déjà vivement émue par Un lac immense et blanc, j’ai été renversée par Le canapé rouge, et même suffoquée. L’impression que ce roman a produite sur moi est tout d’abord physique, profondément animale et sensible. L’intériorisation viendra plus tard : pour le moment, je respire au rythme des mots troublants de Michèle Lesbre. Madame, de tout cœur, merci.
