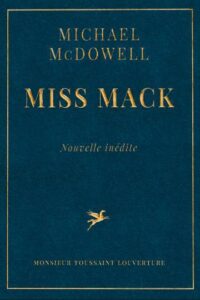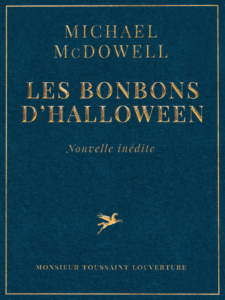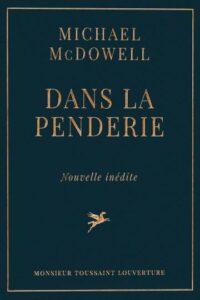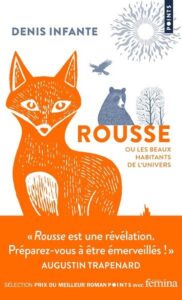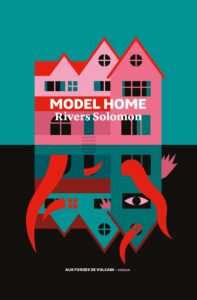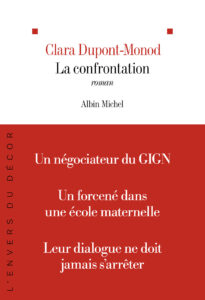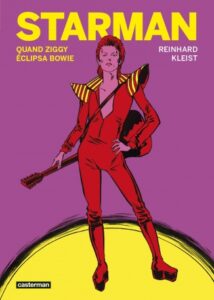Essai de Célia Sauvage.
Quand on pense « dessin animé », et surtout « dessin animé Disney ou Pixar », la première idée est qu’il s’agit d’une œuvre qui porte des valeurs familiales, rassurantes et inoffensives. Après tout, Disney, c’est l’univers de la magie et du divertissement : en quoi ce studio, machine à cash déclinée en multiples entreprises, pourrait-il être problématique ? C’est finalement assez simple à comprendre : la culture populaire véhicule des messages forts, des clichés et des représentations. Et s’il y a bien un studio d’Hollywood qui nourrit cette culture, c’est Disney-Pixar !
Ce que propose l’essayiste Célia Sauvage, c’est de faire un pas de côté et de poser nos lunettes teintées de nostalgie pour regarder autrement les films produits par Disney et/ou Pixar. « Il leur est difficile d’associer une dimension critique à un divertissement jugé familial et innocent. Les films d’animation convoquent par ailleurs des souvenirs souvent très personnels, très précieux. Critiquer un film Disney-Pixar, c’est critiquer une partie de soi, une partie de nous. C’est exposer au grand jour la mort de son âme d’enfant et faire preuve d’un sérieux bien trop adulte. » (p. 20) Dès que l’on consent à cet effort, il n’est pas difficile de voir le discours hétéronormatif, les stéréotypes de genre, la grossophobie, la perfection hégémonique des corps blancs, la masculinité toxique et la féminité passive, la culture du viol, l’exclusion ou les humiliations faites aux minorités queers, l’impérialisme et l’assimilation forcée des peuples premiers ou indigènes, l’handiphobie et le validisme, etc., etc. Cette liste interminable fait froid dans le dos, mais tout n’est pas perdu, car il y a toujours eu de la transgression dans les œuvres de Disney et Pixar : encore faut-il savoir la repérer… « Apprendre à décoder ce cinéma, c’est apprendre à s’outiller pour développer un autre regard, parfois subversif. Il faut accepter de voir au-delà des représentations problématiques pour décoder des lectures à contre-courant des critiques devenues connues de tou·tes. » (p. 390)
Dans son essai, l’autrice parle aussi de l’histoire des États-Unis et des événements qui expliquent certains choix de Disney : le code Hayes, les lois Jim Crow, le syndicalisme, le maccarthysme, l’opposition à la guerre du Vietnam ou encore le contrôle incessant sur le corps des femmes, par les régimes ou le fitness. « Les hommes puissants disposent du privilège d’être gros, mais pas les femmes. Les princesses ne mangent jamais. » (p. 49) Le monde évolue, et les récits du studio d’animation tout autant. À mesure de ses nouveaux films, Disney progresse et propose de nouveaux modèles en déconstruisant les clichés et en donnant à voir la diversité sociale, mais rien n’est gagné ni jamais définitivement acquis. Il y a de nouvelles façons de faire famille ou encore une célébration de l’amitié en tant que relation qui n’est pas un pis-aller à l’amour. Les histoires se veulent plus inclusives, moins figées, plus en phase avec le monde dans lequel elles s’inscrivent. « Politiser le cinéma d’animation, c’est aussi politiser notre rapport au jeune public. » (p. 391) Déconstruire notre regard et revoir notre paysage mental, c’est faire de nous de meilleur·es adultes pour nous, nos contemporains et les générations à venir.
J’ai lu avec passion cet ouvrage très bien écrit et très documenté. Il m’a replongée dans mes souvenirs et donné envie de revoir tous ces films que j’aime tant, avec des yeux neufs. Cette lecture me rappelle, en un sens, l’ouvrage de Lou Lubie, Et à la fin, ils meurent. Contes de fées et Disney, même combat : on ne va pas laisser les oppressions du passé définir nos comportements présents et futurs !