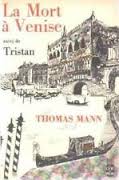
La mort à Venise – Gustav d’Aschenbach est un écrivain renommé à la réputation sans tache. Il est soudain pris de lassitude envers Munich et d’une folle envie de voyager, « mais à vrai dire une envie passionnée, le prenant en coup de foudre, et s’exaltant jusqu’à l’hallucination. » (p. 38) Il décide de revoir Venise, une ville qui l’a toujours séduit et réjoui, bien qu’il n’en ait jamais supporté le climat. Mais il n’a que la cité lacustre à l’esprit : c’est là que son besoin de dépaysement sera comblé. « Une paresse enchaînait l’esprit d’Aschenbach, pendant que ses sens goûtaient la formidable et étourdissante société du calme marin. » (p. 73) Installé dans son hôtel du Lido, il rencontre un jeune Polonais en villégiature avec sa mère et ses sœurs. L’enfant est blond, un peu maladif et d’une beauté éblouissante. La fascination d’Aschenbach va grandissant, entre émerveillement et honte. Peut-il rester à Venise ? Ne devrait-il pas partir pour échapper à l’emprise que ce garçon a sur son cœur et au malaise que le climat vénitien fait naître en lui ? « Ce qui était si pénible à admettre, ce qui par moment lui paraissait absolument intolérable, c’était manifestement la pensée qu’il ne devait jamais revoir Venise et que ce départ était un adieu définitif. » (p. 79) Entre élans freinés et départs manqués, le voyage d’Aschenbach est un périple d’opérette à la fin dramatique quand le choléra se déclare en ville.
Les premières pages de ce court roman m’ont laissée perplexe, mais la rencontre avec le jeune Tadzio a tout mis en place. L’insupportable épisode du vieux beau sur le bateau a pris toute sa dimension, répété et amplifié, voire déformé en la personne d’Aschenbach. La jouissance de la beauté juvénile n’a finalement d’égale que la cruauté du temps qui s’enfuit. Mourir à Venise, c’est bien beau, mais c’est toujours mourir.
Tristan – Spinell, écrivain au succès médiocre, séjourne dans le sanatorium Einfried quand arrive la jeune Mme Klötergahn qui souffre des bronches. Immédiatement, l’écrivain est fasciné par la belle créature, au point d’en faire un portrait magnifié que vient entacher sa condition d’épouse et de mère. Spinelle est pris d’un ressentiment terrible envers l’époux qui a, selon lui, souillé la jeune femme. « Croyez, Monsieur, que je vous hais, vous et votre enfant, comme je hais la vie banale, ridicule et cependant triomphante, que vous représentez et qui est l’éternelle antithèse et l’ennemie de la beauté. » (p. 171) Pour Spinell, il n’y a pas que la mort qui sied à la charmante malade.
Cynisme puissance mille ! Spinell m’a fait l’effet d’un vilain génie ou d’un lutin tordu à l’esprit contrefait qui prend plaisir à insuffler des pensées macabres dans l’esprit des créatures fragiles. Très court, ce texte est d’excellente facture !
