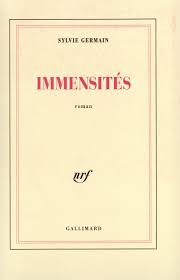
À Prague, au gré de purges, Prokop Poupa est passé d’homme de lettres à homme de ménage. Peu sociable et ravi de rester dans son tout petit appartement, Prokop est surtout heureux dans ses toilettes, minuscule réduit dont il est le dieu tutélaire. « Depuis toujours en effet, Prokop aimait user de ses toilettes comme d’un isoloir et d’un cabinet de lecture. » (p. 21) Mais il est impossible de prétendre vivre si on ne sort pas de ses limites. Tout change quand son jeune fils quitte Prague pour l’Angleterre avec sa seconde épouse. La solitude et le sentiment d’abandon croissent. Prokop évoque alors les figures féminines qui n’ont fait que passer dans sa vie, le laissant toujours plus seul et désespéré : sa mère infatigable jusqu’au bout, sa sœur morte par amour, sa première épouse délaissée et sa deuxième femme qui lui a brisé le cœur. « On ne meurt pas si souvent de ses chagrins, de ses deuils, de ses échecs ou de ses hontes. On ne meurt jamais au moment voulu. On se relève en ahanant, un peu plus vieux et plus pesant, et on perdure tant bien que mal ; on ruse comme on peut pour redresser son cœur tout de guingois. Et on se dit que ça ira à défaut de pouvoir déclarer que ça va. On conjugue le présent au futur indéfini. » (p. 30) Avant de partir, son fils lui a offert la lune et Prokop contemple l’astre nocturne, l’interrogeant et cherchant la réponse à sa solitude. Il a des révélations esthétiques et mystiques, mais se découvre finalement non croyant, privé du réconfort de la foi et de la religion. « Prokop avait le cœur étale et l’âme pétrifiée par l’absence de Dieu. Pire que l’absence – l’inexistence. La grosse calebasse prokopienne sonnait le creux, sentait le fade et le moisi. […] Il y eut même des soirs où l’acidité de sa solitude se fit si aiguë qu’il eut la sensation de mordre dans la mort, de mâcher du néant. » (p. 125 et 126)
Il y a de sublimes pages sur le supplice du Christ et la valeur des larmes. Sylvie Germain parle avec talent et tendresse des esseulés, des perdus et des tristes qui sont violemment confrontés à l’immensité du monde et de l’existence. « L’immensité est si vivement enclose en notre finitude, ses houles y sont si fortes, et si lancinants les chants montés de ses confins, qu’il nous faut bien, vaille que vaille, lui faire en nous une place, lui accorder quelque attention. Cette immensité qui gémit sous le poids de notre paresse d’esprit, de notre avarice de cœur, qui mugit à l’étroit dans notre finitude, est peut-être un appel vers plus qu’elle-même encore, une invitation pour des dérives à l’infini, du côté de l’éternité, par-delà les ténèbres. Il se peut. Quoi qu’il en soit viendra un jour où cette immensité brisera en nous ses amarres et nous emportera. Peu importe la destination, Dieu ou néant ; c’en est assez que les amarres soient vouées à se rompre. » (p. 135)
Avec deux récits enchâssés, Immensités n’en finit pas de s’étendre et de se déployer. On croise une jeune fille adorée et un chien, fidèle compagnon de toute une vie. Du réalisme magique à l’absurde, en passant par l’essai métaphysique et le conte philosophique, Sylvie Germain offre ici un très court roman bien plus grand qu’il n’y paraît.
