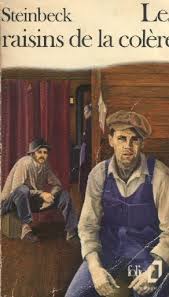
La sécheresse s’est abattue sur certains états américains du sud et du centre. Les pluies de sable et la poussière étouffent la terre et plus rien ne pousse. Les petits fermiers s’endettent pour faire vivre leur famille. Peu à peu, leurs terres sont rachetées par les banques et les consortiums. « Les grandes compagnies ne savaient pas que le fil est mince qui sépare la faim de la colère. » (p. 398) C’est la fin des petits domaines, la naissance des propriétés qui s’étendent à perte de vue et la toute-puissance du tracteur aveugle. Alors, des familles entières partent sur les routes, abandonnant maison et possessions pour un nouvel Eldorado. « Dans leurs petites maisons, les métayers triaient leurs affaires et les affaires de leurs pères et de leurs grands-pères. Ils choisissaient ce qu’ils emporteraient avec eux dans l’Ouest. Ces hommes étaient impitoyables parce qu’ils savaient que le passé avait été souillé, mais les femmes savaient que le passé se rappellerait à eux à grands cris dans les jours à venir. » (p. 123)
Quand Tom Joad sort de prison, il trouve sa famille sur le départ. La terre qui se transmettait de génération en génération ne produit plus et de toute façon, elle n’est plus à eux. La famille Joad se dirige vers la Californie où, paraît-il, on embauche chaque jour des milliers de personnes pour cueillir les oranges et les pêches. Tous les biens sont entassés dans une voiture bricolée en camion et tous, des plus vieux aux plus jeunes, s’entassent sur le véhicule, vers un Ouest prometteur et fantasmé. « La 66 est la route des réfugiés, de ceux qui fuient le sable et les terres réduites, le tonnerre des tracteurs, les propriétés rognées, la lente invasion du désert vers le nord, les tornades qui hurlent à travers le Texas, les inondations qui ne fertilisent pas la terre et détruisent le peu de richesses qu’on pourrait y trouver. » (p. 167) Mais avant d’atteindre la Californie, la route est longue et semée de difficultés. Des membres de la famille Joad disparaissent et l’issue du voyage semble de plus en plus incertaine au gré des rencontres. Il paraît qu’ils sont déjà des millions à avoir déferlé dans les plaines vertes de la Californie, qu’ils sont mal reçus et mal payés. La main d’œuvre est plus abondante que l’ouvrage et les exploitants diminuent les salaires chaque jour. « Alors, faut prendre ce qu’on veut vous donner, hein ? Ou crever de faim, et si on rouspète, on crève de faim ? » (p. 344) C’est une autre sorte de sécheresse qui attend les Joad, loin de chez eux, et tout ira de mal en pis.
John Steinbeck dépeint avec un talent immense la cruauté de la machine qui renverse les maisons et qui laboure les cours des fermes, mais aussi l’impensable catastrophe humaine, sociale et démographique que représente cet exode, cette ruée vers l’or sucré des vergers de Californie. « C’est pour ça que les gens se déplacent toujours. Ils se déplacent parce qu’ils veulent quelque chose de meilleur que ce qu’ils ont. Et c’est le seul moyen de l’avoir. Du moment qu’ils en veulent et qu’ils en ont besoin, ils iront le chercher. » (p. 179) Le chômage explose, les migrants s’installent dans des campements sordides qui sont régulièrement détruits par les autorités, les velléités de rébellion et toutes les manifestations plus ou moins communistes sont violemment réprimées. « Ils distribuent l’ouvrage aux enchères, c’est pas compliqué. Ils vont bientôt nous faire payer pour travailler, sacré nom de Dieu ! » (p. 471) Face à des propriétaires arrogants qui règnent sur des domaines immenses sans jamais en toucher la terre, il y a des petits fermiers qui ne demandent qu’à travailler pour nourrir leur famille. L’angoisse de la faim et la fatigue du voyage sont les ferments de la colère. « Ils tâchent à nous démolir le moral. Ils voudraient nous voir ramper et faire le chien couchant. Ils voudraient nous réduire. Sacré bon Dieu ! mais voyons, Man, il arrive un moment où la seule façon pour un homme de garder sa dignité, c’est de casser la gueule à un flic. » (p. 388)
Le personnage de la mère est admirable : cette femme prend les rênes de l’expédition et de la famille en lieu et place du père qui était tout-puissant dans la ferme, mais se trouve démuni sur la route. La mère fait tout pour garder les siens unis avec un cœur ouvert et généreux. « C’est pas de la faute des gens. […] Ça vous plairait, à vous, de vendre votre lit pour pouvoir faire votre plein d’essence ? » (p. 178) Son courage est structurant, pragmatique et sa colère n’en est que plus amère devant la faim qui tord le ventre de ses enfants. « Comment vivre sans nos vies ? Comment pourrons-nous savoir que c’est nous, sans notre passé ? Non faut le laisser. Brûle-le. » (p. 126) Celle de Tom est plus bouillonnante et cherche un moyen d’exploser. Tom qui sort de prison pour meurtre est hanté par cet acte et même s’il ne veut que rester tranquille auprès des siens, il est comme marqué par un déterminisme sinistre : il a tué, donc il tuera. Et la scène finale est une sublime image de Madone, un espoir au milieu de la fin du monde.
Cette longue odyssée vers le rien et la mort est une œuvre monumentale et magnifique, un texte qui me marquera pour longtemps. J’avais énormément apprécié À l’est d’Éden et c’est avec plaisir que j’ai retrouvé dans Les raisins de la colère la scène qui m’avait le plus touchée dans La grande vallée, celle d’un petit déjeuner offert sans contrepartie. Il me reste à voir le film de John Ford et à poursuivre ma lecture de tous les textes de John Steinbeck.
