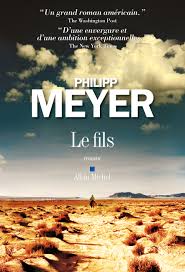
Eli McCullough est né en 1836 au Texas. Enfant, il assiste au massacre des siens par les Indiens et est emmené en captivité. Pendant des années, il vit avec les Comanches et adopte leurs mœurs. « Le seul problème, c’était de garder son scalp. » (p. 10) De retour parmi les Blancs, il devient Ranger, s’enrichit considérablement grâce au bétail et se fait connaître sous le surnom de Colonel.
En 1915, son fils, Peter McCullough, ne se pardonne pas le meurtre de la famille Garcia dont les siens sont responsables. « Je me demande su je suis en train de devenir fou ou si je n’aime pas assez ma famille ou si, au contraire, je l’aime trop. S’il n’y a que moi ici qui sois sain d’esprit. » (p. 94) Les rivalités entre les Texans et les Mexicains sont de plus en plus fortes, mais Peter refuse d’y prendre part, contrairement à ses fils.
En 2012, Jeannie, la petite-fille du Colonel, git sur le sol. Cette vieille femme se remémore sa jeunesse intrépide et comment elle a sauvé le ranch de la faillite en exploitant les gisements pétroliers. Elle se souvient de ceux qu’elle a aimés et perdus. Dépositaire d’un héritage considérable, elle ne sait pas à qui elle peut le léguer.
Le texte se compose du récit entremêlé de trois générations. J’aurais préféré suivre chaque personnage individuellement, chronologiquement et jusqu’à la fin de son histoire. Le découpage fait sens avec les révélations finales qui, si elles ne sont pas retentissantes, justifient le suspense mis en œuvre. J’ai de loin préféré le récit d’Eli, sa captivité chez les Indiens et la légende qui l’entoure au fil des années. « Critiquer le Colonel, c’est comme critiquer Dieu, ou la pluie, ou les Blancs, bref, tout ce qu’il y a de bien sur terre. » (p. 205) Le journal de Peter McCullough n’est pas inintéressant, mais je n’ai pas été sensible au ton volontiers geignard du personnage. Quant au récit de Jeannie, c’est lui que le découpage dessert le plus, car il empêche de vraiment s’attacher à cette femme indépendante et volontaire.
Il y a quelques très beaux passages sur le mode de vie des Comanches, entre dépeçage de bisons et vol de chevaux. La violence est omniprésente dans ce roman : sa motivation est la lutte pour les territoires, entre les Blancs et les Indiens, puis entre les Texans et les Mexicains. L’ironie est puissante puisque les mêmes schémas se répètent à chaque génération : seul change l’antagoniste. « Ils croyaient que personne n’avait le droit de leur prendre ce qu’eux-mêmes avaient volé. Mais c’était pareil pour tout le monde : chacun s’estimait le propriétaire légitime de ce qu’il avait pris à d’autres. » (p. 625) Les échos des deux guerres mondiales se font entendre au fil du récit, avec des conséquences plus ou moins douloureuses pour les McCullough. Même si ce roman ne m’a pas entièrement convaincue, je garde une belle image de cette famille de pionniers américains dont l’histoire est faite de la pierre dans laquelle on sculpte les légendes. « Ne volez pas les McCullough, ils vous tueront ; ne les calomniez pas, ils vous tueront aussi. […] Les gens nous voient comme des êtres à part. S’ils se rendaient compte que nous sommes faits de chair et de sang, tout comme eux, ils nous pourchasseraient avec des fourches et des torches. Ou, plus exactement, avec des pieux et de l’eau bénite. » (p. 251)
