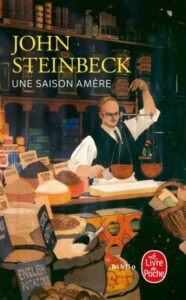
Roman de John Steinbeck.
La famille d’Ethan Allen Hawley possédait autrefois une grande partie de la ville de New Baytown. Désormais, Ethan est commis dans l’épicerie qui appartenait à son père. Son épouse Mary et ses enfants Allen et Ellen savent plus ou moins subtilement lui reprocher leur pauvreté et la perte de leur niveau social. « L’argent effacerait les sourires méprisants sur les visages de tous ces affreux bêcheurs. / Personne ne méprise les Hawleys. / C’est ce que tu crois ! Tu ne le vois pas, c’est tout. / Peut-être parce que je ne cherche pas à le voir. » (p. 50) Alors, et bien qu’il s’enorgueillisse d’être un homme de valeur, Ethan met en place un plan retors pour rendre aux siens le confort matériel dont ils rêvent. Du week-end de Pâques au week-end du 4 juillet de l’année 1960 se noue un drame patient aux conséquences nombreuses.
Difficile de trop en dire sans détailler le plan complexe d’Ethan. « Je voudrais bien connaître le secret des affaires. / Je peux vous dire tout ce que je sais en une phrase. L’argent attire l’argent. / Voilà qui ne m’aide pas beaucoup. » (p. 77) Tout commence avec un tirage de tarots, s’agrémente d’une proposition de pot de vin et d’un héritage de 5 000 dollars, et repose sur un projet plus ou moins secret porté par la municipalité. Si Ethan met de côté ses principes, allant jusqu’à envisager le pire, il ne peut se départir d’un remords profond. « Et si j’oubliais les règles un moment, je savais que j’en conserverais des cicatrices, mais celles-ci seraient-elles pires que les stigmates de l’échec que je portais ? Être vivant, de toute façon, c’est avoir des cicatrices. » (p. 122) Dans les monologues qu’il adresse aux objets ou aux disparus, il pèse le bien-fondé de sa démarche tout en repoussant les avances de Margie Young-Hunt. « Dans les affaires comme en politique, un homme doit tailler son chemin à grands coups de machette à travers la foule pour devenir Roi de la Montagne. Une fois arrivé là-haut, il se montrer grand et magnanime, mais il doit d’abord arriver là-haut. » (p. 198)
J’avoue ne pas comprendre pourquoi la narration passe en un chapitre de la troisième à la première personne, mais j’ai apprécié ce roman qui ne ressemble pas aux Raisins de la colère ou À l’est d’Eden. John Steinbeck démontre une nouvelle fois à quel point il aime dépeindre les petites gens et leurs tourments moraux. S’il le fait ici avec un cynisme nouveau, ce dernier reste imprégné de tendresse et de commisération. À l’instar d’Hamlet qui ne sait pas s’il doit vraiment embrasser le destin qu’on lui a tracé, Ethan s’engage avec réticence sur le chemin escarpé de la richesse et rien n’assure qu’il atteindra sa destination. Un grand roman très humain, comme toujours avec Steinbeck.
