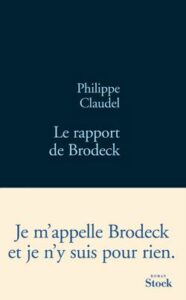
Roman de Philippe Claudel, Goncourt des Lycéens 2007.
Un de mes professeurs a proposé en examen de fin de semestre d’écrire une critique d’un des livres parus à la rentrée littéraire. J’ai choisi le superbe texte de Philippe Claudel, Le Rapport de Brodeck, en rendant également compte de la rencontre entre l’auteur et le public à la Librairie du Square de Grenoble. En voici ma critique.
*****
Le Rapport de Brodeck, une tentative d’exploration
Il y a des choses explicables et d’autres qu’il ne faut pas expliquer. Quand on me demande ce que signifie l’histoire des renards, je dis – et on ne me croit jamais – que j’ai été très influencé par Rox et Rouky.
Rencontrer Philippe Claudel, c’est se maudire de ne s’être pas équipée d’un magnétophone. Brièvement présenté, il fait entendre sa voix, lit la première page. Je m’appelle Brodeck et je n’y suis pour rien. Claudel non plus n’y est pour rien. Il le dit humblement, le sourire aux lèvres : Je pense très peu. […] J’avance comme un lecteur sans réfléchir. […] J’écris des romans de manière presque automatique, au sens surréaliste du terme. […] Ça se termine comme ça doit se terminer. Surréaliste, Philippe Claudel ? Certes non, mais son œuvre ne manque pas d’explorer les contrées littéraires les plus diverses, tout en niant s’y aventurer : Je ne suis pas avocat. Je ne suis pas policier. Je ne suis pas conteur.
L’auteur a préféré le terme de rapport à celui de confession. Le rapport, c’est la langue administrative du fonctionnaire qui enquête sur la faune et la flore sans savoir si ses textes seront lus. Le rapport, c’est la langue de la solitude, qui reconstitue les faits sans interprétation. Brodeck-Claudel tire le texte vers la langue humaine, vers le texte intime qui parle de soi puisque « le mot peut permettre d’aller dans la douleur, de la dire, de l’apaiser ». C’est le texte du survivant, de celui qui revient du Kaserskwir – le cratère. Claudel évite l’écueil de la littérature des camps avec une habileté qui ne se dément pas depuis Les Ames Grises. Il n’a pas voulu nommer le village afin de le « situer dans une aire géographique, mais [sans] donner de localisation trop précise […] dans une volonté quasiment fantastique de saboter le réel […] pour effacer les repères historiques et géographiques […] pour que le lecteur prenne ce qu’il y a de parabole dans l’histoire. Le Rapport de Brodeck, [c’est] fondamentalement un roman qui parlerait d’aujourd’hui ». On goûte alors au récit parabolique : ce sont les animaux qui sont les vrais innocents de ce roman. Si tous les hommes sont coupables, si chacun a commis un crime, il ne reste que les bêtes pour renouer avec l’humanité. Les papillons luttent pour leur survie : les hommes aussi ; les renards disparaissent massivement: les hommes aussi. Alors la potentialité humaine qu’on a tous de vouloir détruire l’autre est peut-être désespérément naturelle. Brodeck le comprend. « Le camp m’a appris ce paradoxe : l’homme est grand, mais nous ne sommes jamais à la hauteur de nous-même. Cette impossibilité est inhérente à notre nature« .
Le Rapport de Brodeck, c’est aussi un conte. La nature y fait figure d’univers : les mares s’étendent, les combes dissimulent des secrets. Claudel sourit : « ce pourrait être un roman de la montagne« : les Vosges près desquelles il a grandi, et parce que les montagnes de Brodeck sont l’endroit le plus proche du ciel et paradoxalement le moins pur. Conte de l’errance : Brodeck, privé de patrie, met longtemps avant de trouver son pays, pays qui le rejettera. Derrière le personnage, il y a toujours Claudel : « le chez-soi devenait le roman », confie-t-il. L’auteur voyage beaucoup, et au fil de ses déplacements, il prend conscience que « c’était presque une maison ce livre ». Fable des confins, maison de pain d’épices, maison en papier, le conte s’invite dans le réel. Brodeck est aussi une voix qui tisse des légendes du fond des temps : il est Orphée revenu des Enfers, guidée par Emélia, sa muette Eurydice. Comme dans les récits initiatiques, Claudel met « les femmes au centre dans la mesure où ce sont elles qui étoilent les hommes, qui les guident. L’auteur le revendique, [s]a littérature est tragique, mais jamais pessimiste » : elle montre « comment une humanité peut s’orienter vers la lumière », au travers d’une amitié, d’une relation dans laquelle deux êtres isolés peuvent reconstruire quelque chose ensemble. Mais du conte, Le Rapport de Brodeck présente aussi le côté sombre : les portraits exposés dans la salle de l’auberge sont des rapports en image : leur précision évoque les tableaux de Bruegel, ses scènes de ripaille et ses monstres humains.
Philippe Claudel donne de son livre une approche par le langage lui-même : « écrire une histoire, c’est aussi réfléchir sur le langage qu’on utilise […] chaque livre est une exploration, une aventure […] en tant qu’auteur, on est imprégné de structures de livres […] tous les livres qu’on écrit sont des variations sur la littérature elle-même […] un roman n’étant jamais qu’un décor qu’on démonte à la fin du livre ». Du méta texte à l’intertexte, Le Rapport de Brodeck se donne à lire comme une somme de théories sur la littérature par la littérature. Il est également le texte de la non-littérature. Quel est-il ce rapport qu’on commande à Brodeck et dont on ne lit pas une ligne? Et le carnet de l’Anderer, objet de supputations craintives ? Claudel tisse subtilement les ellipses au fil des lignes, et telle une Pénélope qui resterait seule à jamais, défait son ouvrage quelques mots plus loin. Le Rapport de Brodeck est un roman du non-dit, mais aussi un roman de tous les romans qui ne seront jamais écrits : Brodeck choisit « d’écrire […] dans [s]on cerveau. Il n’y a pas de livre plus intime. Personne ne pourra le lire celui-là ».
Brodeck souffre d’hypermnésie : ne pouvant ni déléguer ni oublier, il écrit. Contrairement au prêtre désabusé, homme-égout, qui ne peut évacuer les horreurs qu’il a reçues en dépôt, Brodeck a la chance de pouvoir dire. Son texte n’est que souvenir, regard sur un passé qui envahit, parasite et contamine le présent. Le narrateur ne peut pas vivre s’il ne parle pas, s’il ne se souvient pas. Le maire du village choisit au contraire d’oublier, il ne peut pas s’encombrer d’une mémoire : il a le devoir de veiller au bien du collectif et pour cela, il faut effacer la faute. Le rapport est l’aveu fait au nom de tous, puis consumé pour purifier la mémoire collective. Claudel questionne ainsi la société : « on est dans une société de la commémoration, qui se souvient, qui se flagelle ». La confession est-elle nécessaire à l’humanité ? Une société a-t-elle à endosser et expier des crimes antérieurs à elle ?
L’écrivain développe habilement le thème classique de l’autre, fascinant et effrayant. Il aime « fouiller cette altérité », puisque « l’écriture est tournée vers les autres et plus encore que l’écriture, la publication ». Brodeck le sait, lui qui craint tant qu’on découvre son texte. Pas le rapport, ça il veut s’en défaire au plus vite ; non l’autre texte, son rapport sur lui-même. Il lui trouve la cache la plus improbable, le ventre violé d’Emélia qui devient dépositaire de la vérité. Brodeck écrit le rapport, mais ce texte n’est qu’un autre : le vrai texte est celui qu’on dissimule.
« Toute littérature est un engagement », répond Claudel à une des questions posées. « Elle engage le lecteur [..] et toute littérature engage celui qui la fait« . Philippe Claudel s’y connaît en engagement : Le Rapport de Brodeck clôt une trilogie initiée avec Les Ames grises et La petite fille de monsieur Linh. Parcourant trois conflits majeurs du 20ème siècle, identifiés ou symbolisés, il interroge son œuvre au travers du prisme de l’inhumanité.
