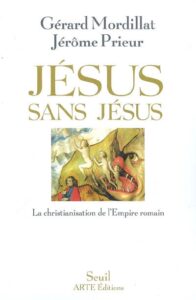
Essai de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur
L’Antiquité a été ébranlée par l’irruption d’une nouvelle croyance: le christianisme, en rupture marquante avec le judaïsme, a mis plus de cinq siècles à s’imposer comme la religion officielle du grand Empire romain, de chaque côté de la Méditerranée, renversant le paganisme et le polythéisme. Un homme, Jésus de Nazareth, suivi de ses disciples, a mis en branle une formidable machine à penser et à régner.
Les auteurs, avec talent et perspicacité, mènent un travail minutieux sur le développement du christianisme. Certains chapitres sont légèrement obscurs, mais l’ensemble est cohérent et bien documenté. Ils retracent habilement les retournements et les dérives qui ont transformé le judaïsme en christianisme. Jésus était venu proclamer l’avènement du Royaume d’Israël, au sein duquel les enfants d’Israël – c’est-à-dire les Juifs – rejoindraient le Seigneur dans sa gloire. La réalité et la suite des choses ont prouvé que le Royaume d’Israël, supposé advenir à la fin des temps, s’est installé au sein de l’Empire romain, et ceux qui y étaient destinés, toujours les Juifs, en ont été exclus, au nom d’un antisémitisme ironique. Le christianisme s’est en fait développé sans Jésus Christ, juif convaincu.
J’ai vraiment apprécié ce voyage dans l’histoire, la façon qu’ont les auteurs de rétablir les vérités, le vrai sens des mots et des choses. Cet ouvrage a nourri ma culture et ma foi de catholique tout en éclairant ma lanterne sur bien des points.
Je ne résiste pas à citer un long passage de cet ouvrage (pages 229 à 231). C’est une synthèse très claire de la construction du christianisme, de sa rupture avec le judaïsme et de sa transformation en religion unique, officielle voire obligatoire. Ces lignes devraient donner le goût aux lecteurs intéressés de s’aventurer plus avant dans le texte.
Supposons un instant que Jésus revienne sur terre. Il n’est pas besoin de faire preuve de beaucoup d’imagination pour comprendre qu’il serait stupéfait. […] Mais il l’aurait été tout autant s’il était réapparu au V° ou au VI° siècle, lorsque le christianisme est devenu la religion officielle et unique de l’État romain, tandis que le judaïsme, vaguement toléré, étroitement borné, soigneusement isolé, n’avait plus aucun espoir de devenir un jour la religion de l’humanité toute entière.
Premièrement : sans doute, vers 450-500, Jésus serait-il abasourdi de voir que le monde existe toujours, que la Fin des temps qu’il a annoncée sans relâche ne s’est pas produite, que le Royaume de Dieu ne s’est pas rétabli avec puissance.
Deuxièmement : il serait tout aussi attristé de constater que la restauration du royaume d’Israël n’a pas eu lieu et que Rome, plus que jamais domine la Palestine.
Troisièmement : quant à Jérusalem, il n’y reconnaîtrait rien, tant la ville a été transformée par les Romains, qui sont allés jusqu’à créer un parcours de pèlerinage « touristique » sur les lieux où il a été torturé et exécuté, désormais baptisés « lieux saints ».
Quatrièmement : même s’il pouvait être honoré de l’attention portée à sa personne, lui qui n’avait vécu que dans le judaïsme et pour le judaïsme, il enragerait vraisemblablement de voir les chrétiens se réclamer de lui, se proclamer « véritable Israël », tout en stigmatisant les juifs comme fils du Diable (Jn 8,44)
Cinquièmement : son étonnement serait aussi grand à la lecture de l’évangile, où ses actes et ses paroles sont rapportés par des témoins qu’il n’a jamais rencontrés, qui ne l’ont jamais vu, jamais connu.
Sixièmement : il ne comprendrait pas non plus pourquoi apparaissent sur sa bouche des phrases qu’il n’a jamais prononcées, comme ses dialogues avec Pilate ou, au sommet, l’ineffable formule « mon royaume n’est pas de ce monde » (Jn 18,36)
Septièmement : ne parlant ni le grec, ni le latin, Jésus aurait par ailleurs beaucoup de mal à lire ces textes qui lui sont consacrés – comme à dialoguer avec les chrétiens qui le vénèrent.
Huitièmement : il n’accepterait certainement pas que son livre, la Bible hébraïque, soit reléguée à l’arrière-plan, périmé comme un « Ancien Testament ».
Neuvièmement : plus incroyable serait d’apprendre que, pour les fidèles du christianisme, il n’est pas un prophète comme ses collègues prophètes de l’Antiquité, mais un dieu, le Fils de Dieu, voire Dieu lui-même, de « même substance » que son « Père ».
Dixièmement : qu’il ait pu ressusciter avant le Jugement dernier, revenir seul d’entre les morts, lui paraîtrait de toute façon une hypothèse abracadabrante.
Onzièmement : alors qu’il n’avait aucun lieu où poser sa tête, comment pourrait-il songer à s’abriter dans les basiliques ou les églises, qui désormais attirent tous les regards, étalent leurs ors et leurs marbres et ornent les murs de son effigie (peut-être penserait-il qu’il s’agit de sa caricature), l’exposant « glorieux », mais supplicié sur le bois du malheur?
Douzièmement : alors qu’il n’avait cessé de vitupérer les riches et les puissants, le pouvoir des autorités, qu’elles soient romaines ou juives, comment accepterait-il que, si le royaume des cieux est toujours promis dans l’au-delà à ceux qui m’ont rien ici-bas, les riches et les puissants se dispensent de passer par le chas de l’aiguille et continuent à jouir des plaisirs de la vie sans vergogne?
Treizièmement : crucifié par les Romains sous le chef d’accusation « roi des Juifs », ne s’insurgerait-il pas de voir son disciple Pierre [Shimon] trôner chez les ennemis des juifs, à côté de Paul, nouveaux Romulus et Remus de la légende romaine du christianisme?
Quatorzièmement : et ce Paul, qui se disait le dernier des apôtres, comment Jésus admettrait-il que, se réclamant de son enseignement, il ait pu proclamer que « la force du péché, c’est la Loi » (Co, 15,56), que par elle abonde la faute et qu’elle s’avère incapable d’apporter la perfection aux hommes?
Quinzièmement : ne serait-il pas horriblement choqué de voir que l’instrument de son supplice par les Romains, la croix, est devenue sur la bannière chrétienne le symbole même de la mainmise de Rome?
Seizièmement : comme nous, ne se poserait-il pas la question, toujours la même et lancinante question, qui ne vaut que parce qu’elle est question, éternelle, sempiternelle, qui se dérobe dès qu’on s’approche trop près du feu de la réponse: pourquoi? comment? Ou, en d’autres termes, comment expliquer le succès du christianisme?
