Roman en trois tomes de Jean-Louis Marteil.
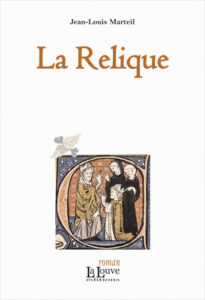
La relique
An de grâce 1130, une communauté de frères bénédictins dans la province de Rouergue. Trop souvent rançonnée par les pillards de passage, ses coffres sont vides. Pour renflouer les caisses, une seule solution: compter sur la dévotion généreuse des chrétiens en pèlerinage. Mais pour que pèlerinage il y est, il faut une relique, faiseuse de miracle autant que possible. Puisqu’il est impensable d’en acquérir une à prix d’or, il faut se résoudre au vol et dépouiller une autre abbaye de son précieux et saint trésor. Pour mener à bien cette scandaleuse mission, le père abbé désigne les frères Abdon, Jérôme et Bernard, trois moines qui font bien souvent trembler les murs de l’abbaye et qui mettent à mal le silence et le recueillement qui seraient de mise selon la Règle de saint Benoît. Le gros moine Abdon, le maigre Jérôme et le niais et gourmand Bernard prennent la route de Tarragone, en Hispanie, pour dérober une relique de saint Vincent. Le chemin sera long et pénible pour ces hommes si différents. L’inimitié qui les rassemble n’est qu’une des épreuves qu’ils traverseront avant leur retour à l’abbaye: la faim, la nature hostile, les rencontres de mauvais aloi et les nombreux manquements à la Règle composent une aventure loufoque et hilarante à la rencontre d’un Moyen-Âge savoureux et haut en couleurs.
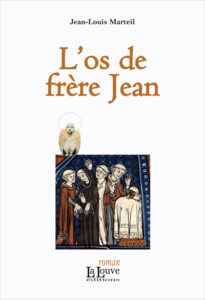
L’os de Frère Jean
Dix ans ont passé depuis la téméraire et incroyable aventure des trois moines bénédictins de Rouergue. L’abbaye s’est enrichie, le flot des pèlerins ne décroit pas et la relique attire toujours autant de dévots en quête de miracle. Le calme n’a pourtant pas pris ses quartiers au sein du cloître. L’os sacré déclenche des rancœurs et alimente les humeurs maussades de certains moines. Il nourrit aussi les desseins non avouables de personnages à la convoitise dévorante. Le frère Déodat, venu d’une communauté religieuse des monts d’Auvergne, est missionné par son supérieur pour le dérober au profit de son abbaye ruinée. En dix jours, la relique de saint Vincent va quitter l’abbaye de Rouergue, passer entre de nombreuses mains avant de retrouver son reliquaire, pendant que les frères Bernard, Abdon et Jérôme retrouveront les bienfaits et les déboires de la marche en pleine nature, à la recherche les uns des autres, à la poursuite de la relique et en quête d’un paradis terrestre bien improbable.

Le vol de l’aigle (À paraître le 23 juin 2010)
Deux mois après le retour de la relique en l’abbaye de Rouergue, la communauté s’agite à nouveau, si tant est qu’elle se calme parfois. Le départ des trois pèlerins étrangers qui ont rendu à l’abbaye son précieux bien est entouré d’un certain mystère et d’aucuns crient bien rapidement au miracle. Pour s’assurer de la véracité de ce miracle, l’abbé, grandement aidé par les persiflages des frères Anselme et Gabriel, jette une nouvelle fois les frères Abdon, Jérôme et Bernard sur les routes, vers Saint Jacques de Compostelle où les trois pèlerins se seraient envolés. Les trois moines ne sont pas seuls cette fois, l’âne Morel les accompagne. L’animal, aussi prompt à la ruade que réfractaire à tout bât, manifeste son caractère rebelle et entend bien ne faire que ce qu’il veut quand il le décide, tout en se révèlant un précieux et attachant compagnon de voyage. La via Tolosana empruntée par les quatre compères réserve bien des dangers: l’acedia dans laquelle s’enlise Abdon, les ours des Pyrénées ou les brigands des montagnes. Sur ce chemin de pèlerinage, les moines découvrent aussi les merveilles des cités traversées, la richesse de l’amitié et l’utilité de leur existence.
*****
Comment ne pas apprécier une telle incursion historique dans une période si foisonnante et propice aux récits ? La langue de l’auteur est savoureuse, sa capacité à convoquer devant nos yeux des images vivantes est époustouflante. Les couleurs et les odeurs nous parviennent du Moyen-Âge, nullement affadies par leur voyage temporel. Les situations les plus scabreuses et les plus triviales se jouent sous nos yeux et c’est avec hilarité qu’il convient d’y assister. De crotte et de puanteur, voilà le lecteur largement doté pour entrer d’un pied gaillard dans le récit picaresque de trois moines bien plus humains que saints. Attention, les mots sonnent haut et clair, sans pudeur inutile et mesquine. Cul-serrés et trouillards s’abstenir ! « Réjouissez-vous, mes frères: maintenant, les véritables ennuis vont pouvoir commencer. » (La relique – p. 83)
Loin des horreurs sanglantes qu’on a à tort l’habitude de prêter au Moyen-Âge, le lecteur se retrouve dans un monde de drôlerie et d’humanisme, le plus drôle n’étant-il pas d’attaquer l’homme là où il est le plus humain? Une malédiction particulière obscurcit régulièrement les jours et les murs de l’abbaye. Les pigeons, « entêtés enfienteurs de toitures et canalisations » (La relique – p. 23) obsède le père abbé qui ne sait comment se débarrasser de ce fléau nullement cité au nombre des plaies divines, mais qui mériterait d’y figurer en bonne place. Un autre fléau est le vin pur, non coupé d’eau, qui entraîne les moines habitués à davantage de tempérance dans les méandres de ses visions chimériques et de ses nausées.
Outre la nature éminemment comique du texte, il faut remarquer la qualité des propos historiques. La bouffonnerie ne dame pas le pion à la précision des descriptions architecturales. Des voûtes romanes, chapiteaux et colonnes des abbayes et cathédrales en passant par les hautes murailles des cités fortifiées, l’auteur maîtrise son sujet et dépeint les lieux de façon précise et éclairée, sans faire subir au lecteur des leçons fastidieuses qui n’auraient pas leur place dans ces pages. Les dangers qui menaçaient les hommes de l’époque sont évoquées sans pathos. Qu’il parle des pillards des forêts françaises ou des Sarrasins de la péninsule ibérique, Jean-Louis Marteil sait faire revivre les protagonistes qui ont fait l’Histoire.
L’ouvrage est un précis sur la vie monacale et les activités d’un cloître. L’art de l’enluminure, pratiqué dans le scriptorium, rappelle que les abbayes étaient des réservoirs de sagesse où évoluait une élite intellectuelle, hélas, coupée du monde. Les offices qui rythment la vie des moines sont habilement utilisés par l’auteur pour situer l’action dans la journée. Le Chapitre des coulpes, très strict selon la Règle de saint Benoît, est matière à bien des situations comiques largement développées par l’auteur.
Le vol de reliques, autrement appelé déplacement de reliques ou encore Translation, était chose courante à l’époque médiévale. Les voleurs s’arrangent avec leur conscience. « C’est la coutume des Translations. […] Je demande au saint s’il veut me suivre et, s’il est d’accord, il ne fait rien pour m’empêcher de l’emmener. […] C’est ainsi qu’il se pratique depuis toujours. […] Puisqu’en principe le saint est d’accord. » (L’os de frère Jean – p. 95 et 96) Quand le silence d’un saint a valeur d’approbation voire de bénédiction, on peut justifier beaucoup de forfaits après de ferventes oraisons ! Néanmoins, il convient de se méfier des silences trop éloquents. « C'[est] bien toujours la même chose avec les saints, ou Dieu, ou la sainte Marie. Ils [laissent] les hommes se débrouiller avec leurs questions, quitte à les punir ensuite d’avoir choisi la plus mauvaise des deux réponses qu’ils n’avaient point données! » (Le vol de l’aigle – p. 101)
Le récit est protéiforme: principalement picaresque, il se décline aussi sur le mode de la fable et de la satire. Les épisodes qui mettent en scène la faune sont assez proches du Roman de Renart. Les bêtes et bestioles deviennent momentanément les protagonistes de minuscules historiettes dans lesquelles ils ont des comportements très humains qui ne sont pas sans rappeler les vices et déboires que rencontrent les principaux héros de l’histoire. Les réflexions des personnages, notamment celles de frère Jérôme, portent de sérieux coups de griffe à l’inébranlable monument qu’est la sainte Église. Dans cette époque de prétendu obscurantisme, les prélats s’accommodaient assez bien de faire passer des vessies pour des lanternes. Ou autrement dit: dans le cochon, tout est bon!
Jean-Louis Marteil excelle dans la peinture de caractères divers et colorés. Le gros Abdon est un maladroit congénital qui échappe tout ce qui lui passe dans les mains quand il n’est pas occupé à bousculer et détruire une pièce d’ameublement. Le costaud Bernard est le type même de la brute au grand cœur : lent d’esprit et toujours affamé, il dissimule des trésors de bonté derrière un masque d’apparente et d’insondable bêtise. Jérôme, sec et noueux comme un cep, est la tête pensante de cet improbable trio d’amis et il est pourvu d’une langue vive et mordante. Voici pour les héros de cette trilogie. Les autres frères de l’abbaye sont aussi dignes d’intérêt. L’herboriste Anselme, chevalin d’apparence en raison d’une machoire et de dents proéminentes, est aussi fourbe que l’âne qui rue sans raison. Le frère Thomas, cellérier de son état, succombe au péché d’avarice, rejoint en cela par l’hôtelier des lieux, le frère Antoine qui, faisant fi de toute charité chrétienne, n’offre le gîte et le couvert aux pèlerins que contre espèces sonnantes et trébuchantes. Le borgne Gabriel, responsable de la relique et de sa surveillance, est plus atrabilaire qu’un ours dérangé en pleine hibernation. La palme revient probablement au père abbé, si influençable qu’on peut se demander si c’est bien lui qui tient les rênes de l’abbaye. Mais la trilogie médiévale de Jean-Louis Marteil a ceci de précieux qu’elle permet à tout lecteur de reprendre espoir en la nature humaine.
Dans cet univers de moines imparfaits, quid de la femme ? La gueuse selon Jean-Louis Marteil a la langue agile en toutes choses et l’œillade aussi dangereuse qu’une lame. Assailli d’appétits aussi inassouvis qu’inavouables, le gros moine Abdon manque de bien peu de succomber aux charmes si facilement déployés de demoiselles qui n’ont de pucelles que l’apparence. Le frère Jérôme, derrière un maintien rigide et austère, cache la marque d’une ancienne passion qui ne demande qu’un regard pour rallumer ses braises.
Que dire de plus pour convaincre tout un chacun de se procurer la trilogie de Jean-Louis Marteil ? Peut-être que ses textes se lisent vite, trois jours (et nuits) pour moi, un régal renouvelé à chaque tome. Ou peut-être que c’est vraiment le genre de récit qui met le moral bien haut, au beau fixe. Les notes de bas de page de l’éditeur (qui est aussi l’auteur) sont remarquables d’impertinence et de finesse. Ses allusions anachroniques ne le sont pas moins: le football est pressenti dans la soule, l’homme qui murmurait à l’oreille des ânes annonce un succès des salles obscures, des locutions aujourd’hui éculées semblent naître sous la langue des personnages, etc. Pour ceux qui partent en vacances, un conseil dont vous ferez ce qu’il vous plaira : glissez donc ces ouvrages entre la crème solaire et la pelle à sable du petit dernier. Et pour les moins heureux qui connaîtront les affres du travail en plein mois de juillet et août, une prescription : allez faire un tour au Moyen-Âge, dépaysement garanti !
