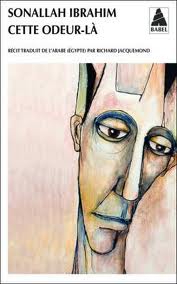
Héliopolis, en Égypte. Un homme sort de prison. On pressent que ce sont ses idées et son statut d’intellectuel qui l’ont conduit derrière les barreaux. Tous les soirs, il doit se présenter à l’appel d’un policier. De déambulations en visites, il doit réapprendre la liberté sous toutes ses formes. Prisonnier, il l’est encore à l’intérieur. Il ne peut pas écrire. Il ne sait plus aimer les femmes. Si des filles hantent ses pensées, il ne se remémore que la douleur et l’impuissance : « J’ai appris à découvrir d’autres choses en elle. Quand elle faisait la moue, qu’elle ne décrochait pas un mot quoi qu’il arrive, et que je me creusais la cervelle à essayer de comprendre pourquoi. Quand, parfois, elle semblait douce et tendre, et que je l’adorais. Quand je m’asseyais devant elle, les yeux sur son visage, ses mains, ses jambes, et que j’en pleurais presque de désir. Quand je regardais ses yeux brillants et ses joues tentantes, quand mes doigts couraient sur ses bras, que mes jambes s’approchaient des siennes, et qu’elle me refusait, j’ai appris la souffrance. La dernière fois, j’ai cru devenir fou. J’avais acquis la certitude qu’elle ne m’aimait pas. Elle m’a pris dans ses bras, et m’a laissé toucher sa poitrine et ses mains, embrasser ses joues et ses lèvres. Mais elle était froide. » (p. 42) Le narrateur, figure intime de l’auteur, livre un récit bref sur une liberté qui semble n’en avoir que le nom.
La brièveté du roman est stupéfiante, au premier sens du terme. Quelques cinquante pages et voilà la fin, à croire que l’auteur s’est levé et a oublié là le texte qu’il travaillait. Et pourtant, le récit fait sens, à condition de ne pas chercher de morale. La narration est fugace, à la mesure des sentiments du narrateur. Il vit par épisodes : se lever, se laver, sortir, manger, faire signer son cahier par le policier, dormir. Une banalité s’instaure dès les premières pages et continuera bien au-delà du récit. Plutôt que d’épuiser la machine en racontant une suite d’évènements routiniers, le narrateur laisse son récit en suspens.
La redécouverte du monde hors de la prison est ponctuée de plongées dans le passé. Les souvenirs sont exprimés en italique, comme si le temps d’avant basculait, comme s’il était impossible d’en maintenir l’équilibre. Peu à peu, les souvenirs ramènent le narrateur jusqu’à l’enfance, jusqu’à l’innocence originelle et jusqu’à la mère perdue. Cette odeur-là, c’est celle de la liberté, mais la liberté ne sent pas bon, elle n’est pas fleurie de jasmins. La liberté, pour le narrateur, c’est une honteuse odeur de pet, ce sont des égouts qui débordent et une cigarette qui se consume.
L’Égypte de Nasser est évoquée à mots couverts. La corruption et la violence sont partout. Le récit, partiellement autobiographique, évoque des forces obscures opposées aux esprits libres. La préface de la première édition est située après le récit. Étrange localisation pour une préface mais qui clôt en fait l’histoire physique du roman, censuré à sa sortie en 1966 : « C’est ce qu’il advint du mien : à peine était-il sorti des presses qu’il fut interdit. » (p. 66) En produisant ici la préface originale, l’auteur rend sa plénitude au roman.
Ce roman est brutal et ne laisse pas indifférent. Mais le malaise qu’il suscite est trop intime pour être tolérable. Le récit est fortement marqué au niveau temporel. Il fait sens dans une époque et dans un contexte. Tiré de là, sans perdre de sa puissance, il devient sensiblement inintelligible et laisse place au seul malaise. J’ai un sentiment très mitigé à l’égard de ce roman : à la fois éblouie par les descriptions amoureuses et les souvenirs, je n’ai pas aimé les errances du personnage dans la ville. Voilà une escale en Égypte globalement déplaisante.
