Quadrilogie de James Ellroy.
ATTENTION, RÉVÉLATIONS !
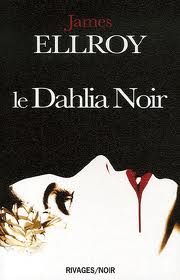
Le Dahlia Noir
Lee Blanchard et Bucky Bleichert sont deux flics du L.A.P.D (Los Angeles Police Department), deux hommes forts et puissants qui forment un duo de choc, « Feu et Glace, les flics boxeurs. » (p. 106) Leur amitié s’est forgée sur le ring à coup de gants de boxe et sur le terrain dans la chasse aux criminels. Entre Blanchard et Bleichert, il y a Kay Lake. Elle vit avec Blanchard mais leur relation est toute platonique alors que se noue une romance improbable entre elle et Bleichert. « Adversaires, puis coéquipiers et enfin amis, Kay était inséparable de l’amitié : elle ne venait jamais se mettre entre nous mais elle emplissait nos deux vies, hors des heures de travail, avec grâce et style. » (p. 91) Début 1949, le trio Lee/Bucky/Kay vole en éclat avec le meurtre du Dahlia Noir, une actrice de seconde zone, menteuse, rêveuse et pas farouche, retrouvée découpée, mutilée et éviscérée sur un terrain vague. L’affaire déchaîne les médias. « Femme fatale provocante, en robe noire collante » (p. 142), le Dahlia Noir convoque les démons féminins qui hantent les deux flics, les poussant dans des voies dangereuses. Bleichert le reconnaît en introduction : « Notre équipe ne fut rien d’autre qu’une route cahotante qui menait au Dahlia. Au bout du compte, elle devait nous posséder l’un et l’autre, totalement. » (p. 21) L’affaire du Dahlia Noir dépasse le simple meurtre et dissimule une sordide affaire de mœurs et de famille. L’enquête, qui semble insoluble, obsède Bleichert qui se perd dans les faux-semblants et les ramifications de diverses affaires de crimes qui n’en forment qu’une seule, atroce à souhait.
Le récit est mené est Bleichert, dans une narration à la première personne qui entraîne le lecteur dans les tourments de la mémoire du policier. On suit l’enquête depuis l’intérieur d’un esprit bourrelé de remords. Avec cynisme et sur le ton d’un humour grinçant, Bleichert rapporte les faits crus et dévide la vérité jusqu’au bout de la pelote. Il remonte aux sources du sordide pour s’y noyer et n’en réchappe qu’au prix d’un ultime sursaut d’horreur. Blanchard et Bleichert traînaient tous les deux des casseroles issues de la seconde guerre mondiale et d’un passé familial traumatisé. Bleichert dévoile lentement son aversion des femmes avant sa rencontre avec Kay, la femme qui le sauve de lui-même : « l’amour avait pour moi un goût de sang, qui se mêlait aux odeurs de résine et d’hémostatique. » (p. 56) Sa liaison avec Madeleine Sprague, riche héritière d’une famille bourgeoise, est un piège dans lequel il s’embourbe doublement et profondément.
L’affaire du Dahlia Noir est fondée sur un fait divers réel. Une actrice affublée de ce surnom a réellement fait la une des journaux de Los Angeles. Le cas n’a jamais été résolu par les services de police, mais James Ellroy se paie le culot de proposer un dénouement et une explication au meurtre qui a ensanglanté les pages des canards de la ville des Anges. J’ai dévoré ce premier tome en constatant que l’horreur fait recette et attire l’œil. Incapable de détacher les yeux des descriptions macabres qui ponctuent le roman, je me suis délectée des mécanismes mis en œuvre par l’auteur pour balader son lecteur.

Le film éponyme de Brian de Palma avec Josh Hartnett, Hilary Swank et Scarlett Johannson est une réussite. J’ai déploré quelques raccourcis mais le film reste fidèle à l’esprit du roman de James Ellroy. Seul bémol – et de taille – j’ai trouvé Josh Hartnett bien trop jeune et trop poupin pour incarner l’agent Bleichert. L’acteur semble ne pas avoir assez vécu pour endosser le pesant costume de ce flic tourmenté.
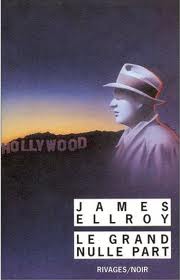
Dans la nuit du 1er janvier 1950, un homosexuel est retrouvé mort, le corps déchiré de mutilations sexuelles et d’étranges morsures. D’autres meurtres similaires suivront dans l’année. Mal Considine, héros controversé de la seconde guerre mondiale, agent du L.A.P.D., mène l’enquête avec Dudley Smith, un policier dont le passé semble entaché d’une sombre affaire. Ellis Loew, adjoint du procureur de Los Angeles lance un Grand Jury sur l’influence communiste à Hollywood. La Menace Rouge fait trembler et les syndicats de machinistes de l’industrie du cinéma font peur. Danny Upshaw, jeune criminologiste du Comté de Los Angeles, est engagé pour infiltrer les réseaux communistes et trouver des preuves accablantes contre les communistes, en se rapprochant de Claire de Haven, une riche pasionaria communiste surnommée la Reine Rouge. Buzz Meeks, ancien flic du L.A.P.D. au département des Stups, homme de main d’Howard Hugues se retrouve sur les deux affaires. Réintégré dans ses fonctions de policier, il met ses talents au service de Mickey Cohen, chef de la pègre en rivalité avec Jack Dragna, un autre gangster de Los Angeles. Buzz Meeks prend les plus grands risques en s’amourachant d’Audrey Anders, la poule attitrée de Mickey Cohen. « Ça me plaît bien que ce soit dangereux d’être avec toi. J’aime ça. » (p. 275) Ce couple d’amants terribles ira au-devant de grands remous alors que Los Angeles est encore et toujours secouée par des vagues de crimes.
Dans ce deuxième volet du Quatuor de Los Angeles, on découvre la rivalité qui existe entre les services du L.A.P.D. (département de police) et ceux du L.A.S.D. (département du shérif). Le récit est mené à la troisième personne par un narrateur omniscient qui saute d’un flic à l’autre. L’intrigue est complexe, notamment en raison du point de vue adopté. Les chapitres projettent le lecteur au milieu d’une scène sans indiquer quel personnage est suivi. Cela participe de l’enchevêtrement des enquêtes et de la ramification de l’intrigue. Chaque fil mène à la même conclusion mais dévider l’écheveau demande patience et relecture. J’ai suivi avec jubilation les mêmes pistes que les flics, réécrit leurs théories et rédigé les mêmes conclusions. James Ellroy parvient à créer une intrigue policière ultra complexe sans perdre en route son lecteur. Mais il s’agit de garder l’œil ouvert et l’esprit alerte pour ne pas manquer un indice.
Je me suis attachée aux trois flics. Ils sont torturés, comme ceux du premier volet, mais leurs fêlures sont moins monstrueuses, plus humaines. Leurs faiblesses et leur violence bouillonnante sont des armes dont ils usent avec maladresse, comme des pantins qui voudraient couper leurs liens. Buzz Meeks surtout a retenu mon affection. De brute notoire au passé dégueulasse, il gagne en délicatesse à mesure que l’amour lui ouvre les yeux sur des valeurs autres que l’argent. Sans mièvrerie, James Ellroy montre comment un homme peut changer de voie sans renier ce qu’il est mais en effaçant une partie de l’ardoise qu’il porte dans le dos.
Une nouvelle fois, James Ellroy se fonde sur un fait réel, le meurtre de Sleepy Lagoon, pour développer une intrigue qui emprunte au réel et à l’imaginaire. La réalité dépasse parfois toutes les folies que pourrait se permettre le roman. Le talent de James Ellroy, c’est de ne jamais faire oublier le substrat réel en l’alimentant de fictif. Il ne s’agit pas de recréer la vérité mais d’imaginer des voies parallèles et de donner au crime de nouvelles voies à explorer.
Et finalement, le Grand Nulle Part, c’est quoi ? C’est où ? Pour moi, c’est là où se perdent les flics de valeur, comme Lee Blancharddans le premier volet. C’est aussi un air de jazz aux notes mélancoliques et sinistres. Le Grand Nulle Part, c’est Los Angeles, cité d’anonymes et de solitaires, cité d’êtres perdus, cité aux valeurs en déroute, cité oubliée du destin.

Nuit de Noël 1951 ou « Noël Sanglant » dans les annales. Des policiers s’en sont violemment pris à des prisonniers en cellule, abusant de leur autorité et de leur force pour venger des collègues. Un agent tatillon, Ed Exley, héros de la guerre, témoigne en défaveur de ses collègues en échange d’une promotion qui sert son ambition démesurée : cadet d’une famille de policiers méritants, il veut briller aux yeux de son père et éclipser le souvenir brillant de son frère mort en service. Désormais haï de tous ses collègues, il entame une carrière fulgurante qui le mène aux plus hauts postes de la police. Dudley Smith est de plus en plus présent au L.A.P.D. et il entretient une attitude ambiguë vis-à-vis des agents qui ont le malheur de trouver grâce à ses yeux : « Lorsque Dudley Smith vous emmenait à ses basques, on lui appartenait […] : on n’était jamais sûr de ce qu’il voulait de vous, ou de la manière dont il se servait de vous. » (p. 197) C’est ainsi qu’il s’attache les services de Bud White, un policier connu pour ses pulsions de violence et sa haine des hommes qui maltraitent les femmes. Il s’attache à Lynn Brackens, prostituée de luxe. Bud White est un homme d’honneur, loyal jusqu’au pire à son coéquipier, Stensland, un flic alcoolique en fin de carrière. Enfin, il y a Jack Vincennes dit Poubelle : conseiller technique pour la série L’Insigne du courage, policier aux Stups, il renseigne régulièrement un magazine à scandales sur les vices et crimes des stars. Agent qui aime faire la couverture, il dissimule pourtant avec hargne un secret qui pourrait mettre en péril sa carrière. La course au poste de procureur est ouverte et Ellis Loew se présente pour la seconde fois avec de grandes chances de remporter la place. Survient le massacre du Hibou de Nuit et le viol multiple d’Inez Soto. Se profile une sordide affaire de mœurs fondée sur un réseau de prostitution aux pratiques singulières. On passe de 1953 à 1957 en quelques pages. Les trois flics sont confrontés à des affaires qui impliquent leur force morale et leur capacité à survivre au sein d’un système judiciaire qui écrase les purs pour sauver les pourris. L’honneur et la loyauté sont au centre de l’intrigue : il faut savoir pourquoi et pour qui on devient flic et à qui on choisit de prêter allégeance.
Ce troisième volet est mené à la troisième personne. Comme dans le volet précédent, on passe d’un flic à l’autre au gré d’un rythme dilatoire parfaitement maîtrisé. La mise en place de l’intrigue est longue. La première partie du roman pose les fondements de plusieurs affaires qui finiront par n’en former qu’une, tentaculaire et sordide, comme dans les deux premiers volets. Le prologue étonne : il est l’épilogue du Grand Nulle Part et on assiste à la fin prévisible de Buzz Meeks. Ce rejet de la conclusion en début du nouveau volet empêche l’intensité dramatique de s’essouffler. Et Buzz Meeks a encore remporté toute mon affection.
J’ai eu un grand coup de cœur pour l’agencement de ce troisième volet. On passe du récit des enquêtes à des chapitres composés uniquement de rapports de police ou coupures de presse. Version officielle et version journalistique s’affrontent pour donner un mélange audacieux et complexe. C’est au lecteur de tirer le vrai du faux. Comme le dit le titre, ce qui se passe à Los Angeles est confidentiel et ce ne sont pas les révélations prétendument fracassantes des journaux à scandale qui renversent réellement la vapeur. Dans la cité des Anges, le doigt reste posé sur la bouche, sur la marque de l’ange.

Le film éponyme de Curtis Hanson et avec Kevin Spacey, Russel Crow, Kim Basinger et Dany DeVito est une grande réussite. Comme adaptation d’un roman d’Ellroy, je l’ai préféré – et de loin – au Dahlia Noir de Brian de Palma. Si ce dernier est d’un noir glacé, comme une couverture de magazine, le film de Curtis Hanson est gouailleur, sale et compromettant. Dany DeVito excelle dans le rôle de Sid Hudgens, le journaliste de L’Indiscret. Kim Basinger est sublime en pute de luxe un peu paumée. Et que dire de l’interprétation de Russell Crowe, qui endosse avec humilité et éclat le rôle de Bud White ! L’acteur fait ressortir toute la bonté et l’ambivalence du personnage dans une composition très touchante. Certes, Curtis Hanson prend de nombreux raccourcis, élimine des personnages et va plus directement au cœur des choses. Mais il rend à merveille la voix des journaux en la personne de Sid Hudgens. Dans son film, Dudley Smith est un vrai pourri qui obtient enfin ce qu’il mérite. Et Buzz Meeks et Stensland connaissent des trajectoires différentes de celles du roman. Mais l’essentiel est là, la verve de James Ellroy s’illustre avec puissance, ses personnages sont droits dans leurs bottes, prêts à essuyer le pire.

1958. Dave Klein est avocat et policier au sein du L.A.P.D. Des meurtres perpétrés sur des clochards par un certain Feu Follet Fou, un cambriolage dans un magasin de fourrure et dans la propriété de J.C. Kafesjian, connu pour ses activités criminelles tolérées par les Stups, jettent Dave Klein dans une bataille qui le dépasse. Par devers lui, Ed Exley et Dudley Smith tentent de solder une inimitié qui dure depuis plusieurs années. Dans la famille Kafesjian, le père est trafiquant, le fils est un fou furieux, la fille et la mère ont la cuisse légère. En pleine course aux élections municipales, on reparle de Mickey Cohen qui est plus fauché que jamais, d’Howard Hugues qui est toujours plus obsédé des femmes et on retrouve L’Indiscret qui étale ses révélations fracassantes sur cinq colonnes. La population de Chavez Ravine est menacée d’expulsion afin de faire place au nouveau stade d’entraînement des Dodgers. Une enquête sur le milieu de la boxe et une autre sur le jeu tournent court. Dave Klein va franchir la limite qui le sépare du crime et de l’illégalité une fois de trop. Devenue proie du système qu’il servait, sa fuite est incertaine.
« J’ai moissonné l’horreur pour en tirer profit. Fièvre – brûlante maintenant. Je veux m’en aller, suivre la musique – me laisser prendre à son tourbillon, sombrer avec elle. » (p. 11) C’est sur cet aveu de lassitude et cette amorce de confession que s’ouvre le dernier volet de la quadrilogie. Si c’est la voix de Dave Klein qui porte le message, c’est l’auteur qu’il faut entendre : il est temps de refermer la porte du Quatuor de Los Angeles, au son d’un dernier disque de jazz. Ce quatrième volet – comme le premier – est raconté par un personnage. On ne suit que lui, son enquête et ses crimes. Particulièrement malsaine, la narration place le lecteur au cœur de l’esprit de Dave Klein, aux prises avec une pensée rapide et hallucinée. Si on assiste aux mécanismes de raisonnement, on découvre également un passé sordide et violent. Dave est en dette avec Mickey Cohen. Au sein de la pègre, on le connaît sous le nom du Redresseur. Ses méthodes sont ultra violentes et douteuses, tout comme le sont ses sentiments pour sa sœur Meg. Ce volet est le plus complexe : les phrases sont courtes, très souvent nominales. Les engrenages mentaux du personnage fonctionnent très rapidement et ne s’embarrassent pas d’information superflue. La phrase se fait télégraphique : au lecteur de ne pas perdre le fil du message.
Dave Klein m’a été immédiatement antipathique. Ce ressenti a influencé toute la lecture de White Jazz : ce tome est celui qui m’a le moins plu, même s’il conclut avec brio avec la quadrilogie.
*****
On découvre la ville de Los Angeles, en pleine construction et mutation. On assiste à la descente du panneau de promotion immobilière qui trônait sur les collines de la ville. Hollywoodlands n’est plus, voici Hollywood, terre de mirage, miroir aux alouettes pour starlettes crédules qui seront broyées par une industrie vorace. Le parc d’attraction Dream-A-Dreamland, inauguré dans le troisième volet, est une parfaite illustration du mensonge que les puissants servent à la population pour l’endormir.
Les 1950’s, décennie particulière, se prête particulièrement au roman : dans Le Grand Nulle Part, « l’inspecteur adjoint Danny Upshaw émit la prédiction que les années cinquante allaient être une décennie de merde. » (p. 14) Pourquoi ? Parce que la seconde guerre mondiale colle encore aux basques de tout le monde, parce les émeutes zazous sont encore dans toutes les mémoires et que l’air du temps alimentera les préjugés raciaux au-delà de toute mesure. James Ellroy excelle véritablement dans l’art de reprendre à son compte des faits réels – faits divers, Histoire, personnages historiques – pour les détourner et en faire de la matière à littérature. Dans son grand pressoir-hachoir, il mélange le vrai pour prêcher un faux aux allures du plus réel des tableaux.
Les romans de James Ellroy prennent aux tripes et les remuent. Ce ne sont pas des romans policiers traditionnels. L’auteur prend plaisir à balader ses flics – et son lecteur – pour mieux les balayer et les broyer afin d’en faire de nouvelles victimes expiatoires d’une ville puant le crime. Los Angeles incarne les nouvelles Sodome et Gomorrhe. Ce que montre James Ellroy, après tout, c’est que le crime a tous les visages et se dissimule derrière chaque porte. C’est cela que l’auteur rappelle en mettant à mal ses personnages et les règles classiques du roman policier. La découverte du coupable n’est finalement pas ce qui compte le plus, même si l’on suit avec avidité les enquêtes. Le plus important, ce sont les découvertes intimes que chaque personnage fait sur lui-même. En partageant l’intimité mentale des flics et en suivant leurs raisonnements, on les accompagne dans des révélations fracassantes qui ne leur laissent que peu de chance d’en réchapper. James Ellroy n’est pas tendre avec ses flics, il les malmène et les expédie ad patres en quelques lignes. Arrivés au bout d’eux-mêmes et investis de leur vérité propre, ils ne peuvent plus résister à Los Angeles ni au roman et doivent quitter la scène.
Alors se pose la question de la définition du héros selon James Ellroy. Est-ce celui qui a essuyé le feu ennemi pendant la guerre ? Celui qui suit la ligne droit de la justice et de la loi ? Celui qui ne commet pas de crime ? Il semble plutôt que le héros soit celui qui ose regarder au fond de lui-même si cette introspection doit être fatale. Pessimiste Ellroy ? Peut-être. Mais il faut lui reconnaître le mérite de ne pas s’illusionner sur la grandeur et la valeur des hommes.
Ici, les jouissances sont toujours sales et malsaines. Les plaisirs sont pervers et les déviances innommables. Sous la plume de James Ellroy, le sexe est sordide. Dans Le Grand Nulle Part, il souligne que « la perversion était abominable mais l’excitation était continuelle, à se sentir pareil à un glouton qui rôderait dans les ténèbres d’une maison inconnue vingt-quatre par jour. » (p. 606) Les personnages d’Ellroy ont tous les droits d’être infâmes, ils sont de papier. Ce à quoi parvient l’auteur est plus subtil et plus pervers : il fait de ses lecteurs les témoins et les complices des ignominies qu’il couche sur le papier. L’addiction est intense. Je ne saurais expliquer la fascination qui m’a saisie lors des descriptions macabres ou lors des interrogatoires et des enquêtes où les flics fouillent la merde pour en tirer l’immonde.
Les services de police sont loin d’être propres, « les meilleurs des meilleurs » excellent surtout dans le détournement de la loi. La corruption et la coercition sont au service des intérêts personnels les plus divers et des ambitions les plus démesurées. Un dialogue tiré de L.A. Confidential illustre la ligne de conduite suivie par les services de l’ordre : « – Pensez-vous qu’il faille autoriser l’existence d’une certaine fraction du crime organisé afin qu’elle perpétue certains vices acceptables qui ne font de mal à personne ? – Bien sûr, une façon de défendre les intérêts de l’électorat. Il faut bien laisser un peu de mou sur la ficelle. » (p. 91) Puisque chacun est coupable, d’une façon ou d’une autre, il n’est pas possible et pas souhaitable de tout réprimer. Ainsi se justifient les alliances avec les gangsters, les trafiquants de drogues, les maquereaux, les prostituées et les autres membres qui constituent la lie de la société dans laquelle les flics aiment à se rouler. La police telle que l’a décrit James Ellroy use de méthodes expéditives, brutales, qui flirtent ou embrassent à pleine bouche l’illégalité. La violence exercée par les policiers est justifiée dès le début par Lee Blanchard qui énonce en dogme que « y a des gens qui réagissent mal quand on est gentil avec eux. » (p. 78 – Le Dahlia Noir) La manière forte a pleine légitimité dans un monde violent. Et pourtant, en public, les forces de l’ordre font profession hypocrite de bonne foi : « Les policiers étaient sujets aux mêmes tentations que les civils mais ils avaient besoin de maîtriser leurs instincts les plus bas dans une plus large mesure afin de servir d’exemples moraux à une société sapée de plus en plus par l’influence envahissante du communisme, du crime, du libéralisme et de la turpitude morale générale. » (p. 354 – L.A. Confidential) Il ne faut pas faire confiance aux forces de l’ordre pour faire régner la loi mais il ne faut pas impunément en faire état.
L’affaire du Dahlia Noir plane et les flics craignent les ravages de la presse. Les rapports de polices falsifiés s’opposent aux articles de journaux discrédités : l’information est sans cesse soumise à caution. Il est impossible de faire confiance aux écrits formels et officiels. Alors que ces documents devraient éclairer les affaires, fournir des indications solides et étayer les enquêtes, le flou s’installe encore plus. Leur forme même, circonstanciée – même pour les articles à scandales du journal L’Indiscret – porte le sceau du mensonge, du faux. Le mieux est encore de suivre le cheminement tortueux des raisonnements des policiers, seul gage d’accès à la vérité. On l’aura compris, pour Ellroy, la presse ment et les documents n’ont d’officiel que le papier sur lequel ils sont rédigés.
James Ellroy réserve un traitement particulier aux femmes : quand elles ne sont pas découpées en rondelles, elles sont battues à mort. Èves déchues et coupables, elles se dissimulent derrière chaque crime. « Cherchez la femme » est un tuyau récurrent que s’échangent les flics et les indics. L’auteur l’a souvent expliqué : il a écrit Le Dahlia Noir pour exorciser le traumatisme qu’il garde de l’assassinat de sa mère alors qu’il était enfant. Dans chaque femme qu’il décrit, il y a un peu de sa mère. Peu de femmes échappent à la règle sordide de James Ellroy. Les femmes fortes et solides, comme Kay, sont rares et d’autant plus précieuses. Dans la même veine de catharsis, les figures paternelles ne sont pas des exemples à suivre. Les pères ou substituts (maquereaux, chefs de police, magistrats, etc.) sont manipulateurs, menteurs et habiles dissimulateurs. De la grande comédie du monde, James Ellroy semble dire que peu méritent d’êtres sauvés.
Des personnages récurrents prennent place dans le récit et se développent au fil des volets. Ellis Loew est un adjoint au procureur qui magouille en beauté pour être élu procureur. De l’avis des agents du L.A.P.D., « c’était un requin de Juif magouilleur, un homme de loi et un sacré fils de pute. » (p. 31 – Le Grand Nulle Part). Mickey Cohen amorce une trajectoire descendante : de premier gangster de la ville, il n’est plus rien au sortir de la prison. Incapable de récupérer son empire, il va de désastres financiers en humiliations alors que ses bras droits sont assassinés les uns après les autres. Enfin, il y a Dudley Smith : il est le seul flic du L.A.P.D. à se tirer d’affaire à chaque fois.
La musique et tout particulièrement le jazz ont une place fondamentale. Le jazz est la bande originale d’une ville et d’une époque qui se cherchent. Langoureuse, mélancolique ou hystérique, la mélodie se fait obsédante à mesure que chaque intrigue progresse. ♪ ♫ Pour finir sur une note légère, j’ajoute que j’ai découvert un nouveau sens au mot « chouquette ». Je ne regarderai plus ces pâtisseries du même œil…
*****
Et voilà une seconde participation au Défi des 1000 de Daniel Fattore ! Les ouvrages comptent respectivement 505, 627, 598 et 537 pages, soit un total de 2297 pages.
