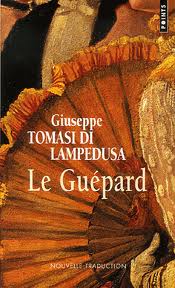
Roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
1860 en Sicile. La famille Salina est des plus illustres, des plus respectées et des plus puissantes. Féru d’astronomie, le Prince Fabrizio est un colosse qui sait jouir de la vie et qui fait honneur au symbole de sa famille, le Guépard. Fabrizio règne avec fermeté sur sa trop nerveuse épouse et sur leurs enfants. Déçu par ses fils, il reporte sur Tancredi, son neveu et pupille, toute son affection et ses espoirs pour la lignée des Salina. Convaincu que l’aristocratie sicilienne s’accommodera de la république, il déchante quand Garibaldi et ses troupes envahissent la Sicile et que l’île est rattachée à l’Italie. Pour satisfaire aux nouveaux idéaux plébéiens, Fabrizio accepte de marier Tancredi à Angelica, sublime enfant d’un parvenu. « Le Guépard, certes, le Guépard ; mais des limites devraient exister aussi pour cette sale bête pleine de superbe. » (p. 174)
Force de la nature et homme de tête, « le pauvre Prince Fabrizio vivait dans un mécontentement perpétuel, malgré son regard jupitérien courroucé, et il contemplait la ruine de sa classe et de son patrimoine sans rien faire pour y porter remède ni en avoir la moindre envie. » (p. 13) Son dernier sursaut d’orgueil s’incarne en Tancredi qui a pris fait et cause pour Garibaldi. Mais Fabrizio n’est pas le genre d’homme à s’effrayer de la mort. « Comme toujours, les considérations sur sa propre mort le rassérénaient autant que celles sur la mort des autres l’avaient troublé ; peut-être parce, en fin de compte, sa mort était en premier lieu celle du monde entier. » (p. 240) Conscient qu’une époque s’achève et que les privilèges de l’aristocratie ont disparu, il emporte dans la tombe les ors et la vitalité des Salina.
Ce magnifique roman est un hymne à la terre sicilienne et à ses habitants : « les Siciliens ne voudront jamais être meilleurs pour la simple raison qu’ils croient être parfaits : leur vanité est plus forte que leur misère. » (p. 193) Île fière qui ne s’en laisse pas imposer par la vaniteuse Italie, la Sicile allie la sensualité à la sécheresse. Dans les jardins des Salina, elle se fait superbement décadente. « De chaque motte de terre émanait la sensation d’un désir de beauté vite brisée par la paresse. » (p. 13) La richesse ravaudée et le luxe de façade qu’affichent les survivants des Salina participent de cette décadence pressentie dès les premières pages. Immédiatement, on sait qu’on touche à l’ultime frémissement d’une bête fabuleuse qui livre avec éclat ses derniers combats.
La romance entre le fougueux Tancredi et la belle Angelica est aussi éclatante qu’une aile de papillon. Chacun assiste émerveillé au spectacle et pressent qu’une telle splendeur ne peut ne durer. Le bal, dans la sixième partie, en est l’illustration parfaite. Les femmes y sont belles, le rire y est facile. Mais le petit matin ne trouve que des êtres fatigués qui font bonne figure et tentent une dernière bravade. Tancredi, enfant chéri et homme porteur de tous les espoirs, disparaît dans la fin du roman. On ne sait s’il a fait honneur aux Salina. Les six premières parties se déroulent entre 1860 et 1862. Les deux dernières font un bond en 1883 et en 1910. Le déclin de la famille Salina se précipite à la mort du grand Fabrizio. La fuite en avant du récit va de pair avec le crépuscule des illusions d’une famille et l’avènement d’une nouvelle histoire, celle de l’Italie unifiée.
Dans une langue majestueuse et foisonnante, Lampedusa déploie par touches perfides un humour acerbe et un cynisme maîtrisé. La religion, l’argent, les caractères et toutes les couches de la société sont discrètement pointés du doigt, puis férocement épinglés. L’auteur dresse des portraits sans concession : si les jeunes filles sont des fleurs enivrantes, l’âge se charge de les faner et l’auteur ne masque aucune de ses avanies. Les hommes sont moins nobles qu’avant, les sociétés moins respectueuses des traditions. Lampedusa écrit la décadence et le changement avec un talent incontestable. Le Guépard n’usurpe pas sa renommée de chef-d’œuvre et je n’ai pas boudé mon plaisir.
Il me reste à voir le film éponyme de Luchino Visconti avec Burt Lancaster, Alain Delon et Claudia Cardinal, palme d’or à Cannes en 1963.

