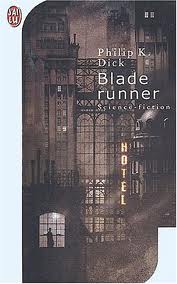
Roman de Philip Kindred Dick. Titre original : Do Androids Dream of Electric Sheep ?
Après la Guerre mondiale Terminus, la Terre est devenue une planète hostile couverte d’une poussière radioactive qui a provoqué la disparition de la végétation et des animaux et qui entraîne la pourriture de toute chose, animé et inanimé. Les humains ont émigré en masse vers les colonies spatiales, attirés par la promesse de recevoir un androïde. « Ainsi s’était effectuée l’émigration, l’androïde servait de carotte, les retombées radioactives de bâton. » (p. 21) Mais tous les humains n’ont pas quitté la Terre : les « spéciaux », qu’ils soient débiles ou contaminés par la poussière, n’ont pas le droit au rêve extraterrestre. Restent également les blade runners, comme Rick Deckard : il traque les androïdes échappés des colonies et les « réforme ». Quand six Nexus-6, des androïdes dernière génération, débarquent illégalement sur Terre et que sa route croise celle de la belle et énigmatique Rachel Rosen, Rick Deckard est confronté à d’étranges problèmes de conscience.
Sur la planète dévastée par les retombées radioactives, il est impossible ou rarissime de trouver des organismes vivants en liberté. Mais une preuve de moralité et d’humanité est de posséder et de prendre soin d’un animal. Un marché considérable et formidablement organisé s’est développé dans ce sens. L’Argus édicte le prix des animaux. Rick Deckard possède un mouton électrique et ne rêve que d’« acheter un vrai mouton pour remplacer l’imitation électrique. » (p. 8) C’est une obsession qui ne le lâche pas. Envieux de la jument de son voisin, il est comme tous les humains restés sur Terre. Il exprime une passion folle pour le vivant, pour l’animé. Les animaux électriques ne sont qu’un pis-aller vaguement honteux, mais que l’on entoure de soins onéreux. L’apparence du vivant finit par ne plus suffire. À mesure qu’il développe de l’aversion pour son métier, il se considère comme « un élément du processus entropique de destruction de la forme » (p. 105), reconnaissant ainsi que les androïdes ne sont pas que des objets animés.
Une religion nouvelle s’est développée sur Terre. Le mercerisme, via les boîtes à empathie, permet la fusion avec Wilbur Mercer, un homme qui était capable d’inverser le sens du temps. En se connectant à l’appareil, les humains entrent en communion avec le vieux père et avec tous les êtres connectés. La boîte à empathie, « c’est comme le prolongement de votre propre corps ! C’est la seule façon d’entrer en contact avec les autres hommes, quoi, de cesser d’être seul ! » (p. 74) Mais au plus fort de leur solitude, les êtres humains ne tolèrent pas de côtoyer des androïdes, aussi aboutis soient-ils. L’humanité est devenue un sésame indispensable. Le test Voigt-Kampff permet de savoir qui est humain et qui ne l’est pas en déterminant les capacités d’empathie que seules possèdent les hommes. Mais au fil des prouesses technologiques, « les androïdes [forment] désormais une section – inférieure, certes – de l’humanité. » (p. 36) Certains androïdes, auxquels ont été implantés de faux souvenirs, se prennent même pour des humains. Dès lors se pose les questions de l’identité, de l’humanité et du rapport à l’autre. Éprouver de l’empathie pour les androïdes, comme le fait le « spécial » John Isidore ou tardivement Rick Deckard, est-ce anormal ? Est-ce une forme supérieure d’humanité ?
Les journées sont rythmées par l’usage de l’orgue d’humeur et l’écoute de l’émission de l’Ami Buster. Sans cesse, il s’agit de faire cohésion, de se sentir appartenir à un tout et en éprouver de la satisfaction. Iran, l’épouse de Rick, exprime une vague rébellion à l’égard de cette démarche. Elle nourrit sans honte une dépression et refuse de se satisfaire de l’existence qu’elle mène. Elle est la première à émettre un sentiment de compassion pour les androïdes. Pour les humains, il est évident que « la faculté empathique ne peut appartenir qu’à un animal social. […] De toute évidence, le robot humain était un prédateur solitaire. » (p. 37) Or, les Nexus-6 ne sont pas agressifs. Priss Stratton, Irmgard et Roy Baty veulent surtout échapper au contrôle des hommes et mener une vie humaine normale. Mais dans ce monde en déréliction et en décomposition, il semble ne pas y avoir de place pour des formes de vie trop évoluées.
Moi qui lis peu de science-fiction, je ne peux pas comparer ce livre au reste du genre. Mais cette lecture m’a emballée et mon cœur a suivi. Il règne une tension constante dans le texte, que ce soit pendant la traque des Nexus-6, pendant les tests du Voigt-Kampff ou quand les personnages prennent conscience de certaines réalités. Le décor post-apocalyptique forme un arrière-plan discret, mais pesant. Les descriptions de la ville qui part « en bistouille » ou l’émerveillement devant la découverte d’une araignée contribuent à célébrer la vie et le mouvement. Ce roman, d’un genre réputé parfois obscur, est tout à fait accessible. Il développe avec brio des réflexions sociales et philosophiques.

Le film de Ridley Scott, qui a donné son titre aux rééditions du roman, s’est largement inspiré du texte original, mais a également fait preuve de beaucoup d’audace. L’action se passe à Los Angeles en 2019. Rick Deckard est célibataire (youpi !), il n’a pas de mouton électrique et il est bien plus désabusé que dans le livre. La ville est inexplicablement (ah les adaptations…) envahie d’une population asiatique. Rachel Rosen n’est pas une garce manipulatrice. John Isidore est remplacé par J.-F. Sébastien, un généticien au grand cœur qui se fait piéger par les androïdes. Enfin, le film fait fi du mercerisme et de l’obsession pour les animaux.
Les Nexus-6 sont sans conteste bien plus violents, surtout Roy Baty. Sa compagne est Priss, et non Irmgard, et elle est tout aussi dingue que son homme. Dans le film, les androïdes ne veulent pas vraiment vivre comme des humains, ils veulent surtout vivre plus longtemps. Ils se savent programmés pour une durée déterminée et veulent lutter contre la dégénérescence biomécanique qui les guettent.
La ville sombre, grise et pluvieuse traduit bien l’atmosphère du livre. La lumière est rare et éclaire souvent la crasse et la laideur, à tel point qu’on préfère l’obscurité. L’affrontement final entre Rick (Harrisooooon) et Roy déploie une tension haletante. Les dernières images, avec la colombe, sont d’une rare beauté, comme chaque fois que le sublime se dégage du grotesque.
J’ai vu ce film il y a quelques années et je me rappelle m’être ennuyée endormie. J’avais le souvenir d’un film lent et poussif. Je l’ai davantage apprécié hier, même si je n’ai pas pu m’empêcher de comparer le film au livre. Mais il me semble finalement que l’œuvre de Ridley Scott doit être considérée indépendamment de celle de Philip Kindred Dick. Le réalisateur, sans le dévaluer, a magnifié le livre et lui a offert une visibilité durable. Voici deux œuvres à ne pas manquer (dit-elle avec 20 ans de retard…)
