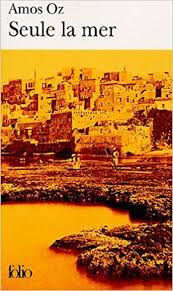
Albert Danon est veuf. Son fils Enrico est parti dans les montagnes du Tibet pour échapper au chagrin. Il y rencontre Maria, femme offerte et vieillissante, qui cherche encore un peu d’amour, elle qui en a tant donné. La petite amie d’Enrico, Dita, a écrit un scénario, mais s’est fait arnaquer par un producteur peu scrupuleux. Elle s’installe chez Albert qui lutte avec difficulté contre le désir que la jeune femme lui inspire. « Il ne peut échapper à son odeur. Son odeur sur la serviette son odeur sur les draps qui a-t-elle appelé à qui a-t-elle parlé. Son odeur dans la cuisine où est-elle où est-elle quand va-t-elle rentrer son parfum dans le couloir son parfum dans le salon son parfum avec qui est-elle sortie et qu’y a-t-il entre eux. Son parfum dans la salle de bain où est-elle et va-t-elle encore se faire avoir. Le parfum de son shampoing. Son odeur dans le panier à linge. Où est-elle. Quand rentrera-t-elle. Elle rentrera tard. En Himalaya, c’est déjà demain. Où puis-je fuir son odeur. » (p. 75) Bettine, amie d’Albert, également veuve, voit d’un mauvais œil cette jeunesse qui enflamme les sens émoussés du vieux bonhomme et aimerait retrouver la relation tranquille qu’elle avait avec lui. « Nous ne sommes pas un couple, deux personnes. Des connaissances ? Des amis ? Ou des collègues ? Plus ou moins ? Un pacte pour les jours de pluie ? Une affection crépusculaire ? » (p. 44 & 45) Doubi Dombrov, le producteur, est également affolé de désir pour Dita, mais il ne perd jamais de vue les chiffres, l’argent, la rentabilité. La voix de Nadia, l’épouse disparue d’Albert, s’élève dans les montagnes du Tibet : elle veille sur son fils, maintenant qu’elle ne peut plus être après de son époux. Autour d’eux et parmi eux, il y a le narrateur, partie prenante de l’histoire, à l’identité jamais révélée.
Seule la mer parle de désir hébété, de solitude hagarde, de bonheur inattendu, de deuil infini et d’amour ardent. Le changement constant de point de vue et la narration polyphonique ne sont pas confus. C’est comme si l’on suivait un travelling à plusieurs caméras. On reprend chaque personnage là où on l’avait laissé et on continue à l’accompagner sur son chemin. Alors que l’été s’achève et que la mer, toujours, fait entendre son chant répétitif, il s’élève de tous ces corps une folie de vivre, de ressentir et de jouir. Comme un Cantique des cantiques à mille voix, le texte est un hymne à la beauté de l’autre et de la nature amoureuse. Nombreuses sont les scènes bibliques, éternelles, dans ce roman qui mêle vers libres, poésie formelle et prose poétique. Inutile de chercher à rationaliser l’ensemble : on passe d’une forme à l’autre naturellement et sans à-coup. La lecture se vit comme une respiration, calée sur le souffle. Souffle que l’on retient quand certains morceaux très courts éclatent et éclaboussent la page de beauté et de sensibilité. Seule la mer est un texte qui se ressent, plein de saveurs et d’odeurs. Une merveille qu’il convient de ne pas ignorer.
Je vous laisse avec deux extraits d’une beauté affolante.
« Comme languit une biche auprès des eaux vives, ainsi languit mon âme. » (p. 149)
« Du matin au soir brille au-dehors une lumière qui n’a aucune idée qu’elle est lumière. Les grands arbres qui absorbent le silence n’ont nul besoin de découvrir ce qu’il constitue l’essence intrinsèque du bois. Des steppes incultes s’étendent indéfiniment sur le dos sans réfléchir à ce que leur vacuité a de pathétique. Les sables mouvants se déplacent sans demander jusqu’à quand et pour quoi. Toutes ces merveilles sont merveilleuses, mais ne s’émerveillent pas. » (p. 163)
