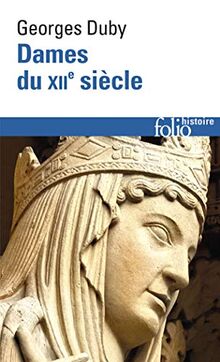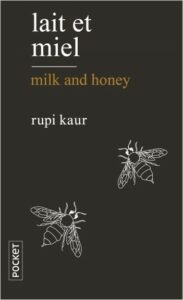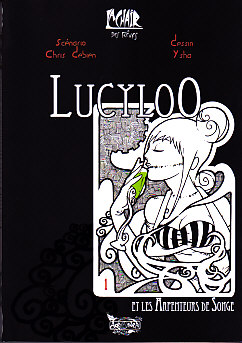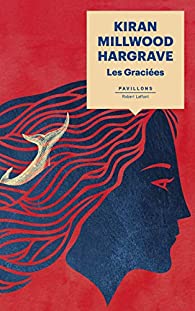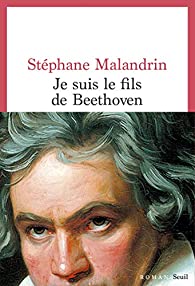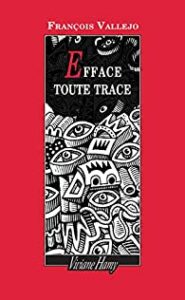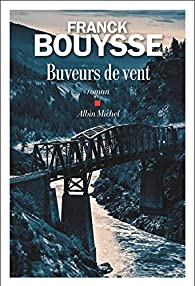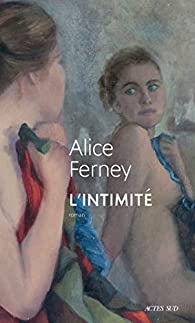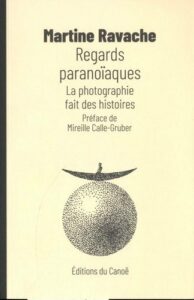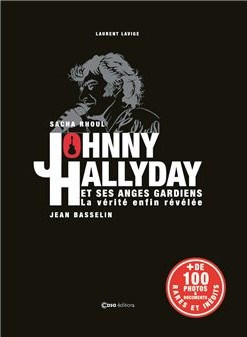
Ouvrage de Laurent Lavige, Sacha Rhoul et Jean Basselin. Avec plus de 100 photos et documents rares ou inédits.
Quatrième de couverture – On pensait que tout avait été dit ou écrit sur celui qui restera, dans nos mémoires, le plus grand rockeur français. Les « anges gardiens » de Johnny Hallyday, Sacha Rhoul et Jean Basselin, se sont replongés dans leurs souvenirs pour que la vérité soit enfin révélée. Sacha Rhoul a accompagné, nuit et jour l’idole des jeunes, de 1966 à 1983. Aux côtés du chanteur, il a tout vu, tout entendu et tout vécu de l’intérieur. Il a endossé tous les rôles pour protéger son patron, mais aussi et avant tout, son ami. Jean Basselin, quant à lui, a accompagné l’idole à partir de la fin des années 80. Le monde a changé, les mesures ont évolué, mais Johnny est resté fidèle à lui-même. Jean raconte avec sincérité tous ces moments extraordinaires passés à ses côtés. Les femmes de sa vie, les vrais et faux amis, la musique, les bolides, les accidents, les trahisons, les rencontres incroyables, les doutes et les fantômes, la vie rocambolesque qui a fait de Johnny Hallyday la légende qu’il est aujourd’hui est enfin dévoilée par ses anges gardiens. Cet ouvrage est une succession d’anecdotes toutes plus incroyables les unes que les autres. Le tout agrémenté de photos et de documents rares et inédits issus des collections privées de Sacha Rhoul, de Jean Basselin et de Claude Pierre-Bloch.
Ce livre tient autant de l’album photo que de la revue de presse ou encore de la biographie. On y trouve des unes de magazine sur la vie de l’artiste, des couvertures de disques, des images privées de la famille du rockeur, des paroles de chansons, et des milliers d’informations qui remettent en perspective la carrière du grand Johnny dans la vie musicale et culturelle de son époque. L’ouvrage laisse la part belle aux documents d’archives, car l’histoire du chanteur, on la sait déjà… Ou on croit la savoir !
« Johnny a fait de ma vie une merveille ! Même en rêve, je n’aurais jamais pu imaginer vivre le dixième de ce que j’ai vécu grâce à lui. […] Johnny, c’était un tsunami à lui tout seul. Il fallait gérer l’artiste, mais aussi, et surtout l’homme. Un mec très complexe tout en étant tellement humain. » (p. 4) Ainsi commence le témoignage de Sacha Rhoul, secrétaire particulier de Johnny Hallyday pendant plusieurs décennies. Entre eux, la relation professionnelle, sans disparaître, a laissé une part de plus en plus importante à la relation amicale, voire fraternelle. Ce que dont Sacha Rhoul peut s’enorgueillir, c’est de sa fidélité à toute épreuve pour l’artiste, et de la confiance réciproque qui s’est nouée entre eux deux.
« Lorsque tu as eu la chance de côtoyer un mec de cette envergure, la vie te semble un peu fade après. C’est un homme que j’aimais vraiment. » (p. 6) Avec ces deux phrases, c’est la pudeur de Jean Basselin qui marque le plus, celle qui habille les relations fortes, celles dont on ne peut pas traduire la profondeur.
Sacha Rhoul, Claude Pierre-Bloch et Jean Basselin discutent tout au long du livre. Ils racontent l’insouciance, les colères, les difficultés et les bonheurs. À les lire, on croit les entendre et surtout voir toute la fougue d’un artiste hors-norme. Décomposé par décennies, l’ouvrage donne à voir clairement qui était ce Johnny que l’on pense si bien connaître. En entrant dans l’intimité des souvenirs des hommes qui l’ont côtoyé de si près, on discerne bien mieux l’homme, entier, derrière le rockeur. Les auteurs racontent la carrière multicarte et les relations de Johnny Hallyday avec d’autres artistes : Édith Piaf, Raymond Devos, Bob Dylan, Michel Polnareff, Eddie Vartan, Charles Aznavour, Robert Hossein, Eddy Mitchell, Michel Sardou, etc. On revoit aussi, évidemment, la vie personnelle du chanteur : ses épouses, ses enfants, ses amis et ses adversaires. Les auteurs ne se privent pas de régler quelques comptes et de remettre les pendules à l’heure : fidèles à Johnny même après la mort !
Aucun doute à avoir : ce livre richement illustré et superbement mis en page ravira les fans de Johnny Hallyday et tous ceux qui apprécient les textes magnifiques d’un chanteur qui a marqué plusieurs générations. Parce qu’on a tous au moins une chanson de Johnny dans le cœur…