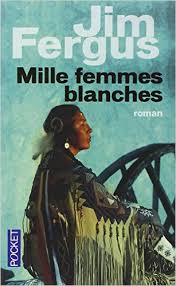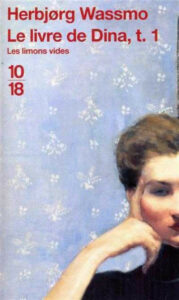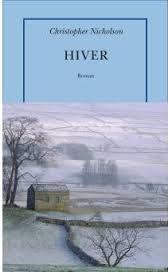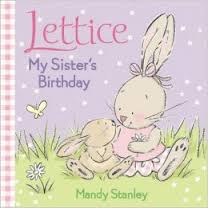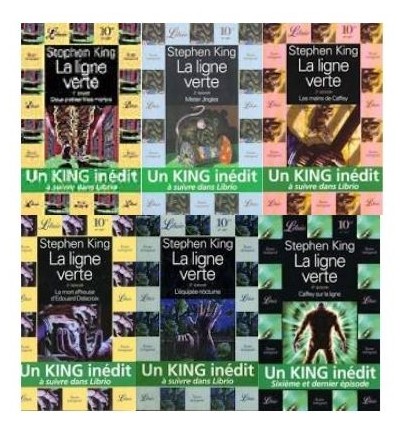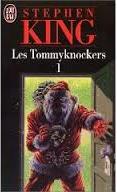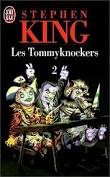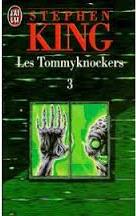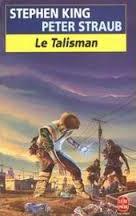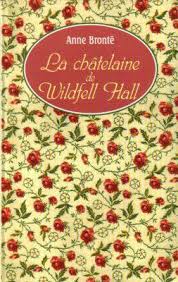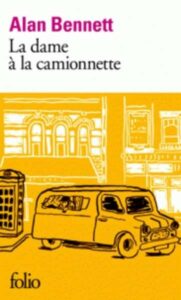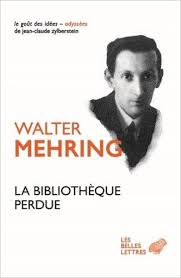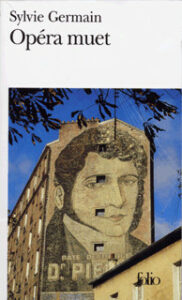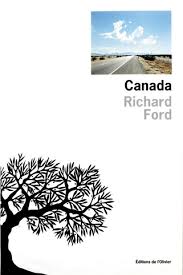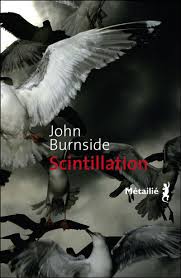Romans d’Herbjorg Wassmo.
Tome 1 : Les limons vides
Dina est-elle responsable de la mort de sa mère, ébouillantée par l’eau d’une lessiveuse ? L’est-elle aussi de celle de son époux Jacob, retrouvé gonflé d’eau dans une rivière après un accident de traîneau ? Enfant, après le décès de sa mère, puis veuve, sa seule réaction à ces drames est un silence pesant et durable. À chaque fois, on se dit que Dina est folle, qu’elle a perdu la parole pour de bon. Elle a grandi comme un animal sauvage sous le regard inconsciemment accusateur de son père. Farouche et têtue, la jeune Dina ne fait que ce qu’elle veut. « Elle avait en elle une sauvagerie qui n’était pas faite pour attirer les hommes en quête d’une épouse. » (p. 66) Ce n’est qu’auprès de M. Lorch, précepteur et professeur de musique, qu’elle gagne en sérénité. Rapidement virtuose du violoncelle et du piano, Dina n’en devient pas pour autant une jeune fille posée et délicate. Elle n’aime rien tant que chevaucher sans selle et en pantalon à travers les forêts du cercle polaire. Et si elle fait ce qu’on lui demande, ce n’est pas qu’elle se soumet, c’est qu’elle y consent. En la mariant à son ami Jacob, son père pense qu’elle va enfin s’assagir. « C’était la première fois qu’il se rendait compte qu’aucune limite n’existait pour Dina. Qu’elle ne craignait le jugement de personne. » (p. 93) Mais dans le mariage comme dans l’adolescence, Dina reste un animal gourmand, exigeant, indomptable. Dans son nouveau domaine, à Reinsnes, Dina ne fera toujours que ce qu’elle veut. « Dina de Reinsnes n’avait pas de chien, ni de confident. Mais elle possédait un cheval noir – et un garçon d’écurie roux. » (p. 152) Ce garçon, c’est Tomas et il est envoûté par sa maîtresse.
Quel souffle ! Dina est un ouragan, un cataclysme. Elle incarne les deux saisons en vigueur en Norvège, près du cercle polaire. Elle est l’hiver, sombre et interminable quand elle se tait et s’enferme en elle-même, négligeant ses devoirs et les autres. Elle est l’été, éblouissant et prolifique, quand elle saisit les rênes de son existence et devient une véritable maîtresse de domaine.
Tome 2 : Les vivants aussi
Alors que le premier tome posait la mort de Jacob Gronelv en élément liminaire pour reprendre ensuite toute l’existence de Dina jusqu’à ce drame, le deuxième volume s’ouvre immédiatement après le soudain veuvage de l’héroïne. Dina est toujours silencieuse, enfermée dans la chambre conjugale. Elle marche toute la nuit et elle boit plus que de raison. « Chaque maître avait ses lois. Les lois de Dina ne ressemblaient à aucune autre. » (p. 47) Et voilà qu’elle est enceinte ! « On racontait ouvertement que Madame Dina était à la fois enceinte, muette et peu sociable. » (p. 23) Jacob ne disparaîtra donc pas de Reinsnes. Benjamin, le nouvel héritier s’ajoute donc à Johan, le fils du premier mariage de l’armateur et aubergiste, et à Niels et Anders, ses fils adoptifs. Arrive Stine, une nourrice Lapone, qui prend soin de Benjamin et finit par s’installer définitivement à Reinsnes avec l’approbation de Dina. Il y aura finalement une maîtresse pour l’intérieur de la maison, tandis que Dina veut gérer les affaires de son défunt époux, comprendre les chiffres, pourquoi ils ne sont pas justes, suivre les caboteurs et les récoltes. « Finalement, les histoires moins flatteuses sur Dina perdirent de leur impact. On les considéra plutôt comme des traits d’originalité qui distinguaient Dina des maîtresses de maison et autres bourgeoises. Et qui faisaient d’elle quelqu’un de spécial et de fort. » (p. 133) Se remariera-t-elle, la grande et belle veuve de l’armateur ? Pour cela, il faudrait qu’elle trouve un homme digne d’elle, selon ses critères. Ce ne peut pas être Tomas, ni Johan. Peut-être Léo Zjukovkij, ce Russe qui va et vient en laissant des sillons dans le cœur de Dina.
Ici, Dina prend peu à peu sa place dans le domaine laissé par son époux. Elle rend les armes sur certains sujets, s’adoucit, mais brandit toujours son indépendance et sa volonté comme des drapeaux de guerre.
Tome 3 : Mon bien-aimé est à moi
Dina a mis à jour les comptes trafiqués : elle n’entend pas être trompée et laisse peu d’options au coupable. Qu’on se le dise, Dina est juge et maître chez elle. « C’était justement une des choses extraordinaires qu’on pouvait raconter quand on rencontrait des gens d’autres régions. Que cette grande femme, les poings sur les hanches, participait à tout. C’était ce qui faisait la différence entre cette femme et toutes les autres. » (p. 138) Mais son cœur, finalement, n’est plus à elle. Il est à Léo qui jamais ne reste. Dina l’attend et enrage de ses absences. Elle part en voyage, à sa recherche. Arrive la guerre de Crimée : Léo est russe, faut-il craindre pour lui ? Quand elle le retrouve, elle lui demande de rester. Mais voici un homme qui ne se soumet pas Dina Grolnev. « Je suis toujours là. Ne comprends-tu pas ? Je suis avec toi. Mais on ne peut pas barrer mes chemins. Tu ne peux pas être cette barrière. Il n’en sortirait que de la haine. » (p. 193) Ce que Léo n’a pas compris, lui, c’est qu’on ne résiste pas à Dina. On ne lui échappe pas, on ne la quitte pas, on ne l’abandonne pas.
Dans le dernier volume de cette trilogie, le lecteur comprend enfin l’étendue de la violence de Dina : sa force est une folie. Quand elle chevauchait son étalon noir, sans selle et les cheveux dénoués, on pouvait encore la croire seulement rebelle. Mais Dina est une lame de fond qui ravage : démiurge folle et walkyrie sans pitié, Dina traverse la littérature norvégienne moderne comme une comète.
*****
Quelques mots sur des éléments récurrents des trois tomes. Chaque chapitre s’ouvre sur un extrait de la Bible et illustre ensuite ce passage saint. Pour Dina, la Bible est le livre de Hjertrud, le grand livre noir de sa mère. Elle le lit avec ferveur, y cherchant les réponses du monde, traquant les injustes et les coupables avec la même fureur que le Dieu d’Abraham. Et quand la voix intérieure de Dina s’inscrit en italique, comme un cri ou un murmure selon son humeur, on lirait presque un nouvel évangile, fait d’intransigeance et dureté. Entourée des fantômes qu’elle porte en elle, Dina ne ploie pas sous le poids des défunts : ils sont ses conseillers et ses guides. Dina ne craint pas la mort, elle la défie crânement.
Si Dina a eu tendance à m’agacer dans les premiers temps, j’ai révisé mon jugement au fil des pages. Elle est une femme forte, blessée à jamais dans son enfance par un crime qu’elle n’a pas voulu et par le rejet de son père. Puisque personne ne voulait d’elle, elle a décidé de n’avoir besoin de personne. Dure et cinglante, Dina place ses désirs en premier et trace son chemin dans un monde encore peu ouvert aux femmes.
Que j’ai hâte maintenant de lire Fils de la Providence et L’héritage de Karna, quatre textes qui font suite au Livre de Dina !