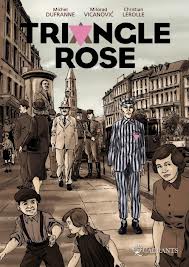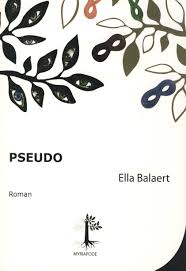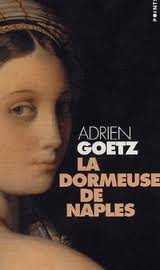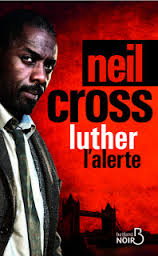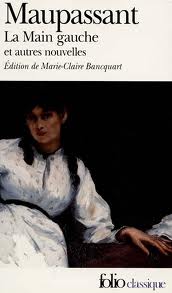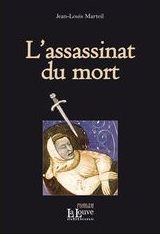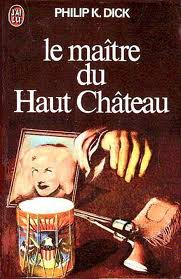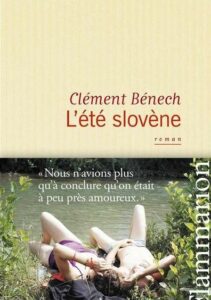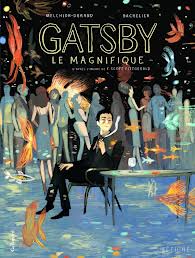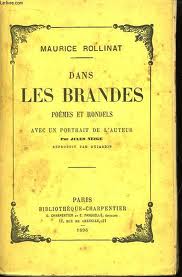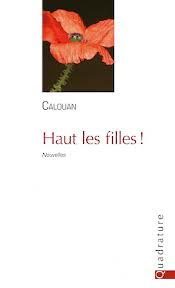Au terme de son existence, Pip raconte son histoire. Orphelin, il a été élevé par sa sœur, l’acariâtre et brutale épouse du forgeron du village, le brave Joe. « Je crois que ma sœur me considérait vaguement comme un jeune délinquant qu’un accoucheur de la police avait saisi le jour de ma naissance et délivré entre ses mains afin qu’elle me traitât selon la majesté outragée de la loi. » (p. 33) Mais l’enfant n’est pas malheureux : il accepte cette vie et ne forge pas de projets pour la quitter.
Le destin de Pip est scellé le soir où il rencontre un forçat évadé qui lui demande une lime et des vivres. Le jeune garçon répond favorablement à cette demande, mais le fugitif est repris par les forces de l’ordre. Quelque temps plus tard, Pip est invité par Miss Havisham, une femme à moitié folle qui vit dans les lambeaux de sa robe de mariage, après des noces avortées. Dans le mausolée vivant qu’est Satis House, Pip rencontre Estella, une jeune fille recueillie et élevée par Miss Havisham. L’enfant tombe immédiatement amoureux d’elle et désormais, son morne destin d’apprenti forgeron lui fait horreur. Il sent grandir en lui des aspirations et des ambitions nouvelles. Il voudrait devenir un Monsieur pour s’élever à la hauteur de la fière et froide Estella.
Le sort se charge de répondre à ses attentes. Un jour, Pip apprend qu’un mystérieux donateur lui lègue une forte somme d’argent. Le jeune garçon ne doit jamais essayer de découvrir l’identité de son bienfaiteur tant que celui-là ne se manifestera pas. Mais Pip en est convaincu : c’est Miss Havisham qui veille sur lui et qui met à sa disposition les moyens nécessaires à sa réussite sociale, afin qu’il devienne digne d’Estella. « Elle avait adopté Estella, elle m’avait presque adopté moi-même, elle ne pouvait donc manquer d’avoir l’intention de nous réunir. » (p. 248) Porté par de grandes espérances, Pip mène une vie dispendieuse à Londres, escortant Estella quand elle se rend dans la capitale et ne cessant de spéculer sur son bonheur futur avec l’élue de son cœur. Hélas, les rêves de Pip se briseront sur des desseins plus sombres : « Cette fille est dure, hautaine et capricieuse au dernier degré, et Miss Havisham l’a élevée pour tirer vengeance du sexe masculin tout entier. » (p. 190)
Je voulais lire ce roman depuis très longtemps, mais j’ai trouvé ma lecture bien longue. Je pense que cela tient essentiellement à la traduction qui date de 1935 : la lourdeur de certaines phrases est insupportable. Et j’ai aussi souffert de quelques longueurs dans le récit : Dickens se plaît à dépeindre dans les moindres détails les atermoiements de son héros, jusqu’à l’écœurement. Mais ce roman reste très plaisant et la réflexion sociale qu’il développe est très intéressante. L’auteur pose le postulat qu’un haut statut social ne fait pas le bonheur de l’homme et ne le rend pas meilleur. En voulant s’élever au-dessus de sa condition et en rejetant les êtres de son modeste passé, Pip ne nourrit en fait que des espérances vaines et vaniteuses. Le statut de forgeron, pour modeste qu’il soit, lui aurait apporté plus de sérénité et moins de souffrances. Le roman est donc le tableau de la lutte constante entre le paraître et l’être. Quand tous les masques sont enfin tombés et que les sombres liens entre les hommes ont été révélés, Pip n’est pas plus heureux et il prend la mesure de ce qu’il a perdu.
Cette lecture reste donc une bonne expérience. Mais dans le style des destins contrariés et mystérieux, je préfère la plume de Thomas Hardy dans Tess d’Urberville ou de Wilkie Collins dans Secret absolu ou Armadale. Il y a longtemps, j’ai vu l’adaptation d’Alfonso Cuaron, avec Robert DeNiro, Ethan Hawke et Gwyneth Paltrow : le réalisateur a modernisé l’intrigue et la fin est bien différente de celle du roman. Il me reste à voir la récente minisérie produite par la BBC, chaîne qui s’y connaît pour adapter les classiques de la littérature anglaise.