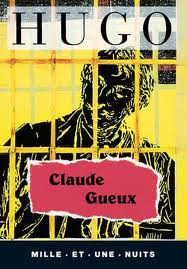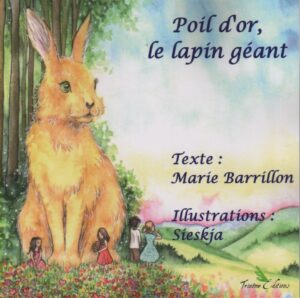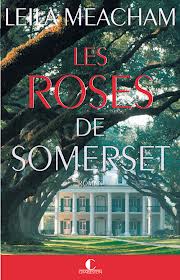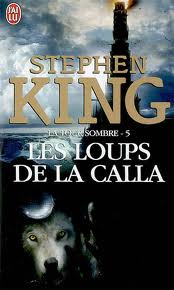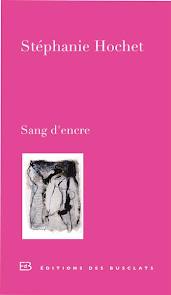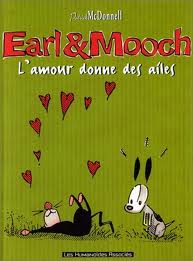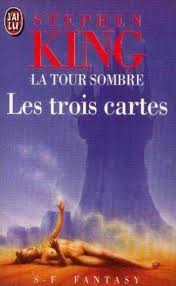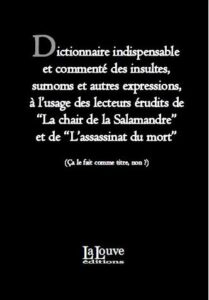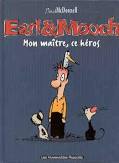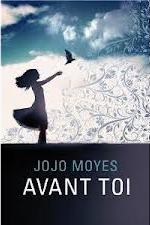Roman de Victor Hugo.
Résumer cet énorme roman est chose impossible ! Disons simplement que Gwynplaine est un enfant abandonné. Une froide nuit d’hiver, il a sauvé un bébé. Depuis, Dea et lui sont inséparables et tendrement unis. Mais le passé de Gwynplaine va le rattraper : l’homme sans cesse moqué va se voir offrir une toute autre vie, pleine d’honneur. Reste à savoir s’il en voudra.
Pourquoi est-il moqué ? Il faut vous dire que Gwynplaine est un homme défiguré. « La nature avait été prodigue de ses bienfaits envers Gwynplaine. Elle lui avait donné une bouche s’ouvrant jusqu’aux oreilles, des oreilles se repliant jusqu’au nez, un nez informe fait pour l’oscillement des lunettes de grimacier et un visage qu’on ne pouvait pas regarder sans rire. » (p. 349) Au 17e siècle, le commerce des enfants allait bon train et était encore plus lucratif quand la marchandise était défigurée pour créer de vilains bouffons. « Cela faisait des êtres dont la loi d’existence était monstrueusement simple : permission de souffrir, ordre d’amuser. » (p. 81) Gwynplaine est l’Homme qui rit : il arbore à jamais un sourire figé, taillé dans sa propre chair. « Vous masquer à jamais avec votre propre visage, rien n’est plus ingénieux ? » (p. 85) Dès qu’il apparaît, la foule éclate de rire devant son visage contrefait.
Il faut aussi vous dire que Dea est aveugle. Cette infirmité non défigurante la coupe du monde, mais lui ouvre le cœur. Pour elle, Gwynplaine est unique, parfait, absolument beau. Et Gwynplaine est à genoux devant la beauté parfaite de Dea. Entre celui qu’il ne faudrait pas voir et celle qui ne voit pas, l’amour dépasse le visible.
Mais il faudrait aussi vous parler d’Ursus et Homo, un philosophe et un loup. Présentés dans le premier chapitre, ils semblent être des personnages légendaires, mais sont finalement bien réels. Il ne faut pas oublier les naufragés de l’ourque et la bouteille qu’ils ont jetée dans l’océan furieux. Et n’oublions pas Lord Clancharlie, Lord David Dirry-Moir, Lady Josiane et la reine Anne. Et aussi Barkilphedro, à la fois espion et déboucheur des flacons rejetés sur les rivages.
Gwynplaine est un personnage éminemment pathétique en ce qu’il attire la compassion. Défiguré pour faire la fortune de ses maîtres et le plaisir de la foule, il est une marionnette consciente. Le rictus figé dans sa chair est sa ressource et sa malédiction. « Il y a du consentement dans le sourire, tandis que le rire est souvent un refus. » (p. 77) « Seulement, le rire est-il synonyme de la joie ? » (p. 349) Quand Victor Hugo s’interroge sur des traditions passées, il donne un avis qui se prétend objectif, mais qui est évidemment tranché.
Le texte de Victor Hugo est un roman historique, d’amour et de cape et d’épée. Les longs développements historiques liminaires font montre du grand savoir de l’auteur, mais également de sa maîtrise du récit. Tous les faits et toute cette matière historique sur l’Angleterre se mettent en place et se tiennent. « À tout fait se rattache un engrenage. » (p. 530) L’homme qui rit est une fabuleuse cornu copia littéraire, mais également un roman un peu fou. Par ailleurs, Victor Hugo ne se contente pas de parler de l’Angleterre ou de renvoyer à l’histoire française ou antique : il ironise souvent et critique sans vergogne. Sous sa plume, le sarcasme est érudit et les anecdotes historiques illustrent à merveille ce qui peut aussi se lire comme un virulent traité politique et social.
L’homme qui rit est un pavé, mais c’est un chef-d’œuvre ! Oubliez le nombre de pages et laissez vous prendre à l’étrange sourire de Gwynplaine. J’ai manqué les projections de la dernière adaptation cinématographique, mais ça ne me désole pas tant que ça. Je trouvais l’acteur choisi pour incarner Gwynplaine bien trop jeune premier pour ce rôle : reportez-vous à la description qu’Hugo fait de son personnage et vous comprendrez.