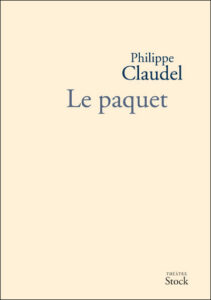
Pièce de Philippe Claudel.
Un homme soliloque sur une scène. Il traîne derrière lui, avec lui, contre lui, un paquet qui semble lourd et dont la forme massive rappelle celle d’un corps. Dans une adresse au public et au monde, il raconte avec précipitation une vie, sa vie, toute une existence qui semble réussie mais dont le récit recèle des failles étonnantes.
Cette pièce n’est pas une tirade. Le discours s’interrompt pour laisser place à de longs effets visuels pendant lesquels le personnage s’affaire sur son paquet sans que jamais on ne puisse voir ce qu’il contient. Est-ce l’épouse de cet homme seul? Ou la noirceur du monde? « Moi j’ai seulement pris tout ce qui traînait, nos bassesses, nos veuleries, nos promesses reniées, toute la laideur du monde et celle de nos actes, et j’en ai fait un gros paquet. » (p. 80)
L’homme se livre avec frénésie à une relecture de sa vie. Après une litanie de mensonges sur sa réussite professionnelle et sociale, il dévoile ses faiblesses et ses échecs. Se dessine alors le récit d’une vie fantasmée qui emprunte à L’assommoir et à Germinal un peu de leur puissance pour nier la médiocrité et la solitude.
Entre des phrases toutes faites aux allures de slogans publicitaires, des listes de faits divers, des réclames ou des morceaux de recettes culinaires, le discours s’emballe, esquisse des sujets, les abandonne et les reprend. Il semblerait que ce qui compte, ce n’est pas ce qu’on raconte, mais pourquoi on le raconte. L’homme se vide devant un public silencieux. Teintée d’un peu de psychanalyse de comptoir comme celle que l’homme trouve auprès de Roger Freud, son analyste, l’histoire débitée sur le ton saccadé et assourdissant d’une émission télévisée est un exutoire, un déballage salutaire, une confession voire un testament. L’homme débite tout, abandonne tout et peut s’en aller.
La force d’un pays se mesure-t-elle à la taille de son principal dirigeant? C’est ce que l’homme sous-entend: « Nous fûmes grands jadis, et de cette grandeur dont les échos ébranlaient les peuples lointains et les terres envieuses, il ne reste rien. Nous sommes passés, en l’espace de cinquante ans à peine, du mètre quatre-vingt-treize du Général de Gaulle aux ridicules 1670 millimètres de l’actuel résident du Faubourg Saint-Honoré. » (p.44) Mais l’homme fait aussi l’apologie des imbéciles: « L’imbécile donne de l’espoir. C’est sa mission sur terre. C’est d’ailleurs pour cela que dans bien des pays progressistes et démocrates, nous en élisons un à la tête de l’État. » (p 46) A cheval entre revendication politique, programme électoral et discours traditionaliste, le monologue est une harangue molle pour un retour aux vraies valeurs. Molle puisque personne ne vient défendre l’homme ou acquiescer à son discours.
Le soliloque s’achève sur une ultime pensée, adaptée de Blaise Pascal et de ses espaces infinis. La scène retourne au noir et au silence. Chaque lecteur/spectateur peut s’en retourner avec son paquet. J’aurais aimé assister à une représentation de la pièce. Elle a été créée par l’auteur en janvier 2010 au Petit Théâtre, à Paris. L’homme était joué par Gérard Jugnot. La performance doit être impressionnante: autant de texte, des phrases si longues, sans réponse!
Philippe Claudel a une nouvelle fois su me séduire. Sa pièce est violente, elle bouscule, elle ne peut pas laisser indifférent. Après avoir été éblouie par Le rapport de Brodeck, je suis ravie, littéralement, par cette pièce. Elle se lit à toute vitesse, et elle doit être relue, à la lueur des derniers aveux de l’homme solitaire.
