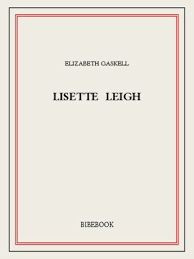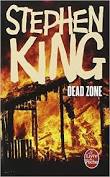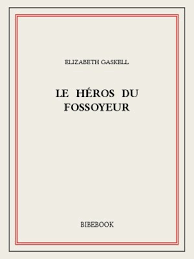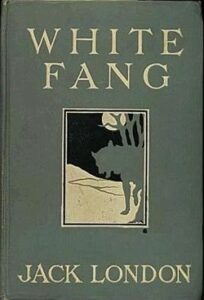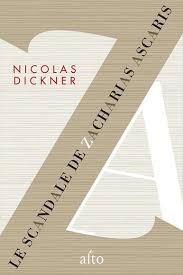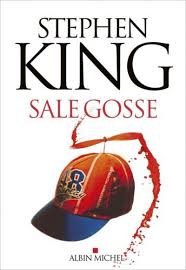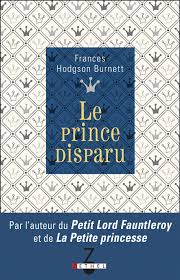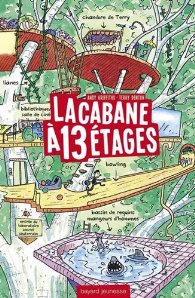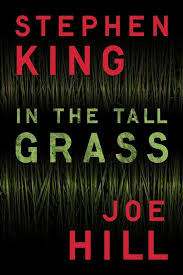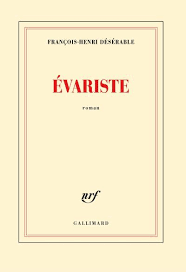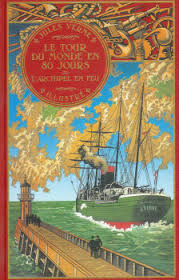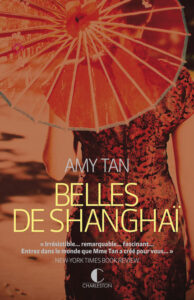
En 1905, Violet grandit dans la maison de courtisanes que tient sa mère, la belle Américaine Lulu Mimi, à Shanghai. Alors qu’elles s’apprêtent à rentrer à San Francisco, elles sont trahies par Fairweather, l’amant de Lulu Mimi : Violet est vendue à une maison de courtisanes et sa mère est convaincue de sa mort. Démunie et sans défense, la jeune fille doit désormais accepter son destin et embrasser sa condition de bâtarde. Car Violet n’est pas qu’américaine, elle est aussi chinoise par son père, un homme qu’elle ne connaît pas et qu’elle déteste aveuglément. « Quoi que je fisse, j’avais peur du père étranger présent dans mon sang. Son caractère se manifesterait-il en moi, me rendant encore plus chinoise ? Et si cela arrivait, à quel monde appartiendrais-je ? Que me serait-il permis de faire ? Qui aimerait une fille à moitié haïe ? » (p. 60) Soutenue par Citrouille Magique, une ancienne fille de la maison de sa mère, Violet apprend l’art des courtisanes, entre séduction et négociation. « L’important, c’est un mélange de stratégie, de ruse, d’honnêteté, de patience et la volonté de profiter de la moindre opportunité. Une fille doit surtout être prête à faire à tout moment ce qui est nécessaire. » (p. 183) Rapidement, Violet devient une des courtisanes à la mode et nombreux sont les hommes qui passent dans son existence. Pour certains d’entre eux, comme Loyauté, Edward ou Perpétuel, elle bouleverse son existence. Elle perd des êtres chers à cause de la grippe espagnole, sa fille lui est enlevée et sa vie rencontre sans cesse des obstacles plus insurmontables les uns que les autres. Mais Violet est opiniâtre : elle veut garder son destin en main, quels que soient les sacrifices.
La première moitié de ce roman est tout à fait plaisante : c’est une romance qui tient ses promesses, avec des sentiments contrariés, des héros superbes et des péripéties bien rythmées. Hélas, trop de drame étouffe le drame : ce roman est long, beaucoup trop long, et il devient difficile de maintenir la crédibilité de l’héroïne ou d’accepter ce qui lui arrive sans hausser les sourcils et soupirer bruyamment. Violet semble régulièrement faire les mauvais choix, mais ce n’est pas le plus agaçant : sa propension à se plaindre et à reporter la responsabilité des choses sur les autres est rapidement insupportable. « Jeune Américaine kidnappée, j’étais prisonnière d’une livre d’aventures dont on avait arraché les derniers chapitres. » (p. 136) De plus, si je peux concevoir la jalousie chez une femme amoureuse, celle de Violet confine à l’hystérie alors même que son premier amant ne lui a jamais rien promis. L’héroïne n’entend que ce qu’elle veut et se plaint ensuite d’être peu ou mal aimée, que ce soit par ses amants ou sa famille. « Accepte l’amour quand on te l’offre, Violet. Retourne cet amour et non des soupçons. Alors, tu en recevras encore davantage. » (p. 226)
Ce roman m’a rappelé ceux de Lisa See : il y est question de femmes aux destins plus ou moins tragiques sur fond de romance contrariée et de Chine qui change de visage. Ici, à Shanghai, tout bouge après l’abdication de l’empereur : les Chinois essayent de garder la main sur leur nation alors que les Japonais et autres étrangers s’installent de plus en plus dans les affaires du pays. Belles de Shanghai est un roman plaisant qu’il faut prendre pour ce qu’il est, à savoir un divertissement sans grande profondeur dont je ne garderai probablement pas beaucoup de souvenirs.