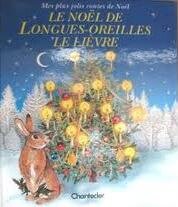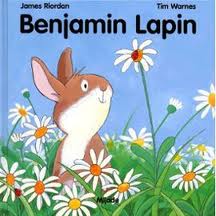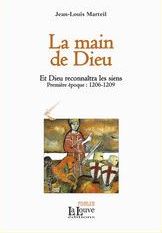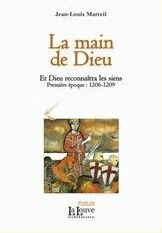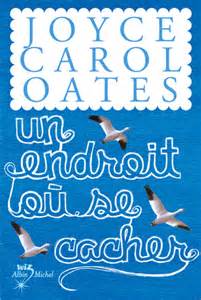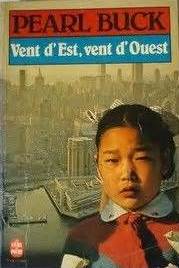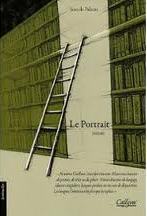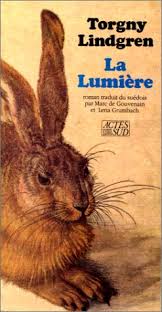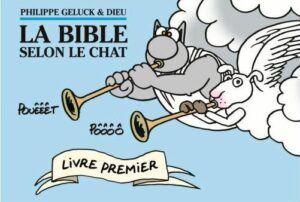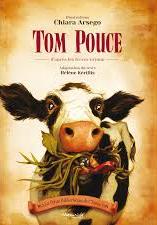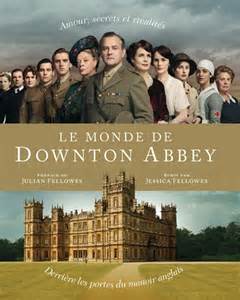Roman de Henri-Frédéric Blanc.
C’est le réveillon de Noël. Radock, ancien marin et pochard notoire, est expulsé de son domicile. Tout au long de la journée, il va errer dans Paris, chercher quelqu’un pour lui payer un verre, écouter des histoires étonnantes et rencontrer des personnages hauts en couleur.
Ce résumé vous paraît anormalement court par rapport à ce que j’ai l’habitude de produire ? C’est normal : ce roman est très difficilement racontable. C’est une suite de rencontres et de monologues aux allures de logorrhées. La langue est familière et joue abondamment avec l’oralité et l’argot, mais on ressent une aisance et une parfaite maîtrise des mots. Le ton est volontiers cynique, voire féroce et le narrateur s’en prend à l’économie, à l’art, à la société et égratigne à plusieurs reprises les esprits bien-pensants, petit-bourgeois et bourgeois bohème. Radock a un don pour faire parler les gens bornés qui se plaisent à exposer des raisonnements foireux dont ils ne démordront jamais. Ajoutez des noms d’oiseaux qui fusent si nombreux et si réguliers qu’on pourrait chanter une nouvelle chanson, dans le genre « Ouvrez, ouvrez la cage aux gros mots ». Cela dit, c’est normal, quand on s’appelle Radock et qu’on est un marin imbibé de whisky, il faut faire honneur à son homonyme de phylactères !
Vous voulez une réflexion bien sentie sur la soupe que les librairies nous vendent à toute force ? En voici une pas piquée des vers ! « Là, rayon littérature allégée : 0 % de matière grise, 0 % d’idées, 0 % d’esprit critique : des best-sellers dorés, brillants comme des boîtes de chocolats. Robinets de mots pour passer le temps, détendre le cerveau, aider les vieilles dames à digérer, entre la compote biologique et la tasse de tilleul. Piles babéliennes de merdo-littérature. Montagnes de non-livres se dressant avec majesté dans les plaines de la Bêtise. » (p. 34)
Votre truc à vous, c’est plutôt les dialogues loufoques et hilarants ? J’ai ce qu’il vous faut, ma bonne dame. Il y en a un peu plus que prévu, je vous le laisse, ça va de soi. « Verbeck. – Votre bêtise adjutantesque constituera toujours pour moi un inépuisable objet de fascination. / Ducruchet. – Dites donc… Vous insultez un ancien fonctionnaire… / Verbeck. – Non seulement je vous ai insulté, mais je récidive, je redonde et je réitère : vous êtes une patate tardive. » (p. 97)
Vous, je vous vois venir, vous cherchez à comprendre le pourquoi du comment du titre ! Voilà, voilà, ça vient, poussez pas derrière ! « Le lapin, c’est la Bête du Jugement dernier, le destructeur des mondes, l’animal final décrit dans l’Apocalypse de saint Jean : « Alors je vis la bête des bêtes se lever sur la terre et elle avait deux longues oreilles et agissait comme un dragon, et elle fit des prodiges d’horreur. » / Et pourquoi le saint Jean en question, il n’a pas écrit simplement « lapin » ? / En Palestine, on ne connaissait pas le lapin, il n’existait aucun mot pour le désigner. » (p. 119)
Ah, vous, vous aimez quand on est politiquement incorrect ! À la vôtre ! « La seule manière de rentabiliser le tiers-monde, c’est d’en faire une réserve gratuite d’images chocs ! » (p. 179)
Vous, vous préférez les auteurs maudits qui se tirent une balle dans le pied ? Asseyez-vous et profitez du spectacle. « Le lapin exterminateur, du Grand Méchant Blanc, le roman qui donne le coup de grâce à la littérature ! Déjà cinquante-huit lectures frappés de crise cardiaque, dont 46 en âge de reproduire ! » (p. 100)
Si vous aimez l’humour noir quand il visite le théâtre de l’absurde, il faut lire Le lapin exterminateur et vous en payer une bonne tranche. Si vous êtes shocking dès qu’on fait un pet plus haut que l’autre, passez votre chemin. Je ne me l’explique pas vraiment, mais j’ai fabuleusement aimé cette lecture !