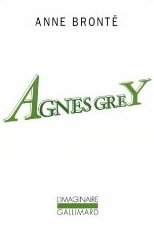
Roman d’Anne Brontë.
Fille de pasteur, Agnes Grey a grandi avec sa sœur Mary dans l’amour de parents attentifs et dévoués. Quand Mr Grey se retrouve ruiné à la suite d’un mauvais placement, Agnes décide de prendre une place de gouvernante et de reverser ses maigres subsides à sa famille. Pleine d’espoir et de ferveur quant à sa profession, elle manque de désespérer après avoir servi dans la famille Bloomfield où les enfants sont des monstres et dans la famille Murray où les filles ont bien plus de défauts que de grâces. Mais soutenue par sa foi et sa famille, Agnes endure les difficultés du métier. Elle trouve sa joie en peu de choses et place beaucoup de rêves en la personne de Mr Edward Weston, un pasteur au caractère en tous points conforme au sien.
Ce que j’aime avec ce genre de roman, c’est que tout est clairement posé dès le début. Agnes livre les pages de son journal dans un but didactique: « Mon dessein en écrivant les quelques pages qu’on vient de lire n’était pas de distraire mais d’instruire ceux qu’elles peuvent intéresser. » (p.57) Avec toute l’assurance que lui donnent son éducation et son expérience, elle dit clairement qu’elle va dresser une liste d’exemples affligeants à ne pas suivre, exemples qu’elle oppose à sa propre existence. Le soin qu’il faut apporter à l’éducation des enfants en général et des filles en particulier est un souci constant dont elle ne cesse d’avoir conscience.
Tout le puritanisme protestant possible est à l’œuvre dans ce texte. Il n’est question que de vénérer le Seigneur et ses bienfaits, de ne pas céder aux tentations, de ne pas être coquette, d’être modeste, de pratiquer l’économie et la charité, etc. Ce texte est fortement autobiographique: même enfance, même expérience, etc.
Peu de choses à dire sur la forme. Le récit est à la première personne du singulier, les digressions sont longues et permettent des envolées moralisatrices ou sentimentales. Tout reste de bon ton, jamais un mot plus haut que l’autre, jamais une pensée déplacée.
Anne est peut-être la sœur Brontë dont j’apprécie le moins la plume, mais ce texte reste un plaisir à lire! S’il lui manque le romantisme consensuel de Jane Eyre ou la rudesse passionnée des Hauts des Hurlevent, le roman de la moins connue des sœurs Brontë s’inscrit dans le courant littéraire protestant du 19° siècle britannique sans y faire mauvais effet.
