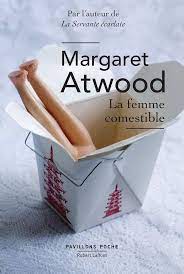
Roman de Margaret Atwood.
Marian est une trentenaire encore célibataire dans les années 70. Elle travaille pour une société de sondages et vit en collocation avec Ashley, jeune femme libérée bien décidée à avoir un enfant toute seule. Entre son métier peu épanouissant et sa relation amoureuse dans une impasse avec Peter, elle vit calmement, sans trop s’interroger sur ses désirs. Quand Peter la demande finalement en mariage, durant la longue période de ces fiançailles plus raisonnables que passionnées, Marian se sent peu à peu dépossédée de ses décisions. Sa rencontre avec Duncan, jeune homme instable, achève de perturber le fragile équilibre de son existence. « Le refus que son corps opposait à certains aliments l’irritait de plus en plus. » (p. 330) Prise au piège, étouffée par une angoisse croissante, Marian se dissocie d’elle-même, au point que le récit qu’elle portait à la première personne passe à la troisième personne. Peut-elle reprendre le contrôle de son corps et du cours de sa vie ? « Elle eut peur de se dissoudre, de se défaire, couche par couche, tel un bout de carton au milieu d’une flaque dans un caniveau. » (p. 406)
Avec son premier roman, Margaret Atwood ouvre une réflexion sur des thèmes qu’elle ne cessera de creuser dans son œuvre. Il est ici question de la passivité que les hommes attendent des femmes. Imaginez donc, faire des études, à quoi cela pourrait-il leur servir ? « Voilà ce qu’on récolte […] quand on donne une éducation aux femmes. Elles élaborent des tas d’idées absurdes. » (p. 291 ) La femme est aliénée par la maternité, le mariage et la société de consommation : on ne lui demande pas de réfléchir, mais d’absorber. Le corps de Marian se ferme à ces injonctions, au point de refuser la nourriture. Elle ne sera plus une bête que l’on gave et que l’on tient docile, dût-elle en mourir. « Production-consommation. Tu commences à te demander si la question n’est pas simplement de transformer un type de cochonnerie en un autre. S’il y avait bien une chose à ne pas commercialiser, c’était la pensée, mais ils arrivent à des résultats vraiment impressionnants. » (p. 264) L’autrice oppose deux types de maternité, celle qui est subie et encombrante et celle qui est décidée et méthodiquement planifiée, dans une reprise en main de l’appareil reproductif. Le roman est richement nourri de références littéraires, sociologiques, philosophiques et psychanalytiques. Il rejoint sans hésitation mon étagère de lectures féministes.
