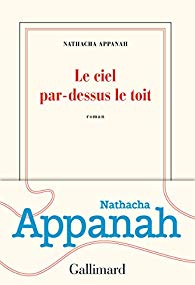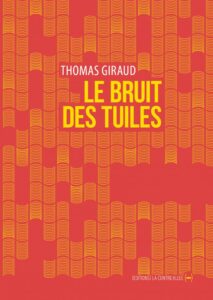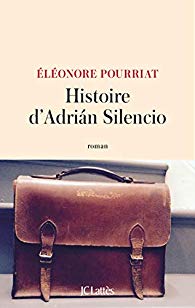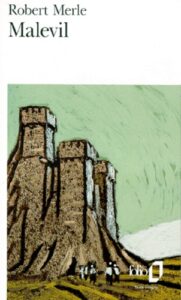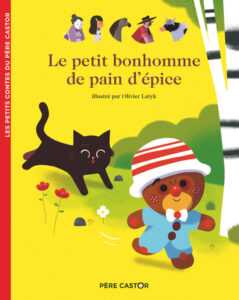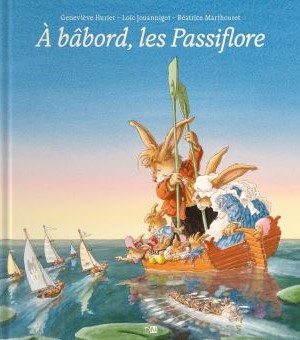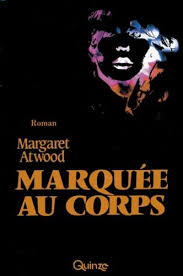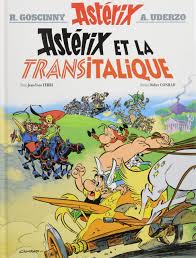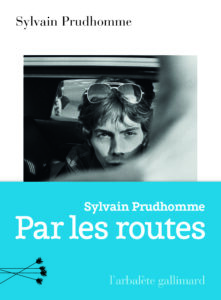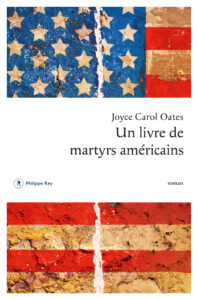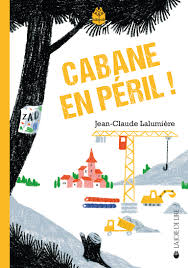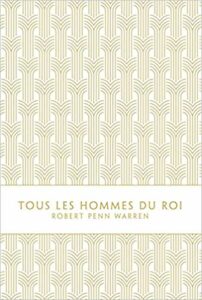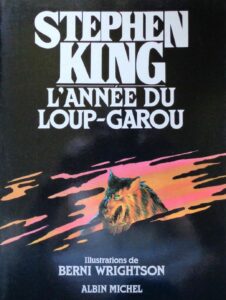Roman de Jeanne Benameur.
- Donato Scarpa, veuf inconsolé et acteur passionné par l’Énéide, et sa fille Emilia, artiste éprise d’indépendance, ont choisi de quitter l’Italie pour tenter une vie meilleure.
- Andrew Jonsson appartient à la deuxième génération des immigrés. Son père, venu d’Islande quand il était enfant, s’est construit une belle affaire à New York. Mais Andrew ne s’intéresse qu’à la photographie et passe des heures à capturer les visages des déracinés qui débarquent à Ellis Island. Celui d’Emilia le marque au cœur pour toujours.
- Esther Agakian, couturière qui sait habiller les corps pour protéger et sublimer les âmes, a quitté une Arménie où le sang de tous les siens a imbibé la terre.
- Gabor le bohémien ne s’exprime qu’avec son violon. Mais pour Emilia qui a dénoué ses cheveux pendant un instant de pure extase, il pourrait quitter la route et utiliser des mots.
- Lucile Lenbow a été élevée pour épouser un bon parti. Ce pourrait être Andrew, mais il faudrait accepter que le cœur du jeune homme batte plus fort pour une autre qu’elle.
- Sigmundur Jonsson est fier de l’empire qu’il a construit. Il lui suffit d’un repas pour comprendre que son plus bel accomplissement est son fils. Et que son héritage n’est pas économique, mais islandais, et qu’il est indispensable qu’il le transmette enfin à Andrew.
- Hazel, la prostituée qui a refusé d’être épousée par un client, s’est toujours réfugiée dans les livres. Après une dernière nuit de passe, elle décide d’accomplir enfin le projet pour lequel elle a quitté son île bleue et chaude de la Méditerranée.
D’un côté ou de l’autre de l’Hudson, ils sont une foule. Ils sont une poignée.
Après des jours de traversée, l’attente se poursuit sur le paquebot avant le débarquement, puis dans les immenses salles d’Ellis Island. L’Amérique est là, de l’autre côté de l’Hudson, mais encore inatteignable pour les débarqués qui attendent le précieux sésame. Ellis Island, ce n’est pas encore New York, et la grande ville semble aussi lointaine que ses immeubles sont hauts. Cette île d’où l’on voit la grande statue de la Liberté, c’est un peu le purgatoire des Européens déracinés : leurs péchés leur seront-ils remis ? L’Amérique sera-t-elle leur enfer ou leur paradis ?
« Que devient l’espoir lorsqu’on est parqué en longues files d’attente à l’intérieur d’un bâtiment ? » (p. 77) Une journée, une nuit et enfin un matin, c’est l’unité de temps pendant laquelle on s’attache aux personnages. En si peu de moments, on vit d’intenses éclairs de désirs, des passions fulgurantes qui hurlent des promesses d’impermanence. Chacun nourrit en son cœur des aspirations et des ambitions. Ce qui se joue en une nuit décidera de toute une vie.
Avec les personnages qu’elle tisse tout en finesse et en profondeur, Jeanne Benameur interroge l’identité de celui qui laisse tout derrière lui. « Les hommes cherchent leur vie ailleurs quand leur territoire ne peut plus rien pour eux, c’est comme ça. Il faut savoir préparer les bateaux et partir quand le vent souffle et que les présages sont bons. Tarder, c’est renoncer. » (p. 19) Quand cesse-t-on d’être un émigré pour appartenir à la terre où l’on a décidé de poser sa vie ? Existe-t-il une aristocratie des immigrés, héritée des passagers du Mayflower ? Une hiérarchie tacite et implacable ? Comment expliquer qu’une grande nation faite d’anciens immigrés méprise les nouveaux venus, les redoute et les trie ?
De Jeanne Benameur, je n’ai lu que Otages intimes qui, déjà, m’avait bouleversée. Cette nouvelle lecture confirme que j’ai rencontré une autrice à la plume inoubliable. Je vous laisse avec quelques extraits de ce superbe roman qui couronne la rentrée littéraire.
« On ne sait rien des vies de ceux qui débarquent un jour dans un pays. Rien. » (p. 6)
« Chacun se blottit encore dans sa langue maternelle comme dans le premier vêtement du monde. La peau est livrée au ciel nouveau, à l’air nouveau. La parole, on la préserve. » (p. 7)
« Sera-t-elle toujours quelqu’un qui ne fait pas complètement partie ? » (p. 11)
« Attendre, c’est mourir salement. Ça tue l’espérance. » (p. 50)
« La liberté, ces deux-là, sont venus la chercher ici. Mais ce n’est pas la même pour l’un et pour l’autre. » (p. 213)
Lu dans le cadre du prix Au coin de la Place Ronde 2019.