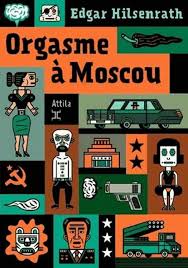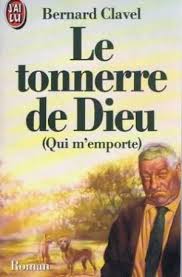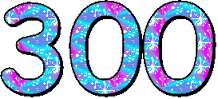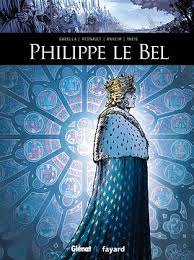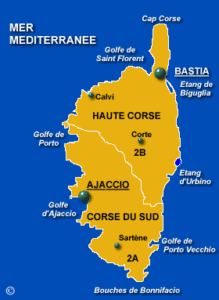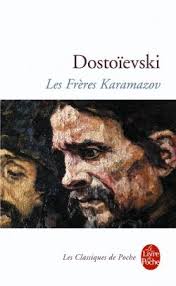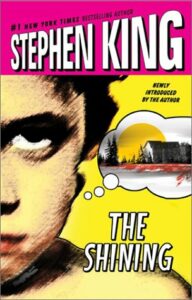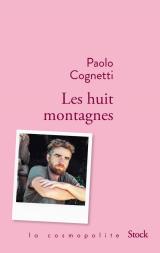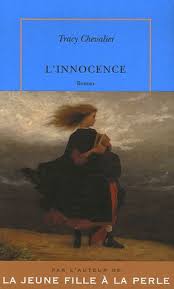David Bowie n’est pas mort est paru le 24 août 2017. Ceci est mon billet de participation aux #MRL17 organisés par PriceMinister.
*****
Le titre. C’est important, le titre, pour accrocher un lecteur. Pour lui donner envie de dépasser la première de couverture.
Le titre nous annonce prophétiquement que David Bowie n’a pas cassé sa pipe le 10 janvier 2016. Fumait-il la pipe, d’ailleurs ? Aucune idée. Je suis fan de l’artiste, mais ça, je ne le sais pas.
Le titre, donc, fait espérer du Moonage Daydream, du Cygnet Committee, du Bewlay Brothers, du Please, Mr Gravedigger et tant d’autres merveilles chantées par Ziggy Stardust, The Thin White Duke, Halloween Jack ou toutes les apparences revêtues par l’immense et tristement disparu David Bowie.
Le titre est menteur. De David Bowie, on ne voit la couleur que dans le dernier petit tiers du roman. La première partie raconte la longue journée qui suit la mort de la mère. La deuxième se concentre sur les heures interminables et confondues qui s’enchaînent après la mort du père.
Le titre ne promet pas une biographie : c’est un immense fantasme de fan. Il ne dit rien du ressentiment égal nourri par Anne, Hélène et Émilie à l’égard de leur mère, femme à la fois trop stricte et trop fantasque, trop peu maternelle et si peu amicale.
Le titre ne dit rien non plus de l’histoire du père, émancipé d’une première épouse invivable, heureux en secondes noces et père attentionné d’une quatrième enfant. Hélène est proche de lui et se fait une fierté de l’aimer plus qu’elle n’aime sa mère.
Le titre assure que l’artiste polymorphe ne peut pas disparaître tant que ses chansons tournent sur les mange-disques et que ses mélodies font ressurgir des souvenirs que l’on croyait perdus. Hélène comprend le lien qui l’attache à son aînée quand David Bowie disparaît.
Le titre annonce un espoir fou. Le texte n’est finalement qu’une longue litanie qui manque de tendresse sur les considérations acariâtres d’une femme qui, après des années à ne pas avoir aimé sa mère, se cherche des excuses et se rattrape aux branches d’un arbre familial qui manque d’eau. Il est certain que David Bowie n’aurait pas fait une chanson de tout cela.
Le titre est accrocheur, mais finalement pauvrement racoleur. De certains livres, il faudrait parfois s’en tenir à cela. Ici, il faut réécouter toutes les chansons de David Bowie, jusqu’au bout et en boucle, et oublier la fade déception de cette lecture.
David Bowie n’est pas mort, pas pour moi, mais le titre du roman de Sonia David enfonce hélas quelques clous dans son cercueil. « À quoi est-on certain qu’une personne est morte ? À ce qu’elle n’aura jamais, absolument jamais, l’occasion de lire le troisième tome de la trilogie d’Amitav Ghosh. » (p. 57) Voilà sans doute le seul point vraiment triste de ce roman : je suis certaine que David Bowie, s’il a lu l’œuvre de Ghosh, l’appréciait profondément.