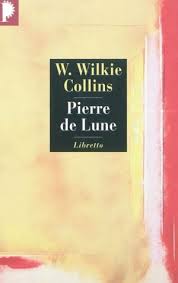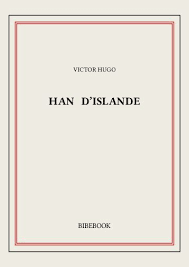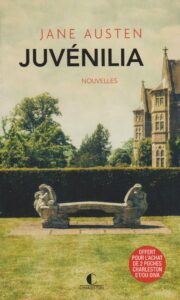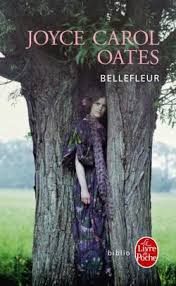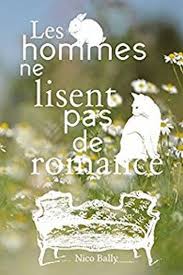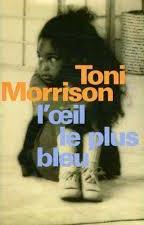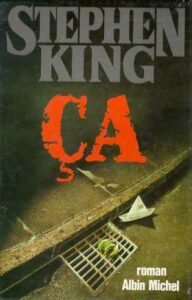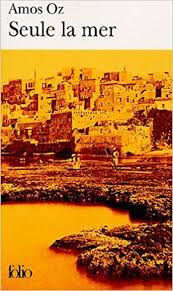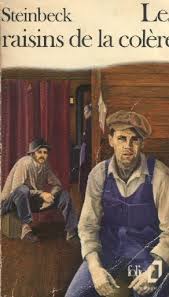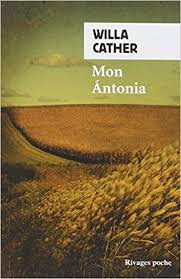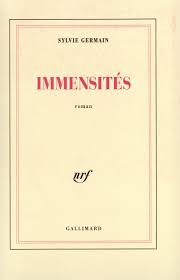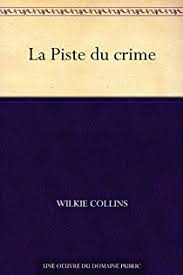
« Ils en ont fini avec les objections. Ils se sont souvenus enfin que j’étais majeure, et que je pouvais choisir mon mari moi-même. Mais ils ont insisté pour me faire renoncer à vous, Eustache. » (p. 15) Après des fiançailles très rapides, Valéria a tenu tête à son entourage et a épousé Eustache Woodville, l’élu de son cœur. Mais après quelques jours de mariage, elle découvre que le passé de son époux est chargé d’un terrible secret. Mais personne, et Eustache le premier, n’accepte de lui révéler ce sinistre événement. Torturée par les doutes et les questions, Valéria veut faire la lumière sur l’histoire d’Eustache. « Tout ce que mon mari fait et que je ne comprends pas me paraît suspect. » (p. 47) Quand enfin elle découvre la tâche qui salit le nom et l’honneur de son mari, Valéria est déterminée à faire innocenter Eustache. « L’homme qui vous a trompée et abandonnée, vous l’aimez encore ? / Je l’aime plus tendrement que jamais. » (p. 123) Le jeune couple surmontera-t-il l’accusation et la honte ?
Entre Londres et l’Écosse, au gré de révélations, de comptes-rendus de procès et d’aveux, l’intrigue s’amuse à nouer des fils trompeurs, puis à les dénouer avec finesse. Ce roman se déroule avec fluidité, comme tout bon texte publié en feuilletons, avec un suspense accru par le découpage des chapitres. La piste du crime est une histoire efficace et plaisante, qui se lit sans déplaisir, mais dont je doute de garder un souvenir très marqué.