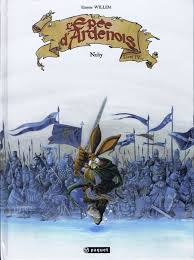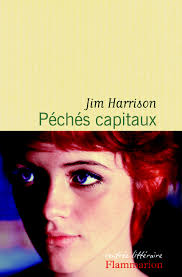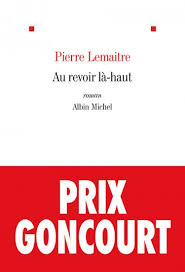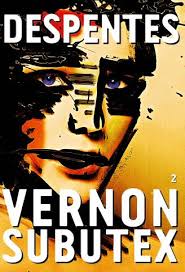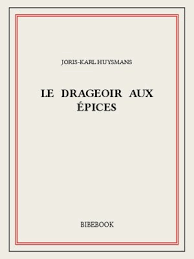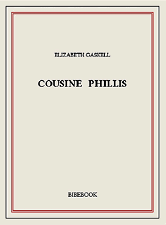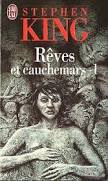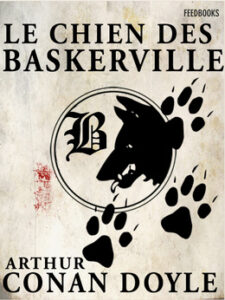Roman de Marie Laberge. À paraître en mai chez les éditions Stock.
« Le 26 avril 2000, Sylvain Côté s’enlevait la vie. Il avait vingt-neuf ans. Si on lui avait dit combien de gens il marquerait par son geste, il ne l’aurait pas cru. » (p. 11) Après ces premières phrases, on pourrait s’attendre à un sombre roman sur le suicide et le deuil. Il n’en est rien. Ceux qui restent est un texte résolument humain, lumineux et riche d’espoir. Quinze ans après, des voix s’élèvent pour parler de celui qui a choisi d’en finir, un soir de printemps.
Charlène, la maîtresse de Sylvain, prend à partie ce chum qui s’est donné la mort après avoir quitté son lit. « Je t’ai-tu dit va chier ? Va chier. » (p. 36) Barmaid quarantenaire, elle ne s’attendait pas à voir débarquer le père de son amant dans son bar, ni à se lier d’amitié avec lui. Avec son parler franc (et si glorieusement québécois), elle manifeste une envie d’en découvre avec celui qui lui a brisé le cœur, mais elle ne peut dissimuler les trésors de tendresse qu’elle garde en réserve.
Vincent Côté s’interroge sur ses manquements en tant que père : n’a-t-il pas assez aimé son fils pour que celui-ci préfère la mort au réconfort que les siens pouvaient lui apporter ? « Quand ton propre enfant se tue avant d’avoir trente ans, disons que tu n’as plus beaucoup d’assurance pour dicter une conduite parentale à qui que ce soit. » (p. 26) Grâce à Charlène, il complète un peu l’image qu’il avait de son fils, mais il reprend aussi goût à l’existence. « Je ne te ferai pas subir l’odieux de me servir de toi pour justifier une incompétence à vivre. Je vais honorer la vie, je vais la choisir en toute conscience chaque jour. Je vais vivre, quel qu’en soit le prix. Je vais vivre, quel que soit le poids de mon cœur privé de toi. » (p. 165)
Muguette Côté ne s’est jamais remise d’avoir trouvé son fils, pendu dans la maison familiale. « Parfois, j’ai l’impression qu’un sabre puissant a fendu mon corps en deux. Chaque partie palpite, mais aucune n’est vraiment vivante. » (p. 31) Cette phrase de son mari s’applique aussi à celle qui, terrorisée à l’idée de perdre son époux, pensait naïvement qu’un bébé lui rendrait son mariage. En vain.
Mélanie-Lyne, la femme de Sylvain, a élevé leur fils en lui cachant la cause de la mort de son père. Surprotectrice, obsédée par la réussite et l’avenir de son garçon, elle occulte le deuil en étant une mère aux aguets, constamment inquiète. Quant à Stéphane, il a grandi sans son père, entouré de près par sa mère et son grand-père. Ressent-il un manque ? Difficile à dire. Toujours est-il qu’il se construit une existence d’homme à la marge.
Dans ces adresses au défunt, il y a des tentatives de faire enfin le deuil, des interrogations infinies et des quêtes de sens. Sylvain est cet absent qui prend tellement de place dans la vie de ceux qu’il a laissés. Colère, regrets, reproches, incompréhension, remords, culpabilité, tout cela se mêle dans les discours de ceux qui restent. « Les suicides, y nous refilent le problème. Y nous le laissent. » (p. 57) Quinze ans après la mort de Sylvain, il leur faut accepter ce décès et le fait de ne pas avoir été présents. Il leur faut aussi se pardonner et cesser de chercher des explications. « Que c’est long, comprendre le bon sens… Sortir de sa peine. Je dirais la sortir de soi. » (p. 103) Finalement, ceux qui restent finissent aussi par partir et le cercle de ceux qui se souviennent rétrécit. Sylvain ne disparaît pas, mais il change de statut : il n’est plus le suicidé, il redevient le fils, le père, l’amant, l’ami. Et peut-être aussi celui dont le chemin aurait pu être suivi par ceux qui restent. « La mort de quelqu’un qu’on aime, ça nous oblige à considérer comment on vit. À quel prix, à quel renoncement on consent. » (p. 148)
Connaît-on jamais vraiment ceux que nous fréquentons, qu’ils soient vivants ou morts ? « Sylvain s’est tué parce qu’il s’est tu. » (p. 26) Ce qui est certain, c’est que les relations humaines sont des petits miracles qui ne s’expliquent pas. Les connexions familiales, amicales et sociales résultent d’une alchimie indiscernable rare et précieuse. Quelle tendresse immense j’ai éprouvée pour Vincent, cet homme cabossé au cœur immense, avide d’aimer et de rendre grâce à l’existence. « Mon fils, mon Sylvain, je l’ai aimé. Je l’aime encore, d’ailleurs. D’un amour pétrifié par son suicide. Un amour criblé de questions, de culpabilité, d’insuffisances redoutées ou avérées. Je n’y échapperai jamais, à cette condamnation. » (p. 67)
Les dernières pages du roman confinent au sublime et vont me bouleverser durablement. J’aurais pu relever une phrase magnifique par page. « Je m’en veux quand même, parce que je voudrais tant que l’amour que j’éprouvais ait fait une différence. Mais ça ne le fait pas toujours. Et ça ne dépend pas toujours uniquement de nous. » (p. 500) Chaque mot interpelle et frappe au cœur, que l’on ait ou non fait l’expérience du suicide d’un proche. Parce qu’au-delà du suicide, ce qui reste, c’est l’absence et le vide béant qui reste à combler quand un proche disparaît, qu’il meurt ou qu’il déménage.
Pendant mon long séjour au Québec, j’ai dévoré tous les romans de Marie Laberge que j’ai trouvé à la médiathèque où je travaillais. De retour en France, j’ai eu bien du mal à trouver des textes de cette excellente auteure québécoise dont la plume sensible et juste n’est pas sans me rappeler celle de Philippe Claudel quand il écrit sur le deuil, les morts et les vivants. Ceux qui restent est sans conteste un immense roman dont je ne peux que vous recommander la lecture.