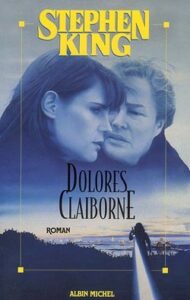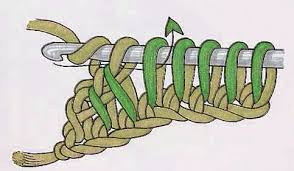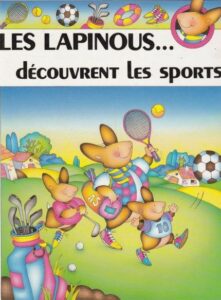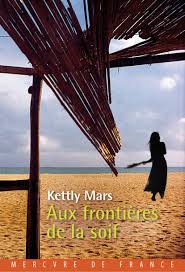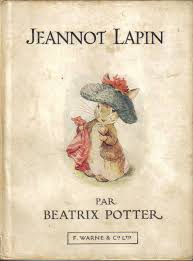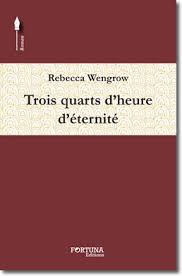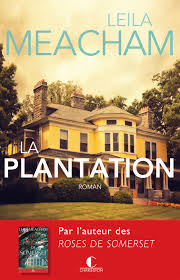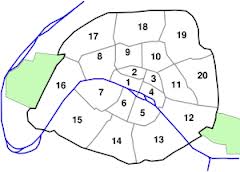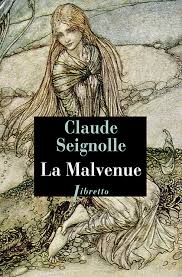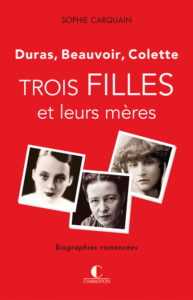Il suffit parfois d’un simple bibliobus pour changer toute une existence. Tous les lecteurs qui attendent le passage du merveilleux véhicule comprennent cela. Mais il est des lecteurs qui s’ignorent et à qui il faut une franche rencontre avec les livres. C’est ce qui arrive à Elizabeth II quand elle croise le bibliobus de Westminster. « Lire n’était pas agir. Et elle était une femme d’action. » (p. 12) Mais on peut être reine et aimer lire, même si cela s’apprend, et tant pis pour le protocole et les obligations royales ! Conseillée par Norman, son tabellion personnel qu’elle a débauché des cuisines de Buckingham, la reine lit avec avidité et bonheur. Hélas, cette passion tardive n’est pas du goût de Sir Kevin, son secrétaire particulier, ni de celui du premier ministre ou de son époux. « Lire, c’est se retirer. […] Se rendre indisponible. […] / On lit pour son plaisir, dit la reine. Il ne s’agit pas d’un devoir public. / Peut-être cela serait-il préférable, rétorqua Sir Kevin. » (p. 49) Et si l’ivresse de lecture de la reine menaçait le royaume et le pays tout entier ? Pauvre Elizabeth II, elle connaît les affres de tout lecteur dérangé et arraché aux pages délicieuses qu’il voudrait continuer de tourner.
En quelque cent pages, Alan Bennett propose une satire absolutely fabulous de la monarchie et des obligations qu’elle impose à ses représentants. Mince, à la fin, laissez la reine lire tout son saoul ! L’humour fait mouche à chaque fois et j’ai pouffé à de nombreuses reprises devant les dialogues savoureux concoctés par l’auteur. « Ce n’est pas une romancière très populaire, Madame. / Je me demande bien pourquoi. Je l’ai pourtant anoblie. » (p. 14) Même si j’ai passé un excellent moment avec ce texte, je m’interroge : la lecture demande une disponibilité certaine de la part de ceux qui la pratiquent, mais je doute qu’elle soit incompatible avec le quotidien. Certes, la routine de sa gracieuse majesté est un tantinet plus formelle que mon métro-boulot-dodo, mais il faut savoir raison garder. Quand la lecture happe son sujet au point de le soustraire à la réalité, elle ne met plus cette dernière en perspective, mais prétend prendre sa place, ce qui est au mieux contre-productif, au pire très dangereux.
Mais oubliez mes tentatives de réflexion et ouvrez sans attendre le petit roman d’Alan Bennett !