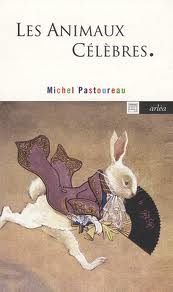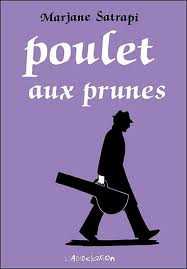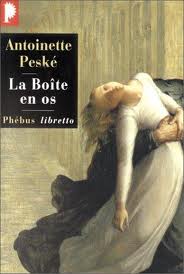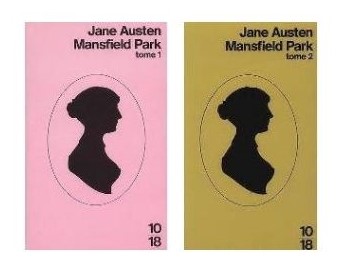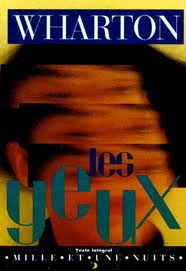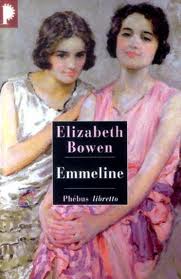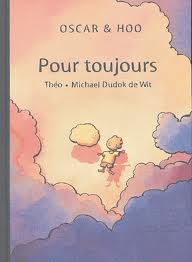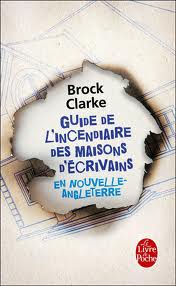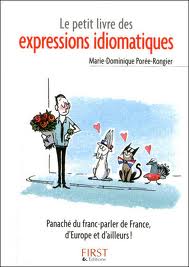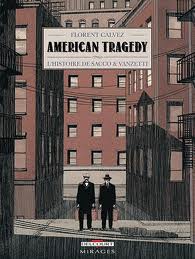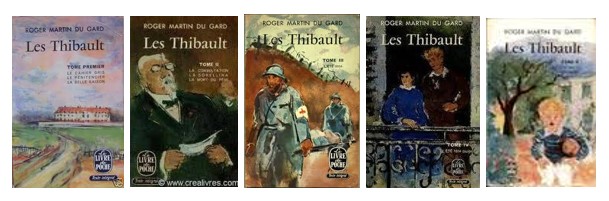Roman de Jack Kerouac.
Sal Paradise, le narrateur, rencontre un jour Dean Moriarty. Ces deux jeunes gens, « les deux anges déchus de la nuit de l’Ouest » (p. 270), ont une passion commune pour le voyage. Sillonner l’Amérique les tenaille et l’appel de la route est insistant. « Quelque part sur le chemin, je savais qu’il y aurait des filles, des visions, tout, quoi ; quelque part sur le chemin, on me tendrait la perle rare ». (p. 25) S’engage alors une nouvelle conquête de l’Ouest, plus intime et plus furieuse. L’urgence est la même que celle qui animait les colons, mais la finalité est différente : les terres que Dean et Sal veulent gagner ne sont pas faites de poussière, mais de rêves. Finalement, c’est peut-être la même chose.
Sal et Dean sont deux jeunes hommes un peu perdus. Le premier est un vétéran, étudiant peu assidu et auteur qui peine sur un premier roman. Le second sort de prison et est tenaillé par l’envie d’écrire et de bouger. Cette jeunesse exaltée a la fureur de vivre et d’expérimenter. « Il en vint à m’enseigner autant de choses que probablement je pouvais lui en apprendre. » (p. 19) Pour eux, l’initiation passe par le bitume, quoi qu’il en coûte. Sur la route et dans toutes les villes qu’ils traversent, Sal et Dean croisent de nombreux jeunes gens avec lesquels ils partagent de longues et fiévreuses conversations. Sal se met souvent en retrait : « Si vous continuez ce petit jeu, vous allez tous les deux devenir dingues, mais tenez-moi au courant aussi longtemps que vous continuerez. » (p. 79) Rapidement se dessine la folie de Dean Moriarty : ce mordu de la route est instable, presque dangereux, au moins pour lui et peut-être aussi pour Sal. « La mouche m’avait piqué de nouveau et le nom de la mouche, c’était Dean Moriarty et j’étais bon pour un nouveau galop sur la route. » (p. 164) Le départ, ça les prend comme une fièvre, c’est un ressort superbe qui se détend et qui relance la machine.
De l’Est vers l’Ouest, de New York à San Francisco en passant par Denver, Houston, ou Los Angeles, Sal et Dean se cognent aux frontières de l’Amérique. « Voici que j’étais au bout de l’Amérique, au bout de la terre, et maintenant il n’y avait nulle part où aller, sinon revenir. Je résolus du moins d’adopter un périple circulaire. » (p. 115) Sal appartient à New York et Dean ne tend que vers San Francisco. Toujours, il leur faut reprendre la marche, revenir aux sources, puis repartir. La route prend la forme d’un monstrueux jokari : elle permet des envolées et des échappées superbes, mais elle ne laisse personne s’écarter ou s’immobiliser. Grâce à la route, l’Amérique est un territoire unifié à conquérir et à explorer. Les jeunes hommes veulent laisser la trace de leurs godasses sur le sol de toutes les villes qu’ils foulent. Pour cela, il faut une voiture : mettez un volant entre les mains de Dean Moriarty et il ira partout. « Toi et moi, Sal, on savourerait le monde entier avec une voiture comme ça, parce que, mon pote, la route doit en fin de compte mener dans le monde entier. Il n’y a pas un coin où elle ne puisse aller, hein ? » (p. 326) Et voilà comment la voiture devient partie prenante du récit, personnage secondaire essentiel, adjuvant obligatoire.
Entre alcool, drogue et sexualité, les périples automobiles sont riches en expériences très diverses. Chacun court après quelques dollars pour faire un plein d’essence ou manger. Il faut alors chaparder, escroquer. Aucun problème, la route vous le rendra ! De même, les amours sont furtives, mais intenses et sincères. « Nous nous retournâmes au douzième pas, puisque l’amour est un duel et on se regarda l’un l’autre pour la dernière fois. » (p. 146) Sauf pour Dean Moriarty qui balance entre Marylou et Camille. De l’une à l’autre, il s’épuise et se trahit. S’asseoir et s’attacher, c’est mourir. Mais n’est-ce pas partir qui est mourir, un peu ? Peut-être, mais rester semble tellement pire ! « Quel est ce sentiment qui vous étreint quand vous quittez des gens en bagnole et que vous les voyez rapetisser dans la plaine jusqu’à, finalement, disparaître ? C’est le monde trop vaste qui nous pèse et c’est l’adieu. Pourtant nous allons tête baissée au-devant d’une nouvelle et folle aventure sous le ciel. » (p. 220)
Sal Paradise n’est pas moins perturbé ou incertain : « J’ai du goût pour trop de choses que je mélange, m’attardant à courir d’une étoile filante à une autre jusqu’à temps que je me casse la figure. Voilà ce que c’est que de vivre dans la nuit, voilà ce que ça fait de vous. Je n’avais rien à offrir à personne que ma propre confusion. » (p. 178) À force d’être partout et de ne rester nulle part, Sal s’étourdit et perd pied. Mais pas question de raccrocher les souliers : la route ne se referme pas, on ne lui tourne pas le dos.
Avec Marylou et Dean, l’odyssée américaine prend des airs de revendication, de bravade. « C’était trois enfants de la nuit de la terre qui voulaient affirmer leur liberté et les siècles passés, de tout leur poids, les écrasaient dans les ténèbres. » (p. 187) Les trois jeunes gens se révoltent, sans vraiment en parler, contre une Amérique bureaucratique, policière et suspicieuse. Animés d’un romantisme crasseux et sublime, ils mènent un train d’enfer sur les routes mythiques de l’Amérique. Ils fuient leurs tourments et la vacuité de l’existence, avant de comprendre au terme d’un énième voyage que rien ne s’abandonne, que la route ne peut rien effacer.
« Un gars de l’Ouest, de la race solaire, tel était Dean. » (p. 25) Dean Moriarty attire et fascine, mais il est dangereux, décidément néfaste. « Tu n’as absolument aucun égard pour personne sinon pour toi-même et tes sacrés plaisirs de cinglé. Tu ne penses à rien d’autre qu’à ce qui te pend entre les jambes et au fric ou à l’amusement que tu peux tirer des gens et puis tu les envoies paître. Sans compter que dans tout ça tu te conduis stupidement. Il ne t’est jamais venu à l’esprit que la vie est une chose sérieuse et qu’il y a des gens qui s’efforcent d’en user honnêtement au lieu de glander à longueur de temps. Voilà ce que Dean était, le GLANDEUR MYSTIQUE. » (p. 275) Le héros solaire est plutôt sombre, comme un phare de naufrageurs : qui s’y frotte risque d’y perdre ses ailes. Et pourtant, quand il n’est pas là, il manque. Sal s’y réfère, s’en rappelle et, à sa façon, l’honore.
Voilà quelques mots sur cette lecture époustouflante. Que ce roman soit le manifeste de la beat generation, c’est une évidence. Qu’il soit devenu le vademecum de plusieurs générations de jeunes gens, c’est encore plus évident. Je repose le roman, mais je vais le garder à porter de main, relire certains passages et rêver de prendre la route, de mettre mes pompes dans les pas de Dean Moriarty et de Sal Paradise, et de me couler un instant dans l’esprit un peu foutraque de Jack Kerouac. Je vais poursuivre cette lecture sublime par la visite de l’exposition Kerouac au Musée des lettres et manuscrits et par une séance de cinéma que j’espère à la hauteur du roman.