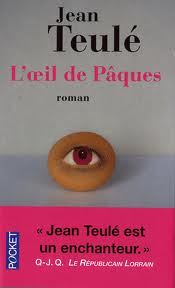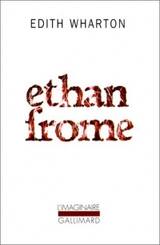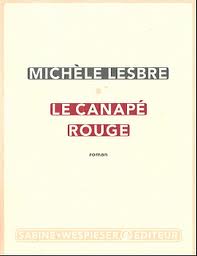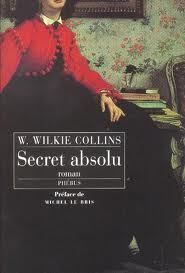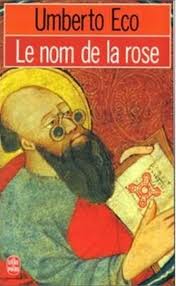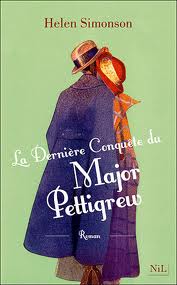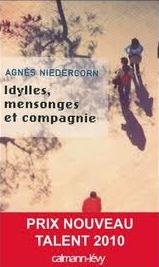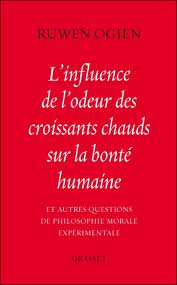Roman de Roger Martin du Gard.
Tome 1 – Tome 2 – Tome 3 – Tome 4
L’été 1914 (suite et fin)
La guerre a commencé. Jacques poursuit la lutte et participe à une mission pour distribuer des tracts. Mais l’avion qui le transporte s’écrase et Jacques est très grièvement blessé. Pris pour un espion par les gendarmes français, il est abattu dans un champ.
Ainsi finit le cadet des Thibault et ainsi s’achève la très longue partie intitulée L’été 1914. Toute la tension créée par les discours politiques et idéologiques explose enfin. On savait qu’elle ne pouvait faire que des dégâts.
Épilogue
Nous voilà quatre ans plus tard. La guerre fait toujours rage. Antoine a été gazé sur le champ de bataille : il est malade et se sait condamné. Le temps d’une permission, il retrouve Jenny qui a eu un enfant de Jacques, le petit Jean-Paul. Il discute avec Daniel, gravement blessé, qui a perdu le goût de vivre. Et il renoue brièvement avec Gise qui consacre tout son temps aux malades qui se succèdent dans le domaine de Maisons-Laffitte transformé en hôpital. À la tête de celui-ci se trouve Mme de Fontanin.
La guerre a changé toutes les personnalités. Gise n’est plus l’enfant qui cherchait l’affection de chacun. Jenny a gagné en douceur et en plénitude. Daniel n’est plus l’artiste exalté. Mme de Fontanin n’est plus la femme soumise et discrète et c’est avec une poigne de fer qu’elle dirige l’hôpital. Mais surtout, Antoine a perdu ses certitudes de grand bourgeois. La guerre lui a fait comprendre la vanité de la richesse et du luxe. Même si Jacques ne le saura jamais, son frère lui ressemble, désormais. « Comme nous nous comprendrions mieux, aujourd’hui ! … L’empoisonnement par l’argent. Par l’argent hérité, surtout. L’argent que l’on n’a pas gagné… Sans la guerre, j’étais foutu… » (p. 182 & 183)
Jenny œuvre avec passion et abnégation dans l’hôpital, mais elle espère la fin de la guerre pour se séparer de sa mère et de ce qui lui rappelle son ancienne vie. Elle ne veut pas que Jean-Paul soit élevé dans l’idée des privilèges. Dans l’éducation qu’elle souhaite donner à son fils, il s’agira de toujours entretenir la mémoire du père et de son combat. « Je veux que Jean-Paul ait pour mère une femme indépendante, une femme qui se soit assurée, par son travail, le droit de penser ce qui lui plaît et d’agir selon ce qu’elle croit être bien. » (p. 263) Jenny n’est plus l’enfant farouche qui ignorait tout du monde. Outre d’avoir éclairé son cœur, son amour pour Jacques a ouvert sa conscience aux réalités. Moins sauvage et moins téméraire, l’esprit de Jacques survit en elle.
Sentant la fin approcher, Antoine se retire dans son hôpital et n’en sort plus. Il commence une correspondance avec Jenny et Daniel. Ce qui le soulage le plus, c’est un carnet dans lequel il note ses pensées : « Exorciser les spectres les fixant sur le papier. » (p. 310) En lui, le médecin observe avec lucidité les progrès de la maladie et le patient laisse s’exprimer la douleur. À la fois carnet médical, carnet intime et testament, le papier reçoit des considérations physiologiques qui dérivent en réflexions personnelles et générales sur la vie et l’homme. Entre deux crises, Antoine note les progrès de la maladie, mais également ceux de la guerre. Il s’adresse aussi à son neveu, délivrant conseils et encouragements.
Antoine fait ses derniers pas main dans la main avec la mort. Le regard qu’il pose sur son existence est sans complaisance. La grandeur des Thibault n’a plus cours à l’heure de la fin. « N’ai été qu’un homme moyen. Facultés moyennes, en harmonie avec ce que la vie exigeait de moi. Intelligence moyenne, mémoire, don d’assimilation. Caractère moyen. Et tout le reste, camouflage. » (p. 405) Les fabuleuses ambitions du docteur Thibault se sont envolées. Il n’est plus la vivante incarnation d’une lignée, l’espoir d’une famille. Le flambeau est déjà passé, si vite, à la génération suivante. « Sang des Thibault. Celui de Jean-Paul ! Mon beau sang d’autrefois, notre sang, c’est dans les veines de ce petit qu’il galope maintenant. » (p. 311) Sur sa couche d’agonie, Antoine n’est pas amer, mais plein d’espoir. Jean-Paul vivra dans un monde qui ne pourra qu’être meilleur, du moins faut-il l’espérer. « Il est beau, ce petit, il pousse dru, tout l’avenir, le mien, tout l’avenir du monde, est en lui ! » (p. 329) À mesure que passent les jours et que novembre 1918 s’épuise, Antoine écrit de moins en moins : ses derniers mots sont des râles pleins d’une lucidité douloureuse.