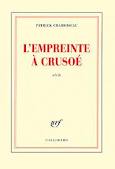
Roman de Patrick Chamoiseau. Lu dans le cadre du Prix Océans.
Depuis vingt ans déjà, Robinson habite son île déserte. Il se présente comme un homme au-delà des peurs et de la solitude, un être apaisé et en harmonie avec lui-même et son univers : « l’idée de mourir là ne m’effrayait plus ; » (p. 21) Le naufragé s’est créé une civilisation pour lui seul : « j’étais de fait la seule survivance capable d’assumer le nom d’homme ; » (p. 25) Mais voilà qu’un jour, à l’occasion d’une promenade commémorative, Robinson découvre une empreinte d’homme sur le sable. Pour Robinson, la stupeur se mêle de terreur : « quelqu’un d’autre que moi-même était maintenant sur l’île ! » (p. 45)
Passée la première prostration, Robinson décide de se mettre en chasse et de débusquer l’intrus. Il refuse de partager l’île et veut s’affirmer seul maître du territoire qu’il a lentement apprivoisé. « j’attendais cet autre pour le combattre ; j’attendais pour le tuer, et pour rester vivant ; » (p. 57) Ne plus être le centre, ne plus être unique, c’est inimaginable pour Robinson. L’Autre, impensable pendant des années, est une irréalité qui a pris corps. Au cours de sa traque, Robinson redécouvre l’île et se redécouvre humain. Et si cette empreinte n’était pas une menace, mais une promesse ? Robinson se découvre « une soif inapaisable pour une goutte d’humanité » (p. 86) : il ne peut plus se suffire en tant qu’homme, il a besoin de sortir de lui-même.
L’empreinte est permanente, à jamais figée dans le sable de la plage originelle. Elle représente la folie et l’obsession du naufragé. Cette empreinte dans le sable, signe ô combien fugace, c’est la signature de l’humain et la preuve que l’île est devenue le tableau d’un homme. Toutefois, même si cette marque ne disparaît pas, elle est un paraphe dérisoire, la preuve ridicule d’une existence particulière au sein d’un univers qui ne cesse pas de s’épanouir, avec ou sans l’homme.
Ce nouveau Robinson parle sans majuscule, ni point. Son récit est un continuum de pensées et de paroles, un discours débité sans reprendre haleine. Le point-virgule n’y est pas respiration, ce n’est que la marque d’une pensée effilochée qui se livre par bribes impatientes. Par un surprenant effet de mimétisme, la parole se fait jungle comme celle de l’île. Dans les notes en fin d’ouvrage, Patrick Chamoiseau justifie son choix du point-virgule : « Le point-virgule s’est imposé, je ne sais pas pourquoi, peut-être l’idée du flux de conscience, de l’instabilité mentale, de la saisie qui ne raconte pas. Ce n’est pas le point-virgule de Flaubert. » (p. 239)
Patrick Chamoiseau offre un roman riche d’une grande intertextualité. J’avais préféré le Robinson de Michel Tournier à celui de Daniel Defoe. Le premier m’était plus sympathique et plus humain, car plus sensuel. Le Robinson Crusoé de Patrick Chamoiseau est, selon moi, plus proche de Tournier que de Defoe. Cette nouvelle robinsonnade explore des thèmes classiques comme la solitude, l’humanité, l’altérité, la folie, la culture face à la nature. Mais l’auteur les traite avec une plume nouvelle et une audace littéraire très marquée. Surtout, lisez bien les quelques pages du Journal du capitaine. Ne vous précipitez pas, lisez-les comme elles se présentent afin de découvrir l’histoire de ce Robinson, l’histoire de tous les Robinson. Patrick Chamoiseau se place au bout d’une longue lignée d’écrivains, mais son texte se veut celui des origines. C’est surprenant, époustouflant et superbement convaincant !
