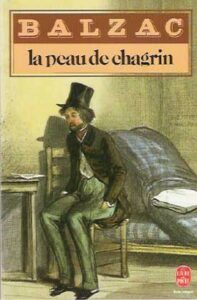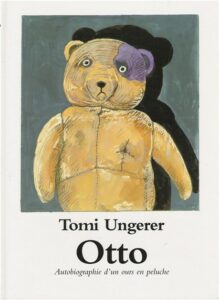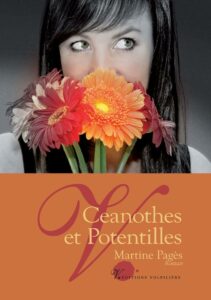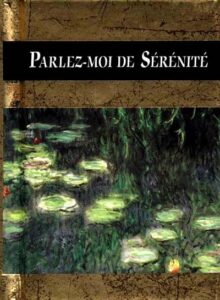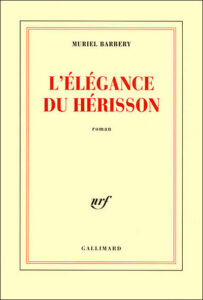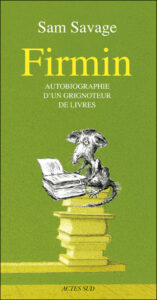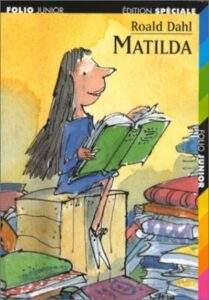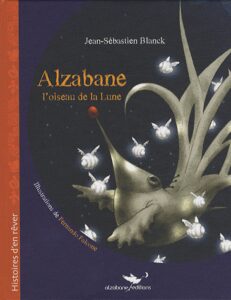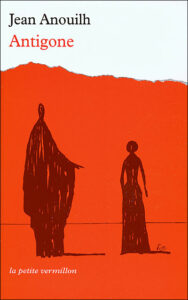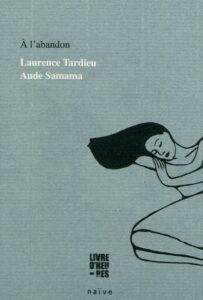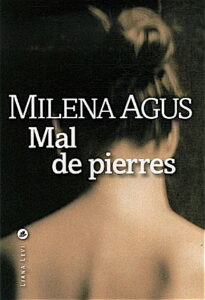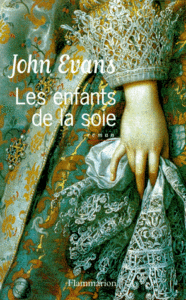Roman d’Erik Orsenna.
Sa demande de visa temporaire pour la France refusée, Madame Marguerite Bâ entreprend un recours en justice. Elle ne s’embrarasse pas de considérations diplomatiques et, avec l’aide de Maître Fabiani, elle écrit une lettre au Président de la République française. Point par point, elle reprend les questions du formulaire 13-0021 et les développe en remontant au plus loin dans ses souvenirs d’enfant, de femme, de veuve, de grand-mère et de citoyenne malienne. Puisqu’elle ne peut pas tout dire dans les trop petites cases du formulaire, elle déploie dans sa lettre toute l’histoire familiale, et avec elle, l’histoire du Mali.
Toute l’absurdité, la vacuité et l’artificialité des documents officiels sont férocement épinglées par la narratrice. Sa lettre, aux allures de roman fleuve, se découpe en chapitres dont les titres sont les intitulés stricts du formulaire 13-0021. Avec la méthode propre aux gens qui suivent une idée fixe, elle avance dans son récit sans rien oublier, pour combler tous les blancs que le formulaire ne ménage pas.
La France n’approuve pas les approximations de l’État Civil africain. Sur ce continent où l’administration travaille au rythme lent d’antiques ventilateurs plafonniers, tenir des registres à jour et sans contrefaçon relève de l’impossible. Les différents consuls et délégués venus de France s’échinent à nommer tout et tout le monde, à délimiter les villages, à poser des frontières, à établir les vraies filiations et à démêler le vrai du faux. L’agitation vaine des Blancs est d’autant plus risible qu’ils ne sont pas faits pour ce climat, ni pour ce « ciel de fer chauffé à blanc. » (p. 368)
La malédiction de l’ethnie de Madame Bâ, les Soninkés, c’est la « maladie du départ » (p. 32), celle qui pousse tous les siens à aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte. Ousmane, son père, de forgeron, est devenu contremaître de la centrale hydro-électrique du village. Son bel époux Balewell, un Peul, a quitté les troupeaux qui font la fierté de son peuple pour s’aliéner à la locomotive et au chemin de fer. Les cousins partent en France, « un paradis pour gogos » (p. 240), la tête pleine des images mensongères diffusées par la télévision et les magazines, fascinés par le miroir aux alouettes français.
A Kayes, Madame Bâ a grandi entre onze frères et sœurs et des parents qui s’affrontaient sans cesse. Mariama, mémoire de l’Afrique et gardienne de traditions millénaires, regardait avec mépris la passion de son mari pour le progrès. Entre islam teinté d’animisme et modernité, entre le crocodile protéiforme qui défend la famille et les embryons de taureaux canadiens congelés, le même affrontement a lieu entre Madame Bâ et son mari. L’Afrique se dessine peu à peu, entre misère et traditions légendaires, secouée de frissons de modernité et de volonté progressiste.
Madame Bâ elle-même est une femme coupée en deux. Deux volontés s’affrontent toujours en son sein. Elle n’a pas su choisir entre les études et la maternité, entre la fidélité au Mali et le devoir et l’espoir envers la France. Toujours, ce sont les autres et les évènements extérieurs qui décident pour elle, qui lui imposent des choix douloureux alors qu’elle ne veut rien d’autre que concilier les rêves qui battent dans sa tête et les obligations auxquelles elle fait face tous les jours.
La grande malédiction de Madame Bâ, c’est son nez. Appendice disproportionné dans le ventre de sa mère, il a fait croire à tous la venue d’un garçon. Cassandre noire, Madame Bâ sent les malheurs venir de loin pour s’abattre sur les siens. Femme trompée, elle flaire sur le corps de son bel époux les effluves des femmes qu’il fréquente, elle sent les lieux et les situations, tous les détails des infidélités de Balewell. Mais alors même que ce nez lui a annoncé toutes les tragédies auxquelles elle a résisté, il lui fait défaut dans l’appréhension de son plus grand malheur, la disparition de son petit-fils.
Le fleuve Sénégal, immuable et imperturbable, chemine toujours sur les terres désertées. Témoin éternel des changements humains, il assiste silencieusement à la décolonisation et aux multiples tentatives de co-développement entre le Mali et l’ancienne métropole. Et pour une fois, c’est de la France dont on a pitié. Certes, les forces vives du Mali partent en fumée dans les banlieues parisiennes. Certes, le pays connaît de graves retards de développement technique et culturel. Mais n’est-ce pas la France le personnage fantoche? L’ancienne puissance colonisatrice est animée par un puissant sentiment de honte. Toujours un peu de capitalisme dévorant, mais au centre de toutes les actions initiées en direction du Mali, il n’y a que la honte: honte d’avoir quitté si vite le pays, honte de toujours penser que les Africains sont des animaux, honte séculaire du paternalisme débonnaire. La France est dans ses petits souliers quand elle envoie des consuls, des délégués, quand elle distribue des Légions d’honneur plus de 70 ans après la Grande Guerre. La France a tout du mauvais élève qui cherche à se racheter. L’Afrique est forte et puissante, même sans elle. Son fonctionnement, sa logique, ses traditions lui permettent de vivre sans la métropole, et de vivre bien mieux, au milieu des reliques laissées par une France fuyarde et contrite. Madame Bâ s’interroge: « Quelle est cette maladie qui pousse toujours les Noirs à proposer leur aide aux Blancs? […] Sans notre appui, jamais la traite n’aurait si bien fonctionné. » (p. 387) Le problème de la France, c’est qu’elle ne peut se passer de l’Afrique
Madame Bâ, avec ses discours un peu naïfs et ses diatribes bien senties, distribue des coups de griffe un peu partout. Sans langue de bois, elle expose sans fausse pudeur son intimité physique et mentale. Cette liberté de ton lui permet tout, même de fustiger le sport chéri de l’Afrique. « Les spécialistes nomment ‘football’ cette activité épuisante et sans espoir. » (p. 259) Ce sport honni lui a ravi son petit-fils Michel qu’elle a élevé avec plus d’amour que ses huit enfants. » Le football est un divertissement de manchots fainéants. […] Une majorité de paresseux, les mains sur les hanches, contemplent l’activité frénétique de quelques camarades. » (p. 371) L’enfant chéri a succombé à son tour à la « maladie du départ » et a disparu en France, alléché par « l’école rien que de foot » (p. 379) promise par les recruteurs français venus faire de « la prospection chez les sauvages » (p. 376) Pour retrouver et sauver son petit-fils de douze ans des griffes de l’ogre de football, il faut un visa de séjour à Madame Bâ, et on le lui a refusé. Et c’est là que commence son récit.
La narration se déploie lentement, majestueusement, comme les méandres du fleuve Sénégal, comme les branches interminables de l’arbre généalogique du peuple Soninké. Madame Bâ, narratrice principale, alterne entre des adresses directes, virulentes mais respectueuses envers le Président de la République française, des confidences confiantes à son avocat, des admonestations musclées envers elle-même et les fantômes de ses chers disparus. Elle se raconte à la première personne, mais certaines situations, les plus décisives, sont écrites à la troisième personne, comme si Madame Bâ était une simple spectatrice de sa propre histoire, incapable d’en modifier le cours tragique.
La dernière partie du récit, les cinquante dernières pages, sont prises en charge par un nouveau narrateur. Maître Fabiani, l’avocat qui a aidé Madame Bâ dans sa demande de recours, prend la parole pour expliquer la suite des démarches de sa cliente, cette cliente si particulière qui lui a appris l’Afrique là où il ne voyait que la misère. La fin de l’histoire était attendue. Madame Bâ va gonfler encore un peu plus le flot d’immigrants clandestins qui se presse aux portes de la France.
Ce texte d’Érik Orsenna change radicalement de tout ce que j’ai pu lire de lui. Nous sommes très loin de la poésie enjouée de La grammaire est une chanson douce ou de Dernières nouvelles des oiseaux. Ici, ni jeux de mots, ni de galipettes avec la syntaxe. La langue se fait témoignage et philosophie pour mieux coller à une existence hors du commun. Le texte tient en haleine, malgré quelques longueurs. Je referme le livre en me disant que j’ai peut-être acquis un peu de la sagesse évidente de ceux qui se contentent de l’essentiel, sans chercher ailleurs le bonheur qui est sous leur nez, quelle que soit sa taille.