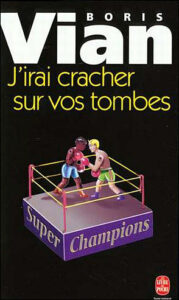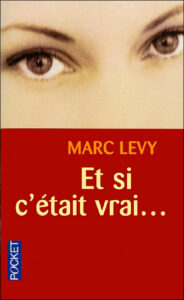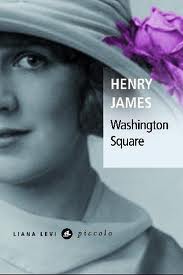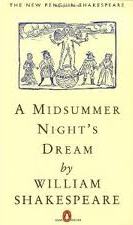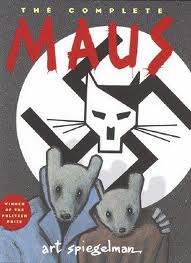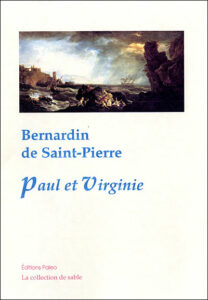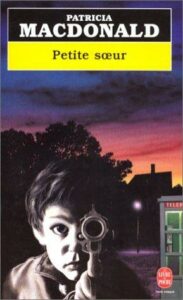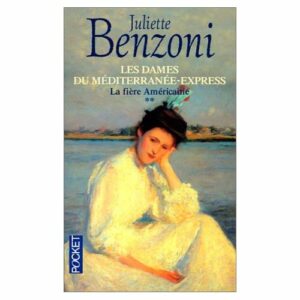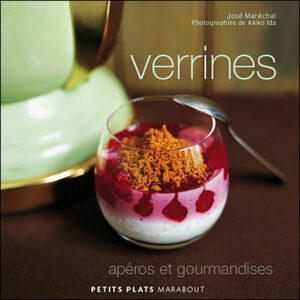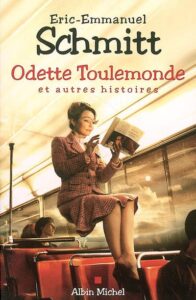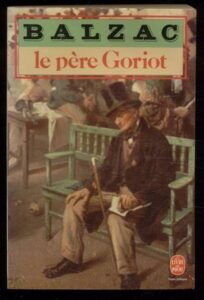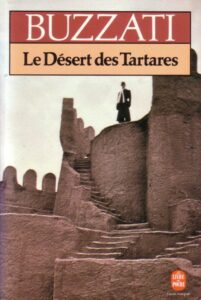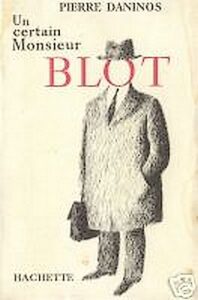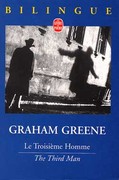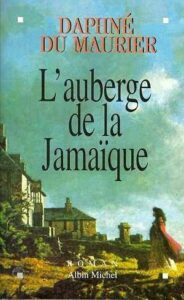Roman de Joan Elliott Pickart.
Philip Emerson est directeur de sa propre société de conseil en marketing. Seul compte son travail. Brenda MacPee dirige une pension pour animaux domestiques et conçoit l’existence comme une partie de plaisir. Quand ces deux-là se croisent dans les rues de Portland, c’est le choc. Ils sont bien entendu magnifiquement beaux et jeunes. Même si Philip résiste à l’attirance qu’il éprouve pour Brenda, celle-ci est bien décidée à lui faire oublier son travail et ses réticences.
Que de troubles et d’émois à la relecture de cette merveille de la littérature romantique ! Bien cruel fut le choix d’un thème d’étude. Après moult réflexions, j’annonce mon sujet : le poil comme atout de charme.
Je repose le décor. Brenda tient une pension pour animaux, avec chats, hamsters et surtout chiens : basset du Rhin, dogue et autres cockers. Nous voici immergés dans un monde de boule de poils. Avec notamment, l’épisode marquant et tellement glamour de l’accouchement d’une chatte. C’est une boule de poil de cinquante kilos, le chien Kouki, qui provoque la rencontre entre les deux futurs tourtereaux. Il fonce sur Philip et macule son pantalon de poils blancs, ce que Brenda trouve attendrissant et qui met en branle son âme de Saint-Bernard. Exemple avec le dialogue suivant, page 16.
« – Regardez tous ces poils de chien sur mon pantalon, c’est un vrai massacre.
– Voulez-vous que je vous brosse ? »
Voilà donc le séduisant Philip réduit à l’état de toutou dont il faut brosser le poil. Pas de doute, c’est le summum de la parade amoureuse. Mais ça marche, puisque Philip reviendra.
Des poils à la chevelure, il n’y a qu’un cheveu. Parlons donc de capillarité, avec la première description de Philip dont nous gratifie l’auteure, page 9 : « Ses cheveux ébouriffés étaient d’un blond couleur de sable. […] On sentait des jambes puissantes sous le pantalon noir couvert de poils de chien blancs. » Tout ceci pourrait rester très banal si le pauvre Philip n’avait sur le cuir chevelu une énorme bosse. Voici donc notre jolie Brenda-Bernard qui ramène le blessé chez elle et qui désinfecte le traumatisme crânien, tout en parlant cheveux, page 12.
« -Dites-moi, vous ne seriez pas à l’armée, par hasard ? Vous portez les cheveux si court ?
– J’aime avoir les cheveux courts. J’ai horreur de me coiffer, répondit-il.
– Eh bien moi, je sors de chez le coiffeur, s’exclama-t-elle en remuant ses boucles blondes. Je suis très contente de cette coupe. J’espérais qu’elle me vieillirait un peu. »
Et la suite, page 35 et 36 :
« -Tout a l’air pensé, même la longueur de vos cheveux. […] Comme vous les portez courts, ils peuvent pousser sans être trop rapidement longs. Ce qui vous évite par conséquent d’aller souvent chez le coiffeur. Est-ce que je me trompe ? […] Je suis étonnée que vous ne portiez pas la barbe. Ça vous éviterait de vous raser tous les jours. C’est une pensée logique, non ? »
Je suis bouche bée devant une telle profondeur dans les propos ! Pas de doute, Brenda étudie son compagnon sous un angle très restreint. Néanmoins, ça marche, puisque la suite de la relation repose beaucoup sur des tripotages capillaires et autres remarques oiseuses sur la beauté de la pilosité du jeune homme.
Un autre exemple affriolant, page 20 : « Elle aimait ses cheveux couleur de sable même s’ils étaient un peu trop courts à son goût. Et la teinte mordorée des poils soyeux de sa poitrine et de ses avant-bras ne la laissait pas indifférente non plus. » À se pâmer, n’est-ce pas ? Les cheveux de Brenda aussi sont au cœur de tous les fantasmes, comme on le voit page 28 : « Il étudia les boucles entremêlées de sa chevelure et ressentit un envie irrépressible d’y plonger les doigts. »
Les cheveux des autres personnages sont aussi au cœur des attentions. On commence par les ceux des parents de Philip, page 71 et page 73 : « Charlotte Emerson avait une chevelure gris argent coiffée à la perfection. » et « Bien que striés de fils d‘argent, ses cheveux étaient de la même couleur que ceux de son fils. » Je rappelle que Brenda rêve de trouver l’homme de sa vie, celui qui sera le père de son enfant. N’est-il pas évident qu’elle mène une étude sur les caractéristiques génétiques des parents de son reproducteur ? Dis-moi comment tu te coiffes et je te dirai qui tu es… Et il semble que Philip souscrive à ce précepte, page 91 : « Je ne suis pas un homme tant que je ne suis pas rasé. » Donc, génétiquement, un homme est glabre…
Passons au père de Brenda, nommé Mac Pee, page 117 : « C’était un géant de deux mètres […] qui portait une grande barbe brune comme ses cheveux. » La différence entre le svelte et raffiné Philip et le père bourru est évidente.
Que dire alors du cauchemar de la pauvre Brenda, page 128 : « Mac Pee se tenait dans une pièce toute blanche. Il était vêtu d’un costume sombre et d’une chemise blanche. Il n’avait plus de barbe. Ses cheveux étaient courts. Philip discutait avec lui. Il portait la chemise de flanelle brune de son père. Sa barbe avait poussé et dissimulait la moitié de son visage. Les deux hommes conversaient et riaient ensemble. Brenda était enfermée dans une cage de verre translucide. Elle hurlait de toutes ses forces pour qu’ils s’aperçoivent de sa présence. Mais les deux hommes ne l’entendaient pas. » On ne peut que remarquer que la pilosité est au cœur du processus de séduction et de l’amour. Si je résume grossièrement : si tu es glabre et bien coiffé, téléphone-moi, sinon on peut être ami.
Bien entendu, tout finit bien, et on assiste à un superbe changement de comportement capillaire, page 135 :
« – Je vois que tu as décidé de gagner du temps en allant moins souvent chez le coiffeur.
– Oui, ça devenait fatigant de toujours voir la même tête dans la glace le matin. J’ai décidé de les laisser pousser un peu. »
The power of love ! C’est tellement émouvant! Pour finir, Philip décide d’investir dans le projet d’élevage de cockers de Brenda. Comme quoi, c’est bien difficile de se débarrasser des poils.
J’aurais pu disserter de la même manière sur la splendide collection de licornes de la jeune fille, mais je me refuse définitivement à faire de la psychologie de bas étage… Il y avait aussi beaucoup à dire sur les tenues des personnages, entre les costumes psychorigides de Philip et les robes de Brenda, taillées dans les rideaux, mauvais remake de Scarlett O’Hara. Mais il fallait choisir et je n’ai pu résister à donner une brillante analyse de la force du poil dans les relations amoureuses. Et je ne fais là que reprendre des vérités que tous les zoologues connaissent très bien : toute parade amoureuse passe par déploiement de poils et phéromones impliquées!