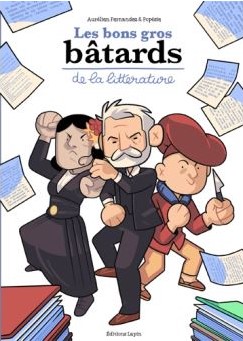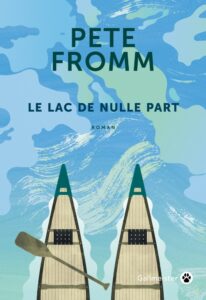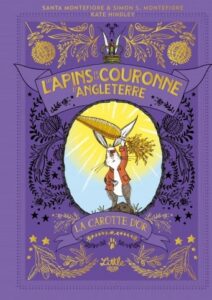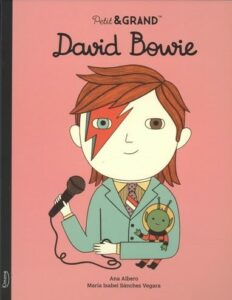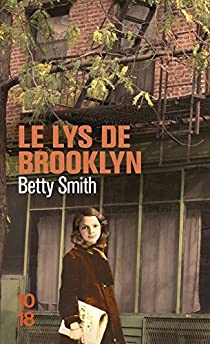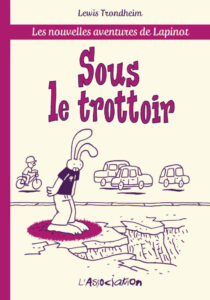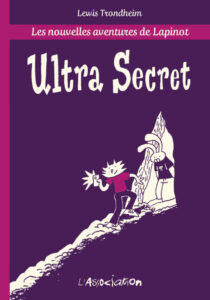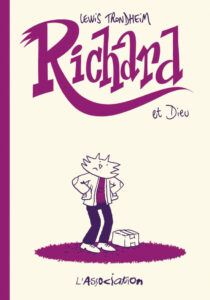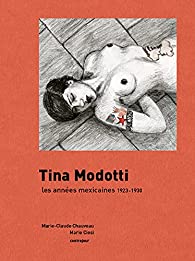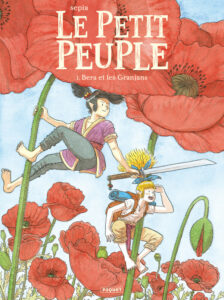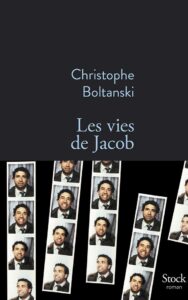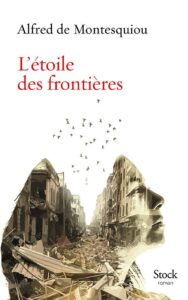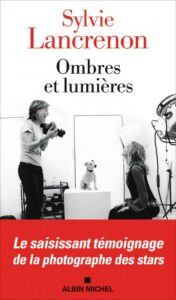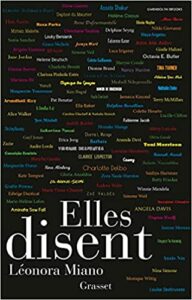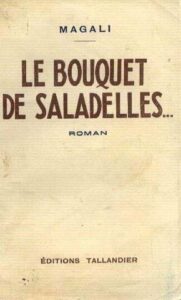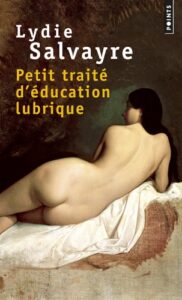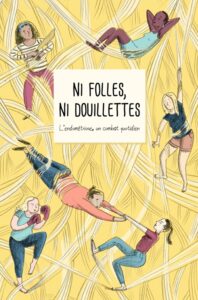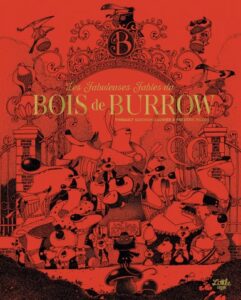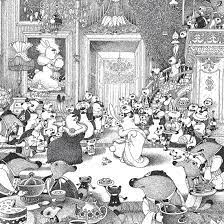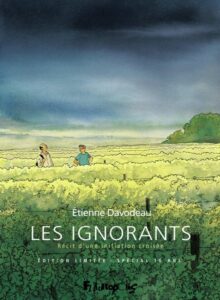Essai d’Éliane Viennot.
Quatrième de couverture – Depuis quand, et comment, et pourquoi le mot « homme » en est-il venu à désigner le genre humain tout entier ? Au fil d’une passionnante analyse sur l’usage historique de ce terme, son étymologie, la plus-value sémantique qu’il a progressivement acquise, Éliane Viennot retrace l’histoire d’un abus de langage qui gonfle « l’Homme » à la dimension de l’humanité. Au pays du Musée de l’Homme, de la Maison des Sciences de l’Homme, des Droits de l’homme et du citoyen, cette histoire-là relève d’une exception française qui sent fort l’imposture masculiniste. Il est temps que « l’homme » se couche, sémantiquement parlant, qu’il regagne son lit de mâle humain et laisse place aux autres individus du genre Homo, aux personnes humaines.
Évidemment, dès qu’il est question d’étymologie, de langage et de lexique, je suis tout ouïe ! D’autant plus quand le sujet est hautement féministe. L’autrice déconstruit le caractère trompeusement inclusif du mot « homme » qui voudrait désigner autant les humaines que les humains. Ce terme qui prouve la domination du masculin dans la langue sert bien sûr les intérêts de ceux qui firent cette dernière. « L’Université de Paris s’est d’emblée organisée pour que seuls les hommes chrétiens en tirent avantage : l’accès aux diplômes fut fermé aux femmes et aux juifs, et de là également l’accès aux métiers supérieurs qui se virent ainsi verrouillés. » (p. 27 & 28)
Revenons à l’origine du mot. Le latin avait les termes « homo » pour désigner tout individu appartenant au genre humain, « mulier » pour l’individu féminin et « vir » pour l’individu masculin. La disparition des deux derniers mots a laissé le champ libre à « homo » devenu « homme », à la fois individu masculin, mais aussi et surtout – pour le grand malheur de la représentativité de tous les groupes humains – l’être humain en général. « Attachement que tant que Français·es ont l’air de partager, de même qu’elles et ils continuent de ne pas s’offusquer de l’usage du mot homme lorsqu’il question de l’espèce humaine. » (p. 14) Donc, pour résumer très grossièrement, l’homme couvre la femme (et ne l’inclut pas, la différence est notable) et, ce faisant, nie sa particularité. Pour qu’une chose existe et soit reconnue, il faut qu’elle puisse être nommée. Or, de l’Antiquité à nos jours, les institutions patriarcales, au premier rang desquelles l’Académie française, n’ont eu de cesse de supplanter le féminin, voire de le gommer, pour imposer le masculin en valeur unique et absolue, en mètre étalon bien réducteur.
Il faut souligner une bien peu reluisante exception française : là où d’autres langues parlent de droits humains, le français s’arque boute sur les droits de l’homme ! Heureusement, la francophonie progresse : il faut espérer que la France cessera de rétrograder dans la semoule et prendra exemple sur les Belges, les Québécois ou encore les Maliens !
L’autrice explore les textes juridiques, religieux et encyclopédiques, et son constat est sans appel : au fil des siècles, le langage et les écrits ont placé la femme au second plan, sur un rang inférieur, voire l’ont invisibilisée. Est-ce une surprise ? Non, certainement pas, mais dire les évidences et pointer les preuves dans des textes accessibles à tous, c’est le premier acte de dénonciation d’une inégalité et le premier pas vers un rétablissement de l’inclusion et de la diversité. Il faut continuer à croire que le changement est possible, même si les hommes sont debout sur les freins. Parce que nous, féministes, nous ne lâcherons plus rien. « Aucun train de mesures n’est mis en place pour contrecarrer les traditions et réaliser au plus vite l’égalité désormais admise en principe. Au contraire, chaque avancée doit être arrachée sur les bancs du Parlement, après avoir été longuement contestée dans la presse, souvent aux mains des mêmes élites masculines réfractaires au moindre recul de leur pouvoir. Mais c’est aussi que, plus largement, les hommes bousculés par l’intrusion des femmes dans ‘leurs’ domaines ont développé une multitude de stratégies à la fois très concrètes et très symboliques pour maintenir l’entre-soi masculin. Stratégies au sein desquelles la question du langage occupe une place de choix. » (p. 82 & 83)
Vous vous en doutez, ce texte rejoint mon étagère de lectures féministes. Mais avant cela, il va tourner dans mon cercle d’ami·es !