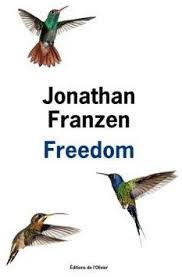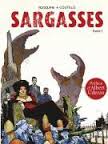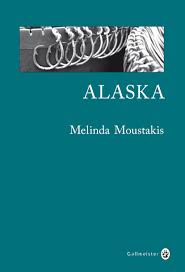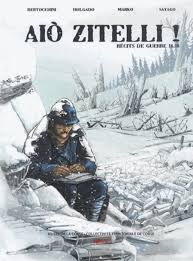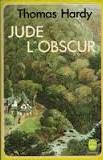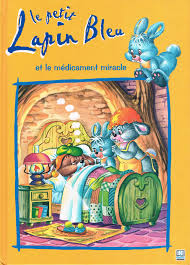Texte de Leïb Rochman.
La guerre est terminée. S. revient dans sa ville et retrouve les restes dévastés de ce qui fut son ghetto. « Il savait que les siens n’étaient pas là. On les avait triés, avec leurs parents, parmi les voisins. Une main d’homme s’était abaissée et les avait désignés du doigt. » (p. 20) S. voudrait se souvenir de tous les noms et de tous les visages de ce qui ne sont pas revenus des Plaines. « On les chassait à coup de fouet dans les flammes où leurs ombres s’écroulaient en cendres. » (p.61) Incapable de rester là où les siens ne sont plus, il entreprend une errance indéfinie, ses pas rejoignant le cortège des survivants. « Il marchait sur les traces de sa communauté perdue – sur leurs traces effacées. » (p. 166)
Ceux-là qui marchent à travers l’Europe, ce ne sont pas des revenants, ce sont des revenus de loin. Il y a Leibl et son épouse Esterké. Il y a la petite fille aux paumes brûlées. Il y a la danseuse à la jambe brisée. Il y a le Dr Scheter, le bibliothécaire qui voudrait dresser la liste de tous les ouvrages sauvés des flammes. Il y a les jumelles qui ne peuvent dormir qu’en s’accrochant l’une à l’autre. Ceux-là qui ont survécu faisaient partie du peuple élu par Dieu. Peuvent-ils encore prétendre à cette élection ? Si oui, où aller ? Où est la terre promise ? Israël est-elle la réponse à la question posée par l’errance ?
Impossible de tout dire de ce monument de la littérature yiddish qui, lui-même, tente de tout dire de la Shoah. Les Plaines, c’est le nom que l’auteur donne aux camps de la mort. Trompeuse image faussement bucolique. Ce qui a eu lieu dans les Plaines, c’est la tentative d’effacer une identité : S. ne se reconnaît plus puisqu’il est seul. « J’appartenais à une espèce qui ne relevait plus des cimetières. Une espèce qui s’effondre sur les routes y menant, mais dont les tombes restent désertes à jamais. » (p. 274) Avec son identité amputée, réduite à une initiale, il ne sait s’il est la fin ou le commencement du nouveau peuple.
Si S. est le personnage qui revient le plus souvent, l’auteur aussi prend la parole au sujet du texte qu’il écrit. Faut-il dire ou taire l’Anéantissement ? Est-il juste ou cruel d’évoquer les morts et les mémoires perdues ? « Il était le dernier scribe de son temps. Il devait tout inscrire pour l’avenir. S’il ne le faisait pas, il n’y aurait plus personne pour le faire. » (p. 636) Mais est-ce aux seuls survivants d’écrire l’Anéantissement ? « Ce n’est pas lorsque les victimes écriront leurs mémoires que le monde sera délivré des bourreaux, c’est lorsque les bourreaux eux-mêmes les écriront. Mais eux n’écrivent pas. Lorsqu’ils écriront, ils cesseront d’être des bourreaux. Écrire signifie comprendre. […] Ce n’est qu’une fois qu’il se mettra à écrire qu’il comprendra sa victime : comprendre signifie sentir, sentir sa victime et sa douleur. » (p. 714) Le pouvoir de l’écriture n’est plus à démontrer : la force du texte est telle qu’elle peut pardonner l’Anéantissement tout en n’oubliant jamais qu’il a eu lieu. Se souvenir, oui. Condamner, non. « Le vieux rabbin protesta : infliger des souffrances aux bourreaux, quel sacrilège ! » (p. 211)
Outre cette obsession du témoignage, il y a l’obsession de la procréation, de la reproduction et du repeuplement. Sans cesse, S. pense aux femmes qui n’ont pas accompli leur destin de mère, aux semences qui n’ont pas été déposées dans les ventres féconds. Les Plaines ont fait des millions de morts, mais elles sont surtout coupables d’avoir assassiné des milliers de générations à venir. « Ce n’était pas seulement son sort à lui, celui de sa souche calcinée, c’était le destin aboli de toutes les générations à venir sur cette terre. » (p. 81) S’ouvre alors le tribunal rabbinique. « Le prévenu est S. […] Depuis son retour de là-bas, il va par le monde, muet. Il déambule et abolit sa postérité, il perturbe la marche du monde. » (p. 339) On ne juge pas les bourreaux, mais les survivants qui refusent d’accomplir la vie, de faire fructifier de ce que les Plaines ne leur ont pas arraché. Mais comment vivre quand la peur ne disparaît pas et que l’incrédulité a remplacé l’espoir ?
Il est évidemment question de la culpabilité du survivant, cet étrange dégoût de celui qui n’a pas disparu. « Je ne pouvais me pardonner ma présence parmi les hommes. Elle était toujours suivie d’un sentiment de remords. » (p. 265) Pas uniquement la culpabilité du survivant, mais l’incompréhension : pourquoi avoir survécu quand tant sont morts ? Et surtout, désormais, qu’est-ce que cela signifiera de mourir sans être exécuté dans les Plaines ? « La douleur de mourir dans son lit après toutes ces épreuves, alors qu’il était désormais permis de vivre, était plus insupportable que la douleur de disparaître avec les autres jadis. » (p. 685) Mourir semble avoir pris un autre sens : on ne meurt plus de la même façon depuis les Plaines. « Il lui semblait à la fois triste et insignifiant de mourir sans être exterminé. » (p. 51)
À pas aveugles de par le monde est un texte protéiforme qui mêle différents registres de langue et différents genres littéraires, comme si, pour dire l’innommable, le texte traditionnel ne se suffisait pas à lui-même. Dans les Plaines, plus qu’un peuple, c’est une voix qu’on a essayé de faire taire : puisqu’elle a survécu, elle ne se taira plus jamais et elle investit désormais tout le champ littéraire. Élégie, roman, témoignage, légende, mythe, pièce de théâtre, fantasmagorie, le texte de Leïb Rochman est une lancinante évocation/invocation menée au nom des disparus. Ce récit hybride pourrait être pesant, mais il évoque de glorieux décombres et il est étonnamment lumineux, notamment le chapitre consacré au procès des livres écrit dans un registre résolument tourné vers le réalisme magique. Ce texte jamais n’accuse, jamais ne condamne, jamais ne se lamente. Probablement parce que l’accusation, la condamnation et la lamentation sont vaines après les Plaines. Désormais, ce qu’il faut tenter, c’est la vie, à reconstruire au nom des morts.