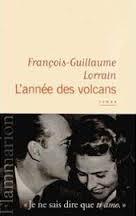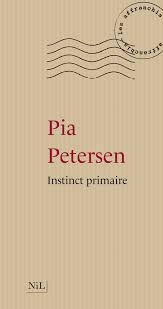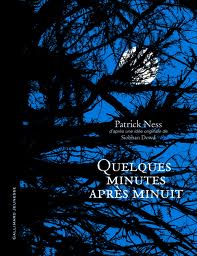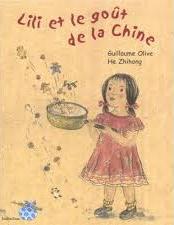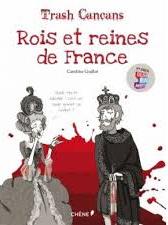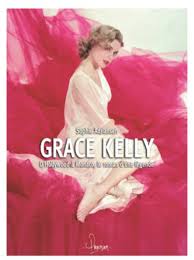
Biographie de Sophie Adriansen.
Grace Kelly. Princesse Grace de Monaco. Je l’avoue franchement, je ne savais pas grand-chose de cette superbe blonde. De tous ses films, je n’ai vu que Fenêtre sur cour, œuvre que j’ai particulièrement aimée. Je connaissais très vaguement son destin de princesse adulée, brutalement stoppé par un accident de voiture. C’est donc en terrain inconnu que j’ai posé les yeux quand j’ai ouvert la biographie de Sophie Adriansen.
« Il suffit d’aller voir derrière le conte de fées pour s’apercevoir que la femme aura tenu des rôles bien différents de ceux que l’on aime à s’imaginer. » (p. 235) De la naissance de la blonde icône en 1929 à sa tragique disparition en 1982, j’ai suivi avec passion les premiers pas de mannequin et d’actrice de Grace Kelly, fille d’un riche entrepreneur américain. J’ai découvert sa relation privilégiée avec le maître du suspense, cet Hitchcock fasciné par la blondeur parfaite de la gracieuse actrice. Je l’ai suivie dans ses nombreuses amours jusqu’à sa plus grande passion, concrétisée par un féérique mariage avec le prince Rainier de Monaco. J’ai poussé les portes du palais princier monégasque et j’ai vu la détresse d’une reine d’Hollywood prisonnière d’un rôle de princesse parfois très lourd à porter, mais qui endossait avec amour et dévouement celui de mère de famille.
Déterminée à devenir actrice, Grace Kelly ne ménage pas ses efforts pour parvenir à ses fins. « Il est parfois nécessaire de ressembler à la personne que l’on veut devenir pour devenir la personne à qui l’on veut ressembler. Tout comme le pouvoir, le succès est une attitude. » (p. 39) Cette attitude, Grace Kelly la cultive : elle est toujours impeccable, parfaitement apprêtée et ne commet pas d’impair. Elle n’est pas écervelée et ne se jette au cou des hommes que parce qu’elle est passionnée, jamais arriviste ou intéressée. « Est-il possible de dire que Grace Kelly a dû sa carrière au désir qu’elle a éveillé chez les hommes, un désir amoureux qui s’est traduit par des propositions strictement professionnelles (en théorie) ? » (p. 46) Pourquoi le nier ? Grace Kelly était fascinante, à tel point que les réalisateurs voulaient en faire leur muse et les couturiers leur égérie. Actrice accomplie et reconnue, elle a gagné ses galons hollywoodiens à force de travail. Et elle fera montre de la même détermination patiente et têtue pour faire honneur à son titre de princesse. « Une star de cinéma ne pense qu’à elle. Une princesse doit d’abord penser aux autres. » (p. 141) Grace Kelly ne renonce jamais et affronte tout avec douceur et élégance, quelque violents que soient les vents qui soufflent à l’encontre de son destin.
La biographie écrite par Sophie Adriansen est richement documentée et elle montre l’envers du conte. « L’idée même que ma vie a été un conte de fées relève elle-même du conte de fées. » (p. 172) Cette déclaration de la princesse Grace est pleine de sens : tout ce qu’elle a obtenu, elle l’a gagné et même ce qui lui a été offert avait un prix. Dans ce texte, j’ai senti toute la tendresse et l’admiration que l’auteure porte à l’actrice. D’une femme à l’autre, l’hommage, toujours lucide, est touchant. La blonde auteure a révélé avec beauté la fragilité et l’humanité de la blonde actrice. J’ai lu cette biographie comme j’aurais feuilleté un album photo, avec une curiosité sans cesse renouvelée et une émotion grandissante envers celle qui était une reine de cœur. J’ose la formule : cette très belle œuvre m’a offert plus d’un moment de grâce.
Un grand merci à Sophie Adriansen pour cet envoi. Et je ne saurai assez chaudement vous recommander sa biographie de Louis de Funès : Louis de Funès – Regardez-moi là, vous !