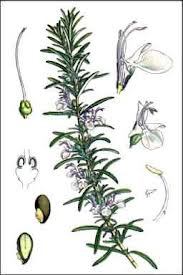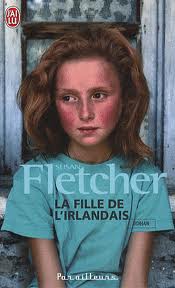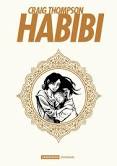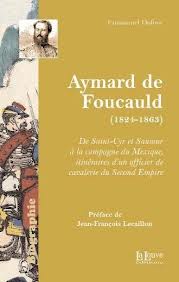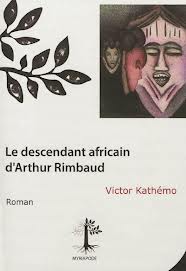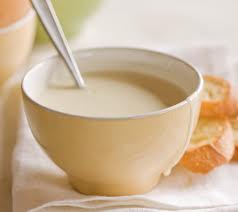Roman de Pia Petersen. À paraître en 2013.
Gary Montaigu est un auteur à succès. Il est en lice pour recevoir un prestigieux prix littéraire : « S’il avait son prix, il pourrait tout faire, il serait enfin libre d’écrire tous les livres qu’il voulait. » (p. 12) Oui, ce prix serait la consécration de son talent et son billet vers les hautes aspirations littéraires de sa jeunesse. Voilà, Gary peut tout faire. Sur les conseils de Ruth, sa femme, et de son agent, il se lance dans une émission de téléréalité.
Outre le placer sous l’œil des caméras, Un écrivain, un vrai est censé le mettre en contact avec ses lecteurs en leur permettant d’interagir sur le roman qu’il est en train d’écrire. « La téléréalité marche à fond, c’est l’avenir du livre […]. On mettra la création romanesque à la portée du public, […]. On fera du storytelling. Vous serez une légende. » (p. 20) L’émission veut capter l’instant exact de la création, mais pas seulement. Gary doit se montrer, suivre les directives de la production. Si Ruth se prête avec délice à cette parodie de vie qui la place enfin sous les feux de la gloire, Gary perd rapidement pied. Écrire à la demande, être dépossédé de son texte, faire de l’émotion immédiate plutôt qu’engager la réflexion, ce n’est pas ainsi qu’il considère l’écriture et la littérature. Viendront alors l’accident, puis la longue réclusion tandis que dehors, tout le monde se demande ce qui a poussé un homme qui avait tout – la gloire, l’argent et les femmes –, à tout repousser.
Le récit se construit entre deux époques, avant et après l’accident. On voit donc la longue détresse de Gary, puis sa convalescence sous la surveillance de son épouse. Ruth est un personnage trouble, entre éminence grise et mauvais génie. « Ruth estime que c’est son devoir d’organiser sa vie. Sans elle, il n’irait pas bien loin. » (p. 33) Pour cette ambitieuse, la littérature n’est qu’un divertissement facile et rapide qui permet de prendre l’ascendant sur la foule et de se tailler sa part de gloire et de pouvoir. Elle ne partage pas les idéaux artistiques et intellectuels de son époux. Gary est seul contre tous : l’émission de téléréalité est loin de se concentrer sur son travail et préfère les petites tragédies de son quotidien. « Sois moins littéraire. Tu sais que les gens n’aiment pas ça. » (p. 47) « Ne parle surtout pas d’écriture. On s’en fout de ça. » (p. 48)
Un écrivain, un vrai pose la réflexion de l’avenir de la lecture à l’ère des réseaux sociaux et du tout écran. Dans cette société de l’immédiat, un clic vaut critique : j’aime, je partage. Le mot semble bien faible face à l’image ininterrompue. La littérature s’oppose au storytelling, cette technique de communication qui consiste à raconter des histoires. Où est la différence, me direz-vous ? C’est que le storytelling s’en tient à l’histoire. La littérature, elle, entraîne son lecteur vers des sphères plus sombres où la réflexion, la critique et la remise en question sont de rigueur. Mais voilà, faut-il écrire pour plaire ou écrire pour faire réfléchir ? Gary a manifestement choisi une posture qui ne sied pas aux exigences de la téléréalité.
La téléréalité… En scénarisant la réalité pour la rendre plus vraie et plus intéressante, c’est plus que l’intimité d’un homme qu’elle met à mal : c’est l’espace sacré de la création qui est profané sur l’autel du voyeurisme et de l’audimat. Outre l’évidente médiocrité que suggère ce genre de programme, c’est le temps qui crucifié : a-t-on encore le temps de prendre le temps de réfléchir ? NON, nous hurlent les mille écrans qui renvoient les images glacées d’un monde passé sous la lame de la chirurgie télévisuelle. Et c’est précisément ce qui ronge Gary : en invitant les télélecteurs à rendre un avis en temps réel sur son écriture, la production a dépossédé l’écrivain de sa liberté et de sa créativité. « Ce n’était pas son roman, c’était le roman des autres. Le roman ne lui parlait plus. » (p. 71)
Je pourrais en dire encore beaucoup sur cet époustouflant roman. Mais je vous laisse le grand plaisir d’être happé par ses pages. À vous de voir si vous plongerez dans la détresse et la solitude de Gary ou si vous préférerez la voie pavée de bons intérêts que suit Ruth. Le style est fluide et dense et le roman est difficile à lâcher. Pia Petersen vous offre un roman, un vrai. Alors, éteignez votre télé.