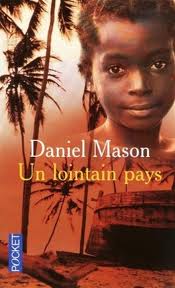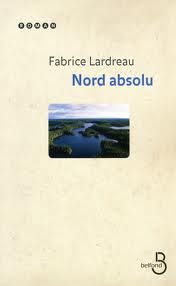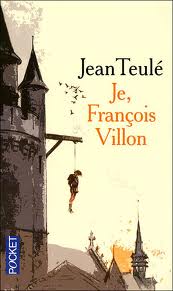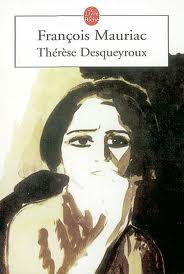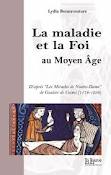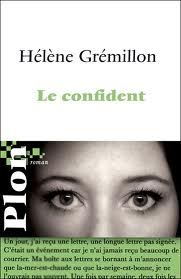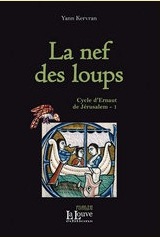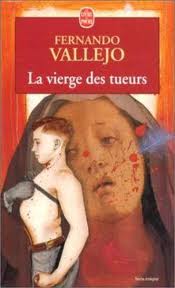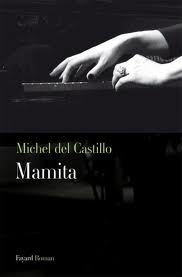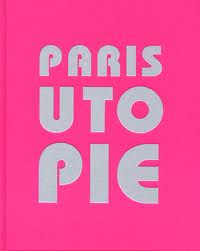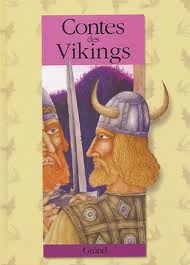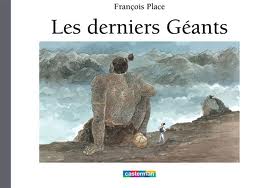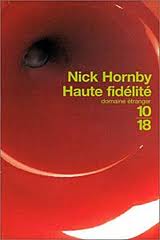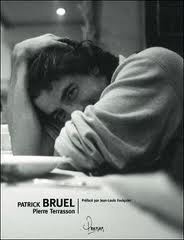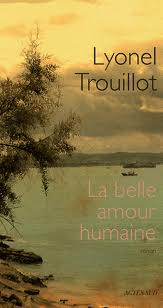Un moment que l’envie me trottait dans la tête : interviewer un auteur. Pour cette première, c’est Martine Pagès qui s’est prêtée au jeu des questions/réponses.
Ton roman Céanothes et potentilles est paru en 2010 aux éditions Volpilière. Nombre de blogueurs en ont parlé. T’attendais-tu à un si joli succès sur la blogosphère et plus généralement sur Internet ? Quel accueil les médias dits classiques ont-ils fait à ton roman ?
Merci. Tu fais partie de ces blogueuses qui ont apprécié l’ouvrage ET en ont fait une présentation remarquable. La maison Volpilière communique essentiellement par le biais des salons (dédicaces) et d’Internet. Les médias dits classiques n’ont donc pas eu vent de mon ouvrage (Volpilière faisant partie des petites sociétés éditrices, il n’y avait pas de budget consacré à la promotion). Néanmoins, j’ai tout de même obtenu une ITW sur le plateau de FILTV78, mais c’est resté très confidentiel… Les retours de lecture par le biais du Net ont vraiment été formidables, francs, remarquablement rédigés, et je n’y ai pas lu de démagogie. Je ne connaissais aucune des rédactrices (je t’ai découverte à cette occasion), il n’y avait donc aucune complicité et la sincérité était de mise. Deux ou trois fiches ont évoqué des points négatifs qui se résumaient au choix de la couverture et au volume du livre (moins de cent pages). Ce dernier point n’était pas de mon fait. Quant à l’image, j’ai donné mon aval un peu trop rapidement… La photo est belle et vendeuse mais on note très vite un décalage avec le texte…
Tu as aussi publié un Guide de la défume (Guy Tredaniel, 2010) : toujours clean ou tu as replongé ? Comment l’acte d’écrire t’a-t-il aidée à te débarrasser de la cigarette ?
Non, la nicotine et moi, c’est une histoire ancienne… Je fêterai le sept décembre prochain cinq ans de sevrage tabagique. Autant dire, une éternité. Mais, comme toute drogue dont on divorce, les premiers mois auront été les plus effroyables… Je pense sincèrement que le fait de cesser de fumer fait partie des décisions les plus adultes qu’on puisse se mettre au défi de vivre. Se mettre à l’épreuve dans un tel climat intérieur de violence, sans garde-fou, sans réelles compensations, c’est un duel avec soi-même et c’est assez perturbant de savoir qu’une partie de soi (mais laquelle ?) est susceptible de remporter la mise. Chaque jour, chaque heure sont autant de doutes sur la réussite et on n’a aucune idée du temps nécessaire pour récolter les fruits de tels efforts…. On n’est pas certain de soutenir le choc violent des envies impérieuses, on se plaint, on en veut à la terre entière. Ce qui est déroutant, c’est qu’on considère alors le tabac comme un ancien ami pour qui on éprouverait de la nostalgie. Il est le seul à nous comprendre et la seule « cure » pour soigner ce qu’on peut parfois apparenter à une dépression, parce qu’une seule bouffée inhalée et on aurait la sensation de reprendre vie… Paradoxe total : c’est contre lui qu’on lutte. Ne pas lui demander conseil, ne pas lui demander de soins ! L’ignorer consciencieusement… Cela dit, pas de panique, il y a des moments « vivables » et j’ai trouvé l’énergie pour un ton humoristique. Et puis chacun a sa façon de vivre son sevrage, j’envie ceux pour qui ça n’a pas été si éprouvant…
Un ami m’avait confié qu’il avait insulté ses clopes, durant son arrêt, par le biais de petites missives à leur attention. Il parlait de libération et de domination. J’étais ivre de l’entendre s’exprimer sur la façon dont il traitait si mal celles qu’il nommait « prostituées ».
J’ai suivi le mouvement, mais sous forme de journal. Il s’agissait de narrer les événements du matin au soir, pas seulement d’adresser des insultes à une menthol… Les émotions s’accumulaient, j’avais en tête une masse de sensations et une tonne de vocabulaire pour décrire à l’heure près ce que je vivais, ce qui me sortait la tête de l’eau puis me l’y noyait. Je passais de douche en douche, et les écossaises m’inspiraient. Je peux certifier que pendant l’écriture, les envies s’estompaient. Ah, l’écriture, éternelle et plurielle thérapie, mais c’est si vrai… À chaque chapitre rédigé, je levais mon poing droit comme dans un langage de combat, puis je le baissais, le rictus au coin des lèvres. Je gagnais…
Outre l’écriture, la photographie est une autre de tes passions. Comment se déclenche ton envie créatrice dans chacun de ces domaines ? Prends-tu plus facilement la plume ou la pellicule ?
Il est plus facile de s’armer d’un Reflex quand on a le bon sujet, la lumière idéale et l’espace qu’il faut pour choisir les bons angles. Il n’y a, pour le coup, aucun mérite dans ce travail, parce qu’il s’agit de se faire plaisir de suite, en anticipant sur ces minutes magiques : celles où l’on va vérifier le soir-même, les contrastes, la saturation, la température, la lumière, et quelques autres points de « traitement » sur l’ordinateur, qui n’ont rien à voir avec la retouche. Je ne la pratique pas et l’abhorre. J’estime que si un cliché a besoin d’être retouché, c’est qu’il était, au départ, à jeter. Je prends un grand plaisir à valider, ou non, mes clichés.
Alors oui, il m’est plus aisé de dégainer un appareil photo qu’un stylo parce que la technique est là, pour nous aider et nous épauler. Un stylo et une feuille blanche n’ont rien de très jouissif, en comparaison, d’autant qu’un format A4 imprimé en Arial black est assez mal placé pour remporter des concours de beauté. A ce stade, la pratique relève de l’ordre de l’ascétisme, en comparaison. MAIS. A se relire, à se corriger, à se relire encore, on est sur scène, dans des couleurs d’un autre monde et aucun appareil numérique suréquipé ne peut rivaliser avec les instants qu’on est seul à avoir vécus et qu’on rêve de partager. Mais il faut faire vite, très vite, parce que c’est gourmand, c’est magique, c’est tragique, et que nos mots nous semblent précieux… Quelle prétention… Rassurez-vous, elle retombe rapidement. Le quotidien s’en charge, tente de vous rabaisser d’une manière ou d’une autre. Les hérésies, les mensonges, les cruautés vous font réagir et, parfois, remiser un manuscrit de côté (j’ai cette malchance de ne pouvoir rédiger que dans les périodes de bonheur). Bonne nouvelle : vous êtes le seul auteur du roman, prêt à modifier quelques lignes, voire des passages entiers et orienter l’histoire vers un sens inattendu. Reste à respecter un plan précis et s’en tenir à la construction. Au final, je vis ma vie d’écrivain comme celle de photographe : dans la précipitation.
Écriture et photographie, on te voit déjà bien occupée. Mais as-tu d’autres projets ou d’autres envies ?
J’ai certains soucis qui me prennent beaucoup de temps, celui que je devrais passer sur mes deux métiers. En amont, je réalise comme beaucoup d’artistes que mes revenus ne sont pas réguliers. Une stabilité financière m’est nécessaire (signé Madame de la Palisse ☺). D’ailleurs, j’ajoute que je travaille en extérieur, ce qui ralentit considérablement, voire stoppe, mon activité de photographe l’hiver. Je me suis donc offert une formation dans un secteur porteur : la prothésie ongulaire. Le travail des manucures est loin derrière ; j’ai choisi cette voie parce qu’elle me laisse conserver un pied dans l’art et que les outils principaux sont des pinceaux. J’ai mon auto-entreprise et conserve mon autonomie.
Dans un tout autre domaine, mon désir de voyages, sans cesse accentué au fil des vols, me pousse à faire dès à présent une demande de carte verte. Il ne s’agit pas de fuir mon pays mais d’avoir la latitude d’effectuer des allers et retours aux Etats-Unis. Je me suis découvert une passion singulière pour ce continent. J’avais visité le Middle West étant jeune (Missouri et Colorado) et avais totalement adopté le rythme, les coutumes de cet Etat. L’hiver dernier, grâce à l’énorme coup de pouce d’un très grand ami, j’ai fait escale en Floride. Miami est étonnante… Je ne sais pas si c’est la ville ou si c’est moi qui ai fait la démarche d’ « adoption » mais j’ai séjourné deux semaines avec d’étranges sensations, comme si la rencontre était fatale, normale, inévitable. Pour le coup, je n’ai eu aucun mal à panser quelques plaies dès le premier jour. Mieux encore, j’ai éprouvé une sérénité incroyable et l’impression sans aucun doute que j’étais bel et bien « chez moi ». Miami ne se résume pas à une plage démente et à des avenues luxueuses. Il y a de belles âmes, de belles personnes qui vous disent « God bless U » quand vous leur donnez l’heure. Certains quartiers dits défavorisés sont pittoresques, ne ressemblent à rien de ce que je connais. Je suis aussi attirée par le Maine et le Vermont, mais les valeurs saisonnières sont toutes autres.
Dieu merci, mes trois activités me permettent de me déplacer et d’exercer dans toutes les conditions. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ne plus œuvrer pour le compte d’une société, pieds et poings liés.
Quel est le dernier livre que tu as lu ? Celui que tu lis en ce moment ? Celui que tu veux absolument faire découvrir ?
En fait, je dévore tant de livres que le choix est plus que difficile. Je serais bien en mal de conseiller un ouvrage. J’aurais tendance à citer les auteurs qui m’ont carrément renversée : Claire Castillon (Le grenier), Marie Billetdoux (Prends garde à la douceur des choses), Helena Noguerra (Et je me suis mise à table) et Max Monnehay (Corpus Christine). Ces quatre écrivains tiennent dans mon cœur les rennes du meilleur restaurant littéraire, celui qui nourrirait les plus passionnés, les plus réfractaires, et ceux qui ne savent pas encore qu’un livre peut bouleverser nos cinq sens…
Le dernier livre que je suis en train de lire est atypique. C’est un recueil de miscellanées : Les miscellanées de Monsieur Schott. Un ouvrage écoulé à hauteur de deux millions d’exemplaires dans le monde.
Enfin, la question que tout le monde attend (surtout moi) : À quand la sortie de ton prochain roman ? Un mot ou deux à son sujet ?
Je suis dans une période extrêmement névralgique et peste contre cet état. J’ai un thriller en cours (un genre nouveau pour moi) qui demande une implication sans nom, une concentration énorme. J’ai du ménage à faire dans ma vie, des équations à résoudre et les calculs ne sont pas mon fort… J’ai une pente à remonter qui me freine dans mes élans et me contraint de ne surtout rien rédiger dans cet état. Il est certain que dès que mon ciel affichera une autre couleur que ce gris détestable, mon premier réflexe sera celui de terminer ce roman. J’estime en avoir écrit la moitié. C’est à ce stade de « milieu » que je reprendrai la plume. Le plus frustrant est que le plan est bien sûr achevé, les idées consignées et que ce nouveau style d’écriture me plaît… Sans rien dévoiler, je peux déjà planter le décor : l’intrigue se passe dans un climat très froid et cette notion de température est primordiale du début à la fin. Au gré des pages, on comprend qu’elle est quasiment un personnage en soi.
J’espère beaucoup de ce nouveau tournant à négocier. Tout comme Mon guide de la défume empruntait un ton très différent de celui de Céanothes et Potentilles, j’éprouverai une grande joie dans l’attente de vos retours de lecture, comme on ne peut modifier littéralement sa griffe. La mienne est radicalement musicale ; j’espère que ces nouveaux accords plairont au plus grand nombre.
Je te remercie pour cet entretien que je traduis comme un clin d’œil du destin : mon nouvel ouvrage prend déjà vie, grâce à toi, ici…
*******
Un grand merci à Martine Pagès pour ses belles réponses et sa gentillesse. Vous pouvez la retrouver sur son site et sur Twitter.