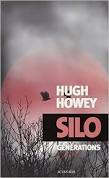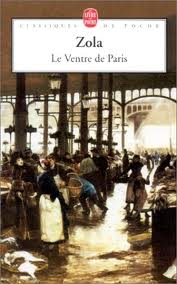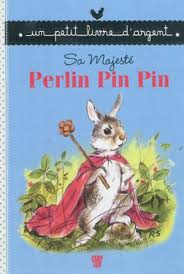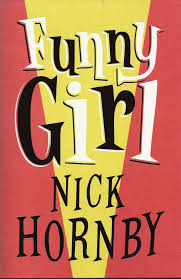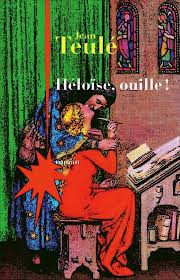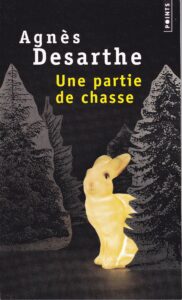Roman de Philippe Claudel.
Le métier du narrateur est d’annoncer à des inconnus qu’un de leurs proches est décédé et de demander la permission de prélever les organes du défunt. Face à la souffrance rencontrée au quotidien, le narrateur pourrait être blindé contre le chagrin, mais quand le deuil le frappe, il est aussi démuni que les autres humains. « Elle est morte, et moi je suis à peine vivant, il me semble. Je continue un peu seulement. » (p. 27) Son récit est une adresse à sa fille de vingt et un mois, bébé magnifique qui ne connaîtra jamais sa mère et dont le père n’est plus qu’une ombre. « Que je souffre de descendre dans la vie. […] Ta mère en partant m’a emmené à demi avec elle. Que ta petite main est belle mais trop petite il me semble pour retenir la mienne. » (p. 35) Sans cesse blessé par l’horreur du monde, écœuré par la joie tarifée qu’annoncent des affiches d’artistes comiques, révolté par sa propre lâcheté, il voudrait lâcher prise, abandonner. « Que peuvent tes sommeils et tes rires face à cela ? Ma petite, ma trop petite. (p. 82) Abandonner son travail, abandonner son existence. Mais a-t-il le droit, ce veuf inconsolé, de tout abandonner ?
Dans les romans de Philippe Claudel, il n’est pas besoin d’être un héros pour être un personnage. L’insignifiance et la misère sont suffisantes pour fonder une identité et l’héroïsme réside sans aucun doute dans le courage d’affronter le quotidien. La mort, Philippe Claudel sait en parler. Dans Meuse l’oubli, il évoquait déjà l’errance d’un veuf face à la rivière. Avec quelle sensibilité il pose des mots sur la peine, avec quelle délicatesse il met à nu les cœurs déchirés. Poète du deuil, ignorant du pathos qui ancre la mort dans le sinistre, il libère l’incommensurable tristesse du dernier vivant et la sublime en une expression pure des sentiments. « J’ai inventé un art de l’oubli à mon seul usage. » (p. 69) Et c’est bien cela le deuil, une expérience unique qui consiste à se réapproprier l’existence désertée par un être cher. En quelque 110 pages percutantes et éblouissantes, Philippe Claudel nous touche au cœur et fait frémir les replis de nos mémoires blessées. Ne le sont-elles pas toutes, blessées ?