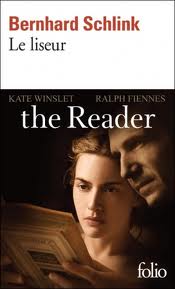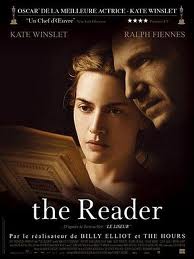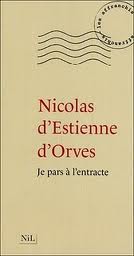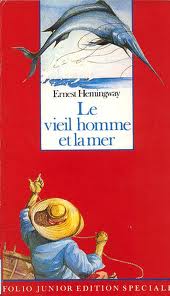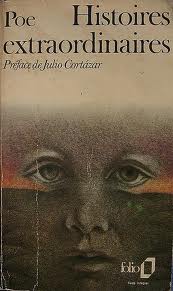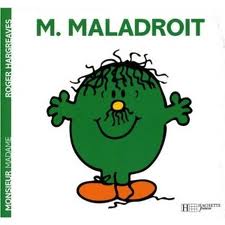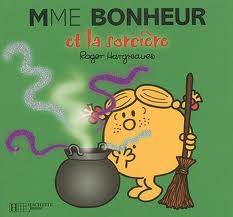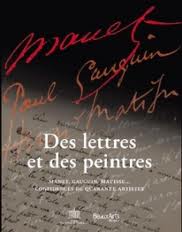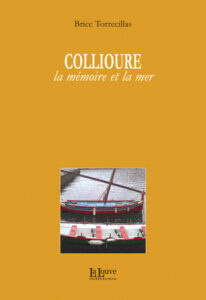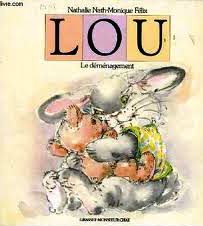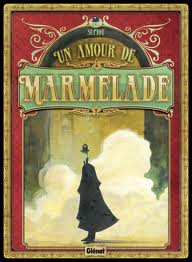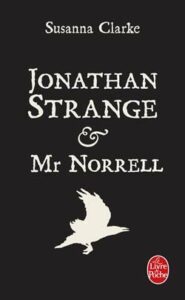
Roman de Susanna Clarke.
« La magie anglaise a été façonnée par l’Angleterre, tout comme l’Angleterre a été façonnée par la magie. » (p. 892) Et pourtant, en 1807, la magie a disparu du pays depuis quatre siècles. Les magiciens sont en fait des historiens de la magie et ils ne pensent certainement pas à pratiquer cet art. Rien ni personne ne semble pouvoir réveiller et exercer ce savoir millénaire. Pourtant une prophétie se fait entendre : il est dit que deux magiciens restaureront la magie en Angleterre.
Un homme se présente. Il s’appelle Mr Norrell. Depuis des années, il rachète tous les livres sur la magie. Sa bibliothèque est considérable. Mr Norrell est certain de pouvoir trouver l’explication de la disparition de la magie. Il est également certain que la magie peut aider son pays : « Je suis venu ici afin de me rendre utile. […] J’avais espérer jouer déjà un rôle éminent dans la lutte contre les Français. » (p. 98 & 99) En effet, Bonaparte et ses armées n’ont qu’à bien se tenir : à coup de sortilèges, Mr Norrell établit un surprenant blocus maritime. Mais les pouvoirs du magicien ne s’arrêtent pas là : avec l’aide d’un garçon-fée, il ramène à la vie une jeune et belle trépassée, Lady Pole.
Ailleurs en Angleterre vit le jeune Jonathan Strange. C’est par hasard qu’il s’adonne à la magie. Ses premiers pas dans la discipline sont vagues : il lui est impossible de trouver un bon livre pour s’exercer. Partout, Mr Norrell est passé avant lui. « Je n’ai jamais vu cet homme de ma vie. En revanche, il me barre le chemin à tout instant. » (p. 327) Devant les qualités évidentes du jeune homme, Mr Norrell s’incline et accepte d’en faire un disciple. « Mr Norrell, qui avait vécu toute sa vie dans la crainte de se découvrir un rival, avait fini par voir la magie d’un autre, et loin d’être accablé par ce spectacle, s’en trouvait exalté. » (p. 343)
Mr Norrell et Jonathan Strange gagnent rapidement en popularité. Le Tout-Londres se les arrachent et la magie est la nouvelle tocade de tout un chacun. « Désormais, il y avait donc à Londres deux magiciens à admirer et à encenser. Je doute que ce soit une grande surprise pour quiconque d’apprendre que, des deux, Londres préférait Mr Strange. En effet, Strange correspondait à l’idée que chacun se faisait d’un magicien. Il était grand, il était charmant, il avait un sourire des plus ironiques et, à la différence de Mr Norrell, il parlait beaucoup de magie et ne voyait pas d’objection à répondre aux questions du public sur le sujet. » (p. 381)
Mais l’entente entre les deux magiciens ne peut durer. Chacun développe sa propre conception de la magie et chacun définit les usages qu’on peut en faire. Alors que Mr Norrell veut garder sous contrôle le bénéfice de la magie, Strange souhaite faire des coups d’éclats. C’est au Portugal, dans la guerre contre les Français, qu’il s’illustre : meilleur soutien du duc de Wellington, Strange applique une magie originale et pleine de panache. Entre Norrell et Strange, la rupture est consommée. Désormais, c’est à qui fera assaut d’une magie plus remarquable. Mais l’Angleterre en danger les contraint de s’unir pour lutter contre une puissance malfaisante. Un certain gentleman avec des cheveux comme du duvet de chardon s’attache des vies humaines et les garde en un lieu nommé Illusions-Perdues. Pour lutter contre cet ennemi féérique, Mr Norrell fait appel aux savoirs contenus dans les livres et Jonathan Strange fait siens les pouvoirs de la nature.
Susanna Clarke offre un roman très riche et habilement construit. Elle invente un paratexte sérieux et nourri autour des personnages : elle leur trouve des biographes et elle fait surgir de nulle part une foisonnante histoire de la magie anglaise. Il est facile de sauter à pieds joints et les yeux fermés dans cet univers. L’auteure mêle à son roman des bribes d’Histoire, sous la forme de personnages réels et de références militaires. Et elle ouvre tous les champs du possible en montant de toutes pièces un univers magique complet et convaincant. On trouve un Roi Corbeau, des fées, des sortilèges oubliés, des miroirs magiques et bien d’autres choses encore.
L’auteure inscrit avec habileté son roman dans une parenté littéraire qui rend hommage à de grandes plumes. Jane Austen et Ann Radcliffe apparaissent au détour d’une page et donnent toute légitimité au texte d’être à la fois un roman de mœurs et un roman noir. Jonathan Strange et Mr Norrell est également un roman d’aventure et un conte philosophique où les hommes font preuve d’hybris. Dans une galerie de personnages secondaires qui n’en finit pas d’accueillir de nouveaux arrivants, le lecteur pourrait se perdre. Pourtant, un je-ne-sais-quoi rend chaque personnage unique, que ce soit Vinculus et son mystérieux livre, Childermass et son étrange allégeance à Mr Norrell ou le destin fabuleux de Stephen Black. Vous voulez en savoir plus ? Ouvrez le livre de Susanna Clarke !
Néanmoins, j’ai été déçue par la fin du roman. Après des centaines de pages de tension et de mystères, les révélations et les dénouements sont un peu plats, voire bâclés. Le texte de Susanna Clarke s’inscrit dans la veine des grands romans d’Heroic Fantasy. Un journaliste a comparé son œuvre à celle de Tolkien. Je ne prétends pas la même chose, mais il est indéniable qu’elle a su créer un livre-univers. Toutefois, à la différence de la saga de Tolkien ou des aventures du jeune Harry Potter, cet univers est clos sur lui-même. On n’imagine pas une suite ou des textes parallèles : Susanna Clarke a ressuscité la magie le temps d’un livre, et le temps d’un livre on y a cru. Et c’est déjà beaucoup.
Quatrième participation au Défi des 1000 de Daniel Fattore, avec 1144 pages !