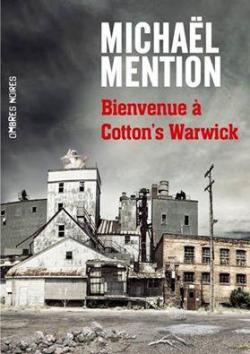
Dans le Northern australien, Cotton’s Warwick est une ville oubliée, quasi désertée, où les étrangers ne sont pas les bienvenus. Il n’y reste que seize hommes et une femme qui sont écrasés par une canicule exceptionnelle. « Descendants de bagnards et d’aborigènes violées jusqu’au sang, les Warwickiens sont fiers de leurs origines comme de leur consanguinité. » (p. 6) Il n’y a plus assez d’eau pour se laver, à peine pour boire, mais de toute façon ils préfèrent la bière. Tous se soumettent à Ranger Quinn, à ses ordres tyranniques, à la messe quotidienne et à la répétition inepte des journées. Mais voilà que l’un d’eux meurt, puis un autre et encore un autre et presque tous. Les survivants, loin de faire front commun, redoublent de cruauté les uns envers les autres, achevant le travail de destruction entamé à l’encontre de l’humanité.
La mort est rapide et s’abat en une ligne sur des personnages dont on a tôt fait d’oublier le nom tant ils étaient haïssables et peu fréquentables. La mort est visuelle, presque graphique, d’autant plus que les meurtriers sont inattendus et presque de nature divine, métaphysique. Alors que le soleil embrase l’air et que la fournaise renaît chaque matin après le couperet glacial de la nuit, les kangourous, les razorbacks, les kookaburras et les brown snakes reprennent l’ascendant sur l’Outback.
Autant j’aime le gore décomplexé de Stephen King – parce qu’il sert un propos –, autant je suis restée hermétique à l’escalade hallucinée de violence sanglante et déshumanisée de ce roman. Je n’ai pas compris le propos de ce thriller sauvage sur fond de nouvelles internationales et de musique rock. Je le laisse aux amateurs de barbarie gratuite et de fantasmes hémoglobinés !
