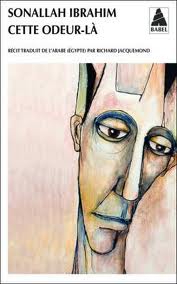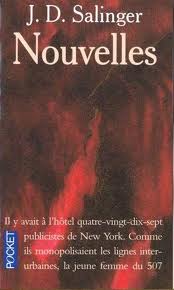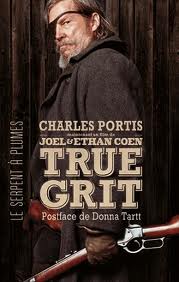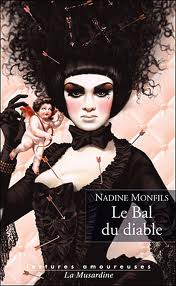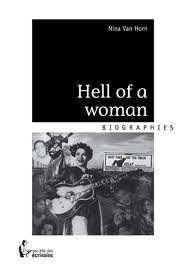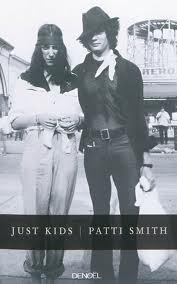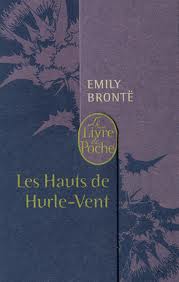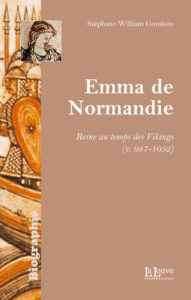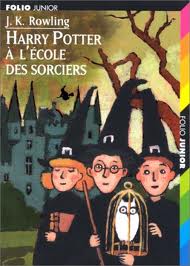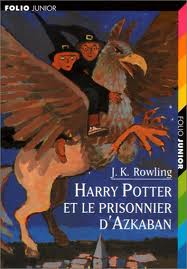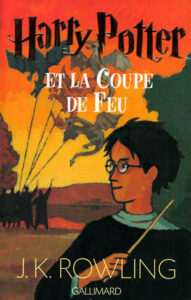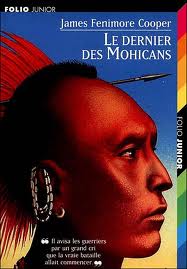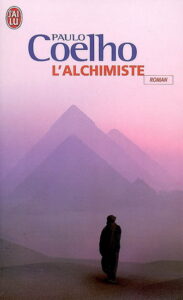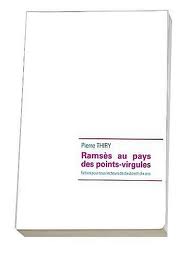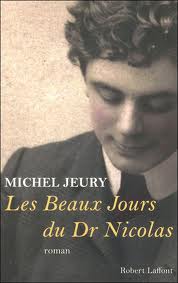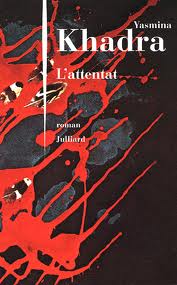ATTENTION : RÉVÉLATIONS ! SI VOUS N’AVEZ PAS LU CES HISTOIRES – ET QUE VOUS SOUHAITEZ LE FAIRE – PRENEZ GARDE AUX SPOILERS !
Harry Potter à l’école des sorciers
Au 4 Privet Drive, banlieue bourgeoise très calme d’Angleterre, un étrange vieil homme, Albus Dumbledore dépose un bébé sur le pas de la porte. Dans les langes dort Harry Potter. Ce n’est pas un garçon comme les autres. Dans leur maison de Godrick’s Hollow, ses parents viennent de mourir, tués par Lord Voldemort. Lily et James Potter étaient deux puissants sorciers qui se sont opposés au Mage Noir. Harry est également sorcier et, du fond de son berceau, il a réduit à rien les pouvoirs de Voldemort. Pendant 10 ans, il grandit chez les Moldus, les humains sans pouvoir. Chez les Dursley, il est considéré avec mépris et crainte, il dort sous l’escalier et subit sans cesse les tyrannies de son cousin, l’infâme Dudley. À l’approche de son dixième anniversaire, des faits surprenants surviennent : il parle avec un serpent et des chouettes ne cessent de lui envoyer des lettres. Ce sont des invitations à entrer à Poudlard, l’école qui forme les sorciers. Ce qu’Harry ne sait pas, c’est qu’il est très célèbre dans ce monde particulier. Arrivé à Poudlard, il se fait enfin des amis : Ron Weasley, Hermione Granger, Neville Londubat et d’autres. Mais son entrée à l’école ne lui attire pas que des sympathies : immédiatemment, il sait que le jeune Drago Malefoy sera son ennemi. Dès sa première année dans le monde des sorciers, Harry doit lutter contre le retour de Lord Voldemort qui veut s’emparer de la Pierre Philosophale. Avec ses amis et en faisant montre de courage et d’imagination, il surmonte des épreuves impressionnantes et s’illustre par sa détermination à rester du côté du Bien.
L’intrigue de ce premier tome est simple et permet d’entrer facilement dans l’univers magique d’Harry Potter. On rencontre les professeurs de l’école comme Minerva McGonagall, Severus Rogue ou Rubeus Hagrid. On parcourt les couloirs et les escaliers facétieux de l’établissement, entre les maisons de Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard, en compagnie des fantômes et des portraits animés et en se gardant de rencontrer Rusard le concierge. On frissonne à l’évocation de la Forêt Interdite qui entoure le château et des créatures qui y vivent. On découvre des cours étranges : Défense contre les Forces du Mal, Métamorphose, Divination et on se passionne pour les matches de Quidditch, le sport favori des sorciers qui se joue sur des balais volants. Si ce premier tome est clairement destiné aux jeunes lecteurs, je ne me suis pas ennuyée un instant. Les ressorts dramatiques des tomes à venir sont déjà là et les personnages sont prometteurs.
Harry Potter et la Chambre des Secrets
Après un été désastreux chez son oncle et sa tante, Harry a hâte de retrouver Poudlard et ses amis. Mais Dobby, un elfe de maison particulièrement virulent, veut tout faire pour l’empêcher de rejoindre l’école en lui annonçant de grands malheurs et de terribles dangers. Mais Harry est bien décidé à suivre l’enseignement magique que dispense l’école enchantée. Poudlard accueille un nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal, Gilderoy Lockhart, qui succède au professeur Quirrell, mort l’année précédente. Lockhart est un écrivain célèbre, bellâtre et couard, plus intéressé par l’apparence et les autographes que par l’enseignement. Des évènements tragiques jettent Poudlard dans l’effroi : des élèves et autres membres de l’école sont retrouvés pétrifiés dans les couloirs. Le message est clair : la Chambre des Secrets a été ouverte et l’arme qu’y a caché Voldemort a été libérée pour tuer les Sang-de-Bourbes et les Cracmols, respectivement les sorciers issus de familles moldues et les sorciers sans pouvoir. Les partisans de Lord Voldemort préparent son retour. Harry Potter prend conscience de ses pouvoirs de Fourche-Langue : il comprend et peut communiquer avec les serpents. Il entre en possession du journal de Tom Jedusor, un ancien élève de l’école et il doit percer le mystère de la Chambre des Secrets, bravant pour cela de nouveaux dangers qui exposent également ceux qui lui sont proches.
Dans ce second tome, nettement plus effrayant que le premier, mais toujours relativement léger, on fait davantage connaissance avec les familles Weasley (Mr et Mrs Weasley, Charly et Bill, Percy, George et Fred, Ron et Ginny) et Malefoy. On rencontre Aragog, une araignée aux dimensions inquiétantes. On croise Mimi Geignarde, fantôme qui hante les toilettes de filles. On rit toujours beaucoup mais le malaise s’installe. L’innocence de la première année vacille. À mesure que Lord Voldemort reprend des forces, le ton se durcit.
Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban
Harry Potter emprunte le Magicobus pour échapper à l’affreuse demeure des Dursley. Mais les rues ne sont plus sûres. Sirius Black, un partisan de Lord Voldemort, s’est échappé d’Azkaban, la prison des sorciers. Les Détraqueurs, gardiens de la prison et terrifiantes créatures, sont envoyés par le Ministère de la Magie pour garder les alentours de Poudlard. En effet, les risques sont grandes pour que Black tente de s’approcher d’Harry. Un nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal arrive à l’école, Remus Lupin. Son comportement étrange fait tout de même de lui le meilleur enseignant de cette matière qu’Harry et ses amis aient connu. Alors qu’Harry et Ron ne pensent qu’aux sorties à Pré-au-Lard, le village voisin, Hermione est submergée de travail : la meilleure élève de la classe travaille bien plus qu’elle ne le peut. Les cours de Divination du professeur Trelawney révèlent à Harry la présence du Sinistros, un présage de mort qui se manifeste souvent. Harry doit se défendre des menaces extérieures et lutter contre le retour de Voldemort. Mais il doit aussi apprendre à faire confiance.
Dans ce tome, le professeur Rogue devient de plus en plus incernable : Harry sent qu’il ne peut pas lui faire confiance en dépit des recommandations de Dumbledore. On rencontre Buck, un hippogriffe cher à Hagrid. On croise des Épouvantards. On musarde avec la Carte du Maraudeur et on s’enthousiasme toujours autant pour les matches de Quidditch, durant lesquels Harry fait sensation sur son nouveau balai, l’Éclair de Feu. On découvre aussi la jeunesse des parents de Harry et les amis qui ont partagé leurs années à Poudlard : Remus Lupin, Peter Pettitgrow et Sirius Black. Ce tome est intense : on suit Harry dans sa découverte de contre-sortilèges et les révélations sur son père. Au fil des pages, les mémoires des morts et des vivants sont réhabilitées. Les innocents ne sont jamais épargnés mais leurs sacrifices sont reconnus.
Harry Potter et la Coupe de Feu
C’est maintenant un fait avéré : Lord Voldemort veut vaincre Harry et achever la sinistre besogne commencée 14 ans plus tôt. Un lien unit Harry au Mage Noir : la cicatrice qu’il porte au front, marque que lui a laissée la tentative d’assassinat de Voldemort, est de plus en plus souvent douloureuse. Alors qu’Harry et ses amis pensent pouvoir profiter de la fin de l’été en assistant à la Coupe du Monde de Quidditch, la Marque des Ténèbres apparaît dans le ciel. Elle est l’emblème de Voldemort et le signe de ralliement des Mangemorts, les sorciers qui lui sont dévoués. La rentrée à Poudlard s’annonce. Le nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal – encore un nouveau – Maugrey Fol Œil est un ancien Auror, sorcier qui traque les Mages Noirs et les Mangemorts. L’année à Poudlard est sous le signe de la compétition : l’école accueille le Tournoi des Trois Sorciers qui réunit les élèves de Poudlard, Beauxbâtons et Durmstrang. Chaque école propose un champion. Poudlard a Cédric Diggory, Beauxbâtons a Fleur Delacour et Durmstrang a Viktor Krum, célèbre joueur de Quidditch. Mais un coup du sort désigne également Harry Potter. Les quatre candidats s’affronteront au cours de l’année lors de trois épreuves au cours desquelles ils devront témoigner de leurs talents magiques et de leurs qualités de cœur. La fin du tournoi est tragique : Lord Voldemort intervient, se sert d’Harry pour renaître enfin dans une enveloppe de chair et tue un innocent.
On fait davantage connaissance avec les elfes de maison et on découvre en Hermione une militante pour les droits des créatures magiques. On apprend à se déplacer autrement dans le monde des sorciers : Poudre de Cheminette, Portoloin, Transplanage, etc. On trépigne de rage à la lecture des articles que Rita Skeeters fait paraître dans La Gazette des Sorciers On découvre les Sortilèges Impardonnables dont Lord Voldemort et ses Mangemorts abusent : l’Imperium, le Doloris et l’Avada Kedavra. Si la terreur s’empare de chacun, les premiers émois amoureux et la jalousie font de même avec les jeunes cœurs des élèves de Poudlard. Avec ce tome, les aventures du petit sorcier aux lunettes rondes entrent dans le monde de l’adolescence : l’écriture est plus approfondie voire plus torturée, les épisodes gagnent en longueur et en densité, les personnages secondaires se dévoilent et prennent une vraie position dans le récit.
Harry Potter et l’Ordre du Phénix
La terreur règle dans le monde de la magie. Des Détraqueurs attaquent Harry et son cousin dans Privet Drive. Alors que Sirius, le parrain de Harry, se cache pour éviter un retour à Azkaban et une accusation injuste, Harry et ses jeunes amis découvrent l’Ordre du Phénix. Cette société secrète rassemble des sorciers entièrement dévoués à Dumbledore et à la lutte contre les forces du Mal déchaînées par Voldemort. Lupin, Sirius, les Weasley, la sorcière Tonks, Maugrey Fol Œil et d’autres sont bien décidés à ne pas laisser Voldemort prendre le pouvoir. De retour à Poudlard pour la cinquième année, où Ron et Hermione ont été nommés préfets, c’est l’année de passage des BUSE, Brevets Universels de Sorcellerie Élémentaires. Mais les choses ont changé : le professeur Dolores Ombrage, en charge du cours de Défense contre les Forces du Mal, est membre du Ministère de la Magie qui refuse de prêter foi au récit de Harry sur le retour de Voldemort. Ombrage met Poudlard sous sa coupe en se faisant nommer Grande Inquisitrice. Harry et ses amis refusent de se soumettre à la tyrannie instaurée par Ombrage et soutenue par Rusard. Il fonde l’A.D., l’Armée de Dumbledore, et enseigne aux élèves volontaires des sortilèges de défense et de protection. Ron, Hermione, Ginny, Cho Chang, Neville et bien d’autres participent avec intérêt à ces réunions clandestines qui se tiennent dans la Salle sur Demande. Alors qu’Harry fait des rêves étranges où il assiste à des attaques perpétrées par Voldemort, il comprend que le lien entre lui et le Seigneur des Ténèbres se resserre. Ce dernier attend d’Harry qu’il l’aide à trouver une arme pour le vaincre. Étrange paradoxe que finira par expliquer une prophétie vieille de 15 ans et qui causera des pertes douloureuses dans les rangs de l’Ordre du Phénix.
Les amours naissent et s’achèvent dans les couloirs de l’école. Hagrid dissimule encore et toujours d’étranges créatures dans les profondeurs de la Forêt Interdite. On entre pour la première fois à Ste Mangouste, l’hôpital qui soigne les maladies et les blessures magiques. Ce tome développe le pouvoir du Ministère de la Magie. La cruauté d’Ombrage est très bien décrite et fait peser sur le livre une tension constante. Les jours s’assombrissent, c’est l’heure pour chacun de choisir un camp et de révéler sa nature profonde. Ce cinquième, le plus lourd des sept, est merveilleusement écrit. Les épisodes et les révélations sont soignées, le suspense est palpable et il s’insinue dans chaque domaine de la vie du jeune Harry. Désormais, il n’est plus de lieu où il peut trouver la sérénité. Seule l’amitié le garde de la folie.
Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé
Les évènements tragiques survenus dans les couloirs du Ministère de la Magie ont enfin fait éclater la vérité et rendu à Harry Potter toute sa crédibilité : plus personne ne peut nier que Lord Voldemort est de retour. Il s’en prend désormais à visage découvert aux sorciers qui se mettent sur sa route et les Détraqueurs font peser une sinistre atmosphère sur le monde des Moldus. Cornélius Fudge, l’ancien premier Ministre de la Magie, a été remplacé par Rufus Scrimgeour qui cherche par tous les moyens à s’attirer la sympathie d’Harry. Les Mangemorts continuent leur œuvre funeste : le jeune Drago Malefoy prend la suite de son père en répondant à l’appel de Voldemort qui lui confie une mission secrète. Un nouveau professeur entre à Poudlard, Horace Slughorn : il aime s’entourer des plus brillants élèves, faire jouer ses relations et saisir les opportunités qui lui sont profitables. Dumbledore convoque Harry pour des leçons particulières : ensemble, ils plongent dans les souvenirs du jeune Tom Jedusor avant qu’il ne devienne Lord Voldemort. Dumbledore tente de découvrir les Horcruxes dans lesquelles le Seigneur du Mal a dissimulé des parties de son âme afin de se protéger de la mort. Harry hérite de son côté d’un livre de potions ayant appartenu au Prince de Sang-Mêlé : le manuel regorge de formules et d’indications dont Harry use sans précaution et sans se soucier véritablement de l’identité de ce sorcier qui se faisait appeler Prince. Cette négligence coûte cher à Poudlard quand les Mangemorts attaquent l’école. Les masques tombent et l’issue du combat entre le Bien et le Mal est proche.
Heureusement que Fred et George Weasley croient toujours au pouvoir du rire : les facétieux jeunes sorciers ont ouvert une boutique de farces et attrapes dans le Chemin de Traverse. Les amours adolescentes continuent de tourmenter les cœurs des élèves de Poudlard : Ron et Hermione n’en finissent pas de se tourner autour, Harry réfrene longtemps son attirance pour la jeune et jolie Ginny. Ce tome donne la part belle aux échappées temporelles : on en apprend davantage, bien qu’indirectement, sur la jeunesse de Lily Evans et James Potter, sur celle de Severus Rogue et sur celle de Lord Voldemort.
Harry Potter et les Reliques de la Mort
Harry Potter a atteint ses 17 ans. Désormais autorisé à utiliser la magie en dehors de Poudlard et débarrassé de la Trace, il a aussi perdu la protection que lui assurait la maison des Dursley, protégée par le sortilège de Fidelitas lancé par sa mère avant sa mort. Harry est vulnérable et l’Ordre du Phénix tente de le mettre hors de portée de Lord Voldemort, accusant toujours davantage de pertes tragiques. Voldemort a pris le contrôle du Ministère de la Magie. Ses Mangemorts et les Détraqueurs sèment la désolation chez les sorciers mais aussi chez les Moldus. Harry, Ron et Hermione ont choisi de ne pas retourner à Poudlard et d’accomplir la mission que leur a confié Dumbledore. Harry doit retrouver et détruire les Horcruxes, ces objets maléfiques dans lesquels Voldemort a enfermé des parties de son âme afin de se préserver de la mort définitive. Si l’Ordre du Phénix est plus uni que jamais dans la lutte contre le Seigneur des Ténèbres, le souvenir d’Albus Dumbledore est souillé par les révélations que fait Rita Skeeters dans une biographie tapageuse. La perfide journaliste révèle le passé du célèbre vieux sorcier sous un jour sombre, l’accusant de négligence envers son frère Abelforth et sa sœur Ariana et lui prêtant des ambitions maléfiques. Mais Harry reste fidèle au vieux professeur et à sa mission. À l’aide des objets hérités de Dumbledore, Harry et ses amis partent à la recherche des Horcruxes tout en suivant la piste des trois Reliques de la Mort qui, mises entre les mains d’un homme digne, le rendent maître de la Mort elle-même. Le temps presse avant que Lord Voldemort ne comprenne qu’Harry traque les Horcruxes dans le but ultime de le détruire. La connexion d’esprit et d’âme entre le mage noir et le jeune garçon n’a jamais été aussi forte. Le combat final, même s’il rassemble les partisans des deux camps, ne pourra s’achever que dans un duel à mort où la violence magique ne sera pas la meilleure arme.
Ce dernier tome, fondé sur la quête, est un enchaînement vertigineux et virtuose de batailles, de résistances et de révélations. Les rebondissements ne ménagent pas beaucoup d’espoir quant à la victoire finale d’Harry Potter. Les pertes sont tragiques et les rangs s’éclaircissent dramatiquement parmi les partisans du jeune homme. Les mariages de Bill Weasley et Fleur Delacour et de Lupin et Tonks sont des bulles d’optimisme et de bonheur qui éclatent rapidement sous la violence déchaînée des forces du Mal. Encore une fois, Harry doit apprendre à faire confiance aveuglément et accepter les sacrifices des uns et des autres. Si le badinage n’est plus à l’ordre du jour, les sentiments amoureux soutiennent les jeunes héros. Les cœurs purs doivent se résoudre au pire pour atteindre le meilleur.
Mon avis
Sept tomes, sept ans. Et de nombreuses aventures au cours desquelles on accompagne Harry Potter et ses proches. Si les trois premiers tomes sont clairement destinés à un jeune public, l’auteure développe avec brio des qualités d’écriture qui vont de pair avec la progression de la maturité de son lectorat. Elle aborde des questions essentielles qui sont celles des adolescents qui lisent son œuvre. L’émotion et l’intensité dramatique vont de pair avec les années : la plume de J.K. Rowling s’affermit et se développe et les lecteurs qui l’ont suivie depuis le début ont eu la chance de lire un texte qui grandissait avec eux.
Au cœur de cette histoire, c’est l’amour, l’affection et, en particulier, l’amitié qui président toute chose. Elles sont des ressorts dramatiques essentiels. La citation en exergue du dernier tome est parfaitement illustrée par le comportement des héros.« La mort n’est que la traversée du monde comme des amis traversent les mers. Ils continuent de vivre chacun dans le cœur de l’autre. Car ils doivent être présents, ceux qui aiment et vivent dans l’omniprésent. Dans ce verre divin, ils nous voient face à face et leur échange avec nous est libre autant qu’il est pur. Tel est le réconfort des amis dont, même si l’on peut dire qu’ils meurent, l’amitié et la compagnie sont, dans le meilleur des sens, toujours présentes parce qu’immortelles. » (Fruits de la solitude – William Penn) En lisant l’œuvre de J.K. Rowling, il semble que la vraie magie, c’est de croire et de faire vivre l’amitié.
Les récurrences d’un tome à l’autre offrent des points d’ancrage bénéfiques et rassurants. Les matches de Quidditch permettent aux personnages de se défouler mais également au lecteur de vibrer autrement. L’excitation ressentie est différente de celle que causent l’angoisse et l’inconnu. Le déroulement classique des années d’étude placent le lecteur dans un environnement familier même s’il reste original. Seul le dernier tome échappe à cette règle. Harry ne revient à Poudlard qu’à la fin de l’histoire. Le temps écoulé depuis le début du tome semble incertain : tout semble à la fois précipité mais également figé dans l’attente. Le tome 7 est une merveille d’achèvement qui clôt superbement une histoire dont les ressorts dramatiques et les indices ont été semés au fil de chaque tome.
L’univers littéraire créé par l’auteur est une merveille de précisions et de détails, un réel ravissement pour le lecteur qui est immergé dans un monde complet, réaliste et fidèle à son propos de bout en bout. Au même titre que Le Seigneur des anneaux, Harry Potter s’impose comme un cycle à part entière, une somme littéraire indéboulonnable des meilleures étagères, un chef d’œuvre de la littérature britannique contemporaine.
******
Mission accomplie pour le Défi des 1000 de Daniel Fattore ! J’ai lu les trois premiers tomes en édition Folio Junior, soit respectivement 302, 360 et 461 pages. J’ai lu les quatre autres tomes en édition Gallimard grand format (et poids lourd …), soit respectivement 652, 976, 715 et 810 pages, pour un total – qui me rend baba – de 4276 pages ! Pour faire mieux, il faudrait que je lise l’intégrale de Dune de Frank Herbert …