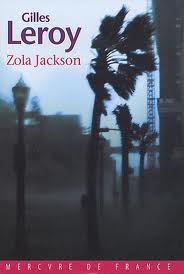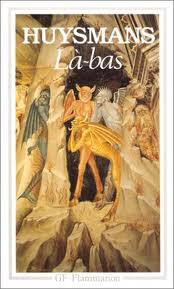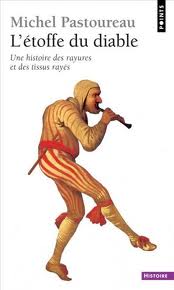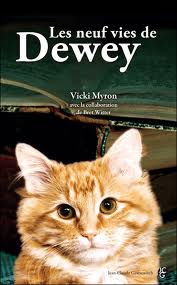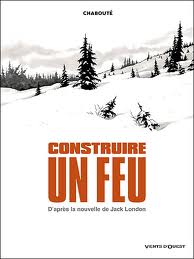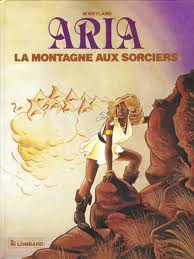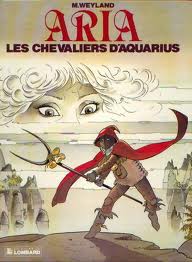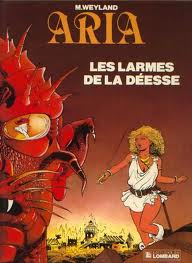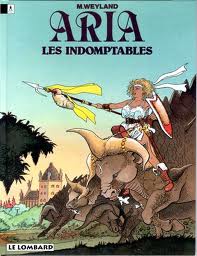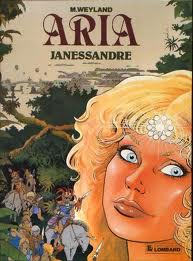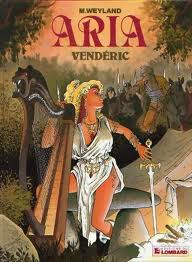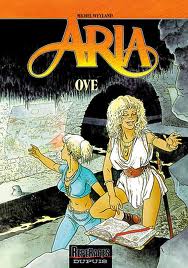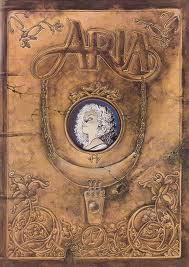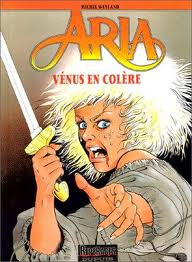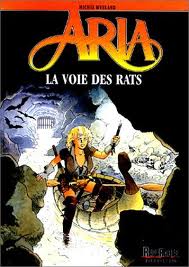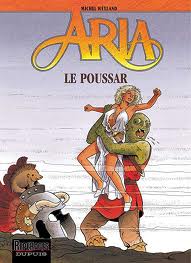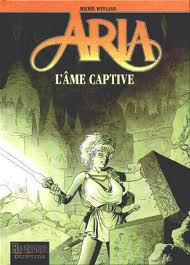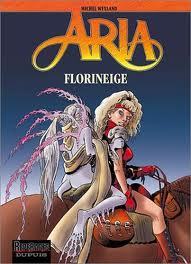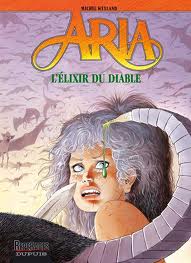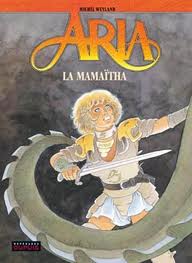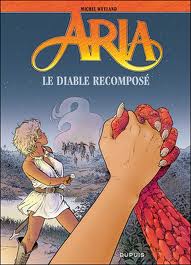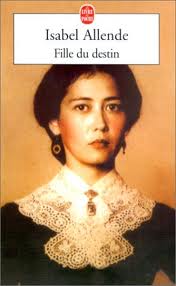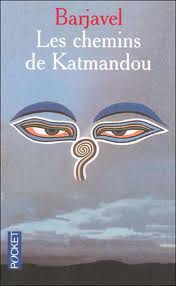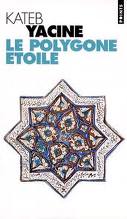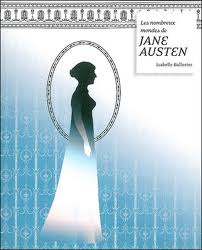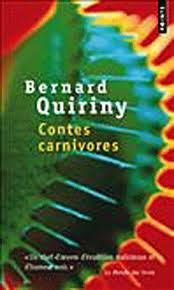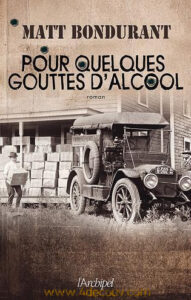Bandes dessinées de Michel Weyland, mises en couleurs par Nadine Weyland.
L’idée me trottait dans la tête depuis quelques temps: chroniquer une série complète de bandes dessinées. J’ai choisi la série des aventures d’Aria, dont le graphisme et l’univers fantastique et ésotérique m’ont toujours éblouie.
La fugue d’Aria – Jeune, jolie et blonde, Aria est chef militaire. Elle est engagée pour entraîner une cohorte d’hommes de l’armée de Suryam, en guerre contre celle de Galbec. Fine tacticienne, elle déjoue les ruses de ses ennemis et offre la victoire à Suryam.
La Montagne aux sorcières – Sur un territoire que se disputent deux frères, d’étranges spectres effrayent la population et vicient l’air. Aria doit affronter les sorciers à l’origine de ces manifestations, déjouer les desseins d’Elfa la magicienne et délivrer le mage Kapal de l’emprise d’un pirate sans foi ni loi.
La septième porte – Aria rencontre une étrange enfant, Arcane, douée d’un pouvoir guérisseur hors du commun et d’un don de double vue. Achtanga, chef de guerre, compte bien tirer profit des extraordinaires pouvoirs de l’enfant. Mais c’est compter sans Aria qui percera le secret de la septième porte.
Les chevaliers d’Aquarius – Un étrange voyageur nommé Strabalas, vêtu d’une cape rouge et portant un masque impénétrable, révèle à Aria l’existence d’un lac miraculeux qui donne jeunesse et force à quiconque se baigne dans ses eaux. Cette promesse attire les foules. Mais qu’en est-il vraiment de l’eau de ce lac et des desseins de Glore, ancien esclave avide de vengeance ?
Les larmes de la déesse – Aria avertit le royaume de Dragunda des projets belliqueux de Glore. Mais les chevaliers d’Aquarius sont déjà là. Soumise au bon vouloir de Glore, Aria ne perd rien de son tempérement aventureux et de son esprit de justice. Combattre Glore n’est pas suffisant, il faut neutraliser le lac et tarir les larmes de la déesse.
L’anneau des Elflings – La saison des amours est arrivée pour les Elflings. La saison de la chasse aussi pour les humains cupides qui veulent s’emparer de ces graciles créatures des bois. Le jeune Lyoll et Aria ont fort à faire pour préserver le paradis amoureux et naturels des Elflings.
Le tribunal des corbeaux – Une famille de nomades est sur les traces de sa fille, Zdaïne, qui a été enlevée. Aria se joint à eux et découvre un odieux trafic de femmes à Formoria, où des corbeaux rendent la justice d’une bien étrange manière.
Le méridien de Posidonia – Un vieil homme mégalomane tue à la tâche des esclaves qui lui construire un trône taillé dans la pierre, sur le méridien de Posidonia. Faite prisonnière, Aria va briser les chaînes des captifs et mettre à mal les rêves de puissance de Zonkre.
Le combat des dames – Première incursion dans le passé d’Aria. On la découvre enfant, victime d’un sacrifice orchestré par le maître de Tarvelborg. On la retrouve adulte, en route pour les tournois de Tarvelborg, qui attirent les aventuriers en quête de gloire et de trophées. En retrouvant Orsalne et Zorkof, Aria renoue avec son passé et soulève le voile qui recouvre ses souvenirs d’enfance.
Œil d’Ange – Un livre de révélations, le Livre de Phaëlgal, reste indéchiffrable sans les effets conjugués d’une gornexe, fleur de pierre à dix pétales, et d’une femme. Aria est la femme de la situation: elle part en quête de la fleur aidée d’Œil d’Ange, un jeune homme chanceux au don de double vue. Le manuscrit déchiffré prédit à Aria un destin extraordinaire.
Les indomptables – Les habitants de la ville d’Orquerolles sont sous l’emprise d’un alcool mortel, le nak. Aria, aidée des tauroks, des bêtes sauvages dites indomptables, renverse celui qui tirait profit du breuvage.
Janessandre – Un nouveau continent, l’Améronne, regorge de richesses. Sur le port, Aria retrouve Glore et rencontre son épouse Ganièle qui lui ressemble comme une sœur. Embarquée de force sur un navire en partance, Aria découvre une nouvelle terre exotique et un peuple privée de sa déesse, Janessandre. À l’aide de la gornexe, Aria recrée la statue détruite de la divinité et libère une fureur qu’elle ne soupçonnait pas.
Le cri du prophète – Débarrassée de Glore, Aria a repris la route. Elle rencontre une communauté recluse dans une vallée dissimulée et retrouve Arcane qui a bien changé. Les prophéties du livre de Phaëlgal commencent à se réaliser et Aria offre à Ganièle et Œil d’Ange un présent très particulier.
Le voleur de lumière – Aria revient encore une fois à Tarvelborg et avance sur le chemin de ses souvenirs perdus. Un ami de son père lui révèle que son héritage lui a été dérobé, des sceptres de lumière aux propriétés mystérieuses.
Vendéric – Aria rencontre un frône, un joueur de harpe nommé Vendéric, qui vient de la lointaine contrée d’Arnolite. C’est un pas de plus vers le pays de son enfance. Mais il ne fait pas bon s’attarder dans le royaume du cruel empereur Cirénodule. Dotée d’une nouvelle mémoire et d’un savoir puissant, Aria part sur les routes pour libérer les esprits du joug de Cirénodule et secourir l’Arnolite.
Ove – Aria entre en possession d’un manuscrit qui raconte l’âge d’or d’une civilisation idyllique dans laquelle Ove et son époux Guévrenne vivaient heureux 500 ans plus tôt. Quand Aria rencontre Ove réincarnée, elle décide de l’aider à retrouver son amour perdu et la Plénade, le pays où les femmes sont les égales des hommes et où Guévrenne semble détenir le secret de la longévité.
La vestale de Satan – Aria trouve sur sa route une forêt diabolique qui réagit aux sentiments humains. Ce jardin de satan dissimule un temple d’or qui attise les convoitises. Attiré par la gloire et la richesse, Rénaël, le fils de Guévrenne, s’aventure dans la forêt, suivi de prêt par Aria. Sous les arbres, ils découvrent bien plus que l’or, ils comprennent le secret d’éternité que garde jalousement Guévrenne.
Vénus en colère – Une rencontre sur les chemins plonge Aria au cœur des souvenirs qu’elle avait occultés. Les années qui ont suivi le massacre de ses parents lui reviennent. Elle retrouve la bande d’enfants avec laquelle elle a été élevée, entre rapines et prostitution. Après des années d’errance et de traumatisme, elle peut enfin venger l’enfant qu’elle était. Et retrouver son premier amour, Tigron.
Sacristar – Tigron à ses côtés, Aria tente d’oublier son passé. Ils rencontrent une tribu d’amazones qui luttent contre un tyran, Sacristar. L’homme porte dans ses souvenirs une haine tournée vers un village entier.
La fleur au ventre – Aria est enceinte. Elle prend la route pour l’Arnolite, pays de musique et de paix, pour mener une grossesse paisible. Mais le chemin est loin d’être sans embûche: elle rencontre Arobate, un homme aux buts inavouables.
La griffe de l’ange – Le bébé d’Aria est né. Mais, surprise, il est couvert d’écailles et de griffes, grandit à une vitesse surprenante et communique par la pensée. Tigron refuse ce fils qui ne lui ressemble pas. Le jeune Sacham est hanté par un esprit et une sagesse millénaires. Il semble que le bain forcé d’Aria dans le lac d’Aquarius ait laissé des traces.
La voie des rats – Sacham est hanté par la vision de son père essayant de le tuer. Pour exorciser la peur, il décide de faire sa connaissance. En chemin, il rencontre Marvèle dont il tombe amoureux et il se découvre de surprenants pouvoirs curatifs qui déclenchent des jalousies.
Le poussar – Au pied de son chateau en Arnolite, Aria découvre un coffret remplies de lettres à l’adresse de Plume de Talébert, à Verturion. Plume se révèle être un enfant démuni auquel on a arraché son poussar, un talisman indispensable.
L’âme captive – Un homme a disparu sous l’effet d’un rayon. De lui ne subsiste qu’une bille chaude et colorée contenant son âme. Seul le souffle d’un draguédon peut briser la bille et libérer l’esprit captif. Dans son aventure, Aria découvre une puissance destructrice issue du fond des âges.
Florineige – Droguée et embarquée à son insu sur un drakkar, Aria se réveille en pleine mer avec d’autres prisonniers. Enrôlés de force dans la marine de Xarsiar, un seigneur redoutable, les nouvelles recrues doivent chasser des xérènes, fabuleuses créatures des mers. Aria fait sienne la cause des xérènes et met tout en œuvre pour sauver l’une d’elles, Florineige.
Le jardin de Baohm – Furia, fidèle cheval d’Aria, est blessé par la pointe d’une lance empoisonnée et la folie s’empare de lui, le poussant à disparaître, emportant les quelques biens et les armes de sa maîtresse. Aria part à sa recherche et rencontre une communauté, le jardin de Baohm, qui obéit à un gourou charlatan qui abuse du scalista-flocart, un champignon d’Améronne aux propriétés dangereuses.
Chant d’étoile – Aria se languit de son fils Sacham, parti vivre sur les routes avec Marvèle. Des cauchemars funestes à son sujet la poussent à sa recherche. La mère qui sommeille dans le cœur d’Aria est aussi farouche que la guerrière. Aria découvre le mal qui ronge son fils et le sauve d’un danger encore plus pernicieux.
L’élixir du diable – Aria, Sacham et Marvèle sont en route vers Vandore afin d’y soigner la famille du gouverneur. Ils font la connaissance du nain Crafouille ainsi que de l’étrange communauté des Krylfes. Aria doit maintenant se séparer de ses deux petits amis ailés. Mais d’autres Krylfirs venus en masse s’en prennent à elle.
La poupée aux yeux de lune – Une bande de saltimbanques détrousse des villageois en les hypnotisant avec une étrange poupée avant de les tuer dans leur demeure. Ils s’attaquent au château d’Aria que garde sa fidèle amie Rexanne. Aria rentre à temps pour sauver son amie. Tandis qu’une frônesse naine soigne Rexanne, Aria se lance à la poursuite de cette funeste troupe.
Renaissance – Envoyée par l’Arnolite en Ovéron pour nouer des relations commerciales, Aria est victime de la foudre. Gravement brûlée, elle est soignée par un guérisseur adepte de remèdes très naturels. À son réveil, elle s’est oubliée et ne parle que de Sacrale, une femme condamnée au bûcher cent ans auparavant pour avoir résisté à l’envahisseur trigyre. Le peuple d’Ovéron reconnaît en Aria la guerrière légendaire et attend d’elle de nouveaux exploits et une aide providentielle.
La Mamaïtha – Aria a retrouvé ses esprits et a pris les armes pour sauver le peuple d’Ovéron de la cruelle férule de Dragannath. Il lui faut l’aide de la Mamaïtha, fille d’un dieu, pour mener à bien sa mission. La jeune femme a le pouvoir d’absorber le mal-être des autres, mal qui se concentre en elle pour donner un fruit particulier.
Le diable recomposé – Aria retrouve ses amis Krylfes et pressent les malheurs de Sacham. Elle le retrouve en proie au mal d’amour et au mal d’Aquarius, couvert d’écailles. Pour les villageois, il est le diable recomposé et une menace. Aria emmène son fils en Arnolite pour le sauver encore une fois.
*****
Les premières aventures d’Aria, publiées dans le journal de Tintin, sont violentes mais légères, elles s’achèvent et laissent la place aux suivantes. « Ma vie est une chevauchée passionnante à travers le monde. » (p. 8 – Le tribunal des corbeaux) Aria est encore une jeune aventurière, guerrière à ses heures, libre avant tout. Elle joue de ses charmes et de sa prétendue fragilité pour envoûter les hommes, gagner leur confiance, se tirer d’affaire et mener à bien ses projets. Son épée au service de la justice, elle parcourt le monde en quête d’aventures et de révélations. Valeureuse et courageuse, elle dissimule des blessures tenaces. Farouche avec les hommes, son cœur est à prendre, mais au terme d’un long combat.
L’univers d’Aria se déploie dans un monde que l’on pourrait croire légendaire et mythologique mais qui est davantage post-apocalyptique : « Mon grand-père me racontait des légendes terrifiantes où il était question notamment d’une énergie porteuse à la fois de vie et de mort selon la manière dont on l’utilisait, de pollutions meurtrières… mon grand-père m’a montré ce dessin […] ce symbole était synonyme de danger, de mort, de destruction. » (p. 45 – Les larmes de la déesse) Et, de fait, Aria découvre des armes étranges, des outils issus de technologies oubliées, des substances mortelles qui ne sont pas sans rappeler les dangers du nucléaire et de l’uranium.
Aria change de contrées au gré de ses aventures et explore des mondes aux accents orientaux, latins, nordiques, africains, etc. Sur son cheval, Furia, bel étalon blanc aux airs de licorne, elle parcourt le monde sans s’encombrer de bagages. Instinctivement, elle éprouve de la sympathie pour les opprimés et sait reconnaître les cœurs sincères. Aria rencontre souvent des enfants, témoins de mondes plus purs, souvent victimes de la barbarie et de l’ignorance. Les animaux, parfois inquiétants et fantastiques, se révèlent aussi des compagnons fidèles et doués d’humanité.
Il y a un humour particulier dans le choix des noms et des personnages. L’auteur prend plaisir à croquer et à griffer certaines célébrités. Ainsi Calista Flockhart devient un champignon hallucinogène et Mimie Mathy est une guérisseuse.
Les aventures d’Aria sont teintées de mysticisme, de poésie, de philosophie et d’humanité. L’auteur dépeint des mondes soumis aux désirs coupables des hommes: l’orgueil, l’avarice, la luxure, la mégalomanie, l’ivresse du pouvoir sont dépeintes sans concession. Par un trait habile, les personnages portent sur eux la marque de leur vice. Aria, lumineuse voire solaire, échappe toujours aux sévices et ressort toujours plus fortes des épreuves auxquels les monstres inhumains la soumettent.
Bref, voici une série que j’aime beaucoup et qui n’a pas fini de me surprendre !