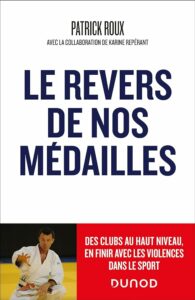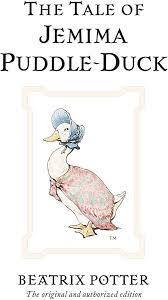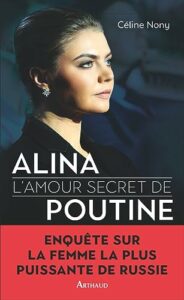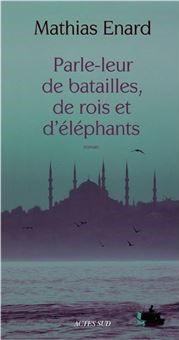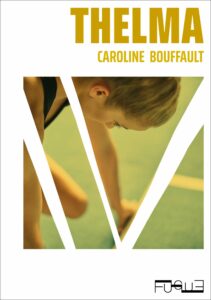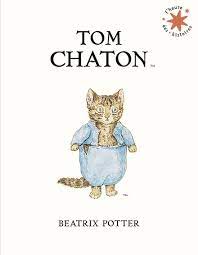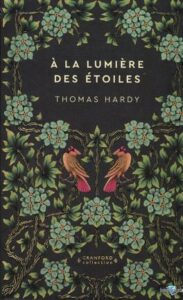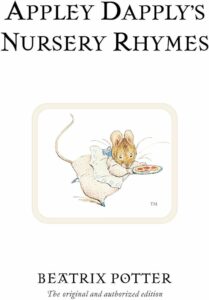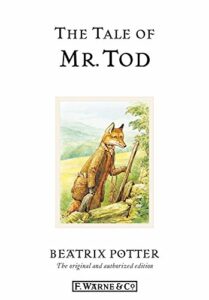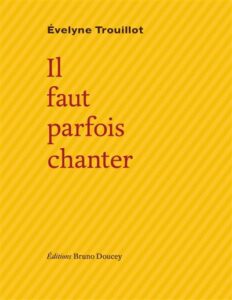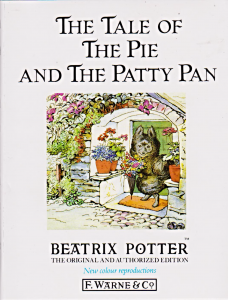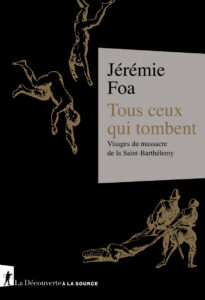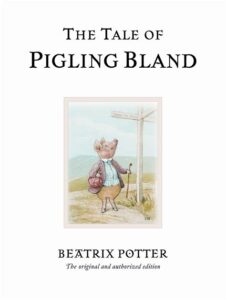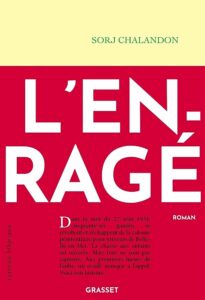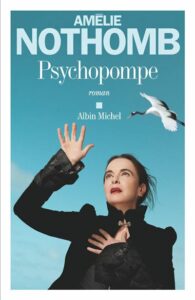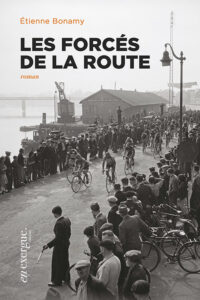
Quatrième de couverture – Porté au milieu de l’été 1942 par l’Occupant allemand et les collabos français, le Circuit de France se voulait une copie du Tour de France cycliste, mis en sommeil dès 1940. Du 28 septembre au 4 octobre 1942, les organisateurs embarquent une élite de 72 coureurs français, belges et italiens dans cette galère : 1 650 kilomètres en six étapes, un circuit conçu à la hâte et couru de Paris à Paris en une semaine, à travers une France fendue par la ligne de démarcation. Imaginé comme un tour de force tandis que le pays vit sous le joug allemand, il tourne à la farce ; tout y est presque improvisé et l’on manque de tout. Étape après étape, le roman redonne vie aux coureurs et suiveurs, devenus malgré eux les hérauts d’un épisode méconnu du sport français, aussitôt oublié. Mais le franchissement de la ligne de démarcation ne sera pas sans conséquence…
Le truc bien, quand on n’a pas de mémoire, c’est qu’on peut prendre des notes. Le truc embêtant, quand on perd ses notes, c’est qu’on n’a pas de mémoire… Je vais faire de mon mieux pour parler un peu de ce roman historique.
J’ai suivi avec enthousiasme cette course cycliste orchestrée par Günther Kezer, major de la Wehrmacht, et Jean Leulliot, journaliste sportif pour La France socialiste. Voilà un épisode historique dont je ne savais rien et qui se prête parfaitement à la littérature tant tout semble matière à rebondissements ! La Résistance fait partie du tableau et le sport lui-même se fait politique. « Il fallait profiter de quelques kilomètres de roue libre avant de passer aux travaux forcés, tous en étaient persuadés. » (p. 47) Avec cette lecture, je ressens une nouvelle fois combien sport et littérature ont d’affinités : les athlètes ont l’étoffe des héros et les compétitions sont parfois des odyssées fabuleuses.
Lu dans le cadre du Prix Sport Scriptum 2023.