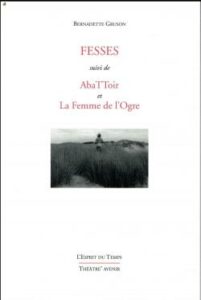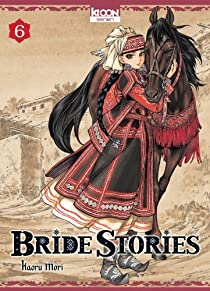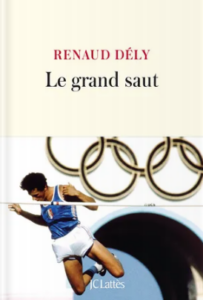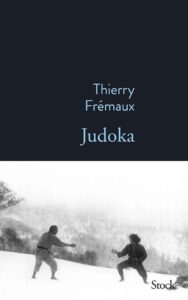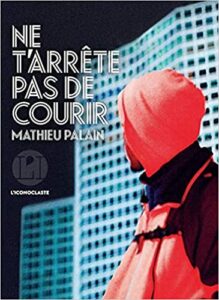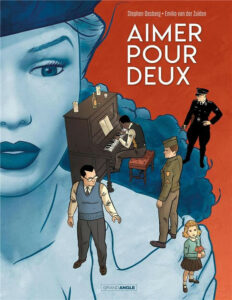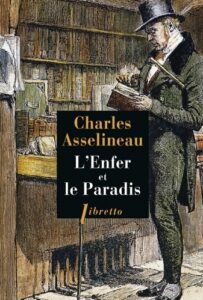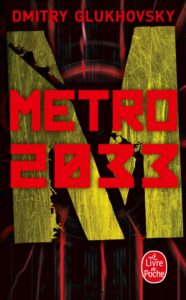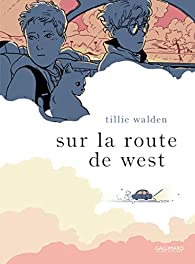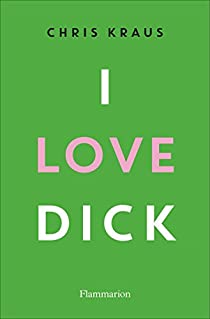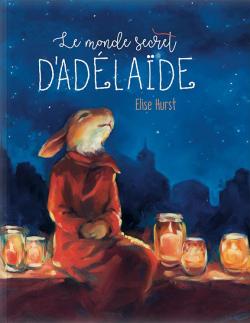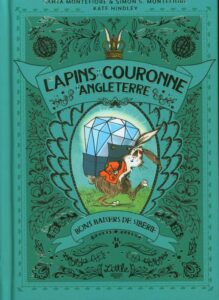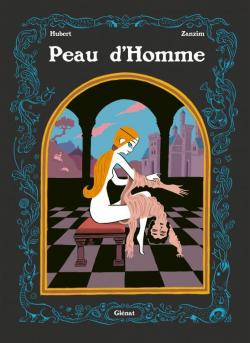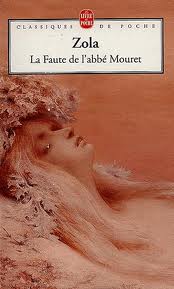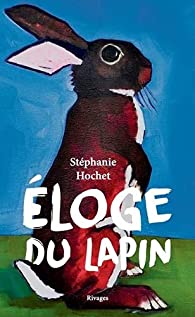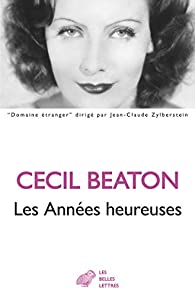Bande dessinée de Wilfrid Lupano (scénario) et Stéphane Fort (dessins et couleurs).
En 1832, dans une petite ville du Connecticut, Prudence Crandall décide que son école de jeunes filles accueillera désormais des élèves noires. La première est Sarah, suivie de plusieurs dizaines de jeunes noires venues de villes et d’états différents. Mais l’accueil dans la ville est plus que glacial : personne ne veut de ces Noires qui se piquent d’apprentissage. « Je préfère les nègres qui rejettent notre société à ceux qui cherchent à s’y glisser par tous les moyens. » (p. 116) L’affaire fait tant de bruit qu’elle aboutit à des procès et à une loi édictée par l’état du Connecticut. L’objectif est toujours d’empêcher ces jeunes filles de s’éduquer et de fermer l’école Crandall. Les élèves sont lucides, mais surtout déterminées et courageuses. Apprendre, elles en rêvent et elles le méritent : personne ne les en privera ! « Des femmes noires instruites auront des enfants instruits, qui auront des enfants plus instruits encore. Ils ne veulent pas que ça commence. Et ça commence ici. » (p. 86)
Très fortement inspirée de faits réels, cette histoire se déroule 30 ans avant l’abolition de l’esclavage : dans les états où les Noirs sont libres, les anciens esclaves n’ont cependant pas de droits, dont celui de fréquenter l’école. « Éduquer quelques noirs, bon, à la limite… Mais pourquoi justement ICI, dans notre ville ? […] Et d’ailleurs, pourquoi des filles ? En quoi cela va-t-il les aider dans leurs tâches quotidiennes ? Ça n’a pas de sens ! Ça risque de laisser penser à ces négresses qu’elles valent les blanches. » (p. 25) À la fin de l’ouvrage, des portraits courts des jeunes élèves racontent leur existence après leur passage dans l’école. Toutes ont mené une vie faite d’engagement dans la cause abolitionniste et leur lutte en faveur de l’enseignement des Afro-Américains. Les dessins sont très doux, avec des traits peu appuyés qui laissent beaucoup à l’imagination. Les couleurs et les ombres sont parfaitement maîtrisées et rendent à merveille l’époque et ce que l’on imagine être l’ambiance d’alors.
Voilà un ouvrage qui prend évidemment place sur mon étagère de lectures féministes !