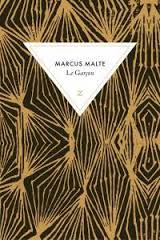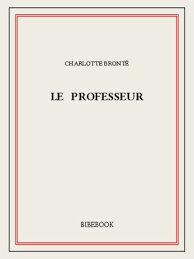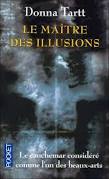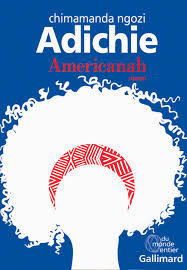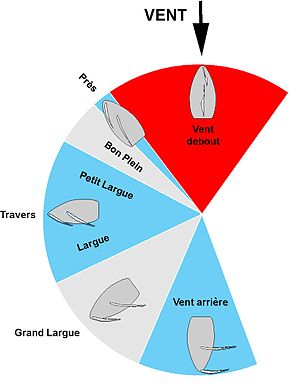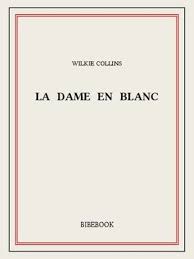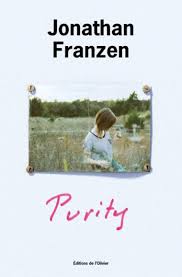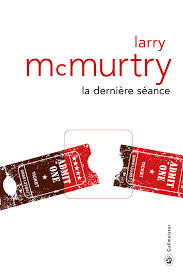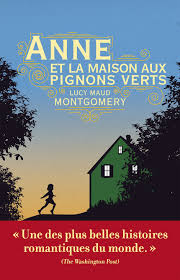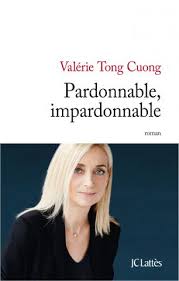Essai de Loïs H. Gresh et Robert Weinberg.
Sous-titre : De Carrie à Cellulaire, la terrifiante vérité derrière la fiction du maître de l’horreur.
Si la marque de Stephen King est l’horreur, les ressorts de cette dernière ne sont pas (que) des monstres sanglants, mais des sciences qui ont dégénéré, donnant des personnages inquiétants et dérangeants ou encore des machines animées de sombres intentions envers les hommes. « Avec Stephen King, l’humanité profite rarement de la science. » (p. 8) Les pouvoirs psychiques de Carrie ou Charlie sont terrifiants, tout autant que le comportement haineux de Christine, bagnole démoniaque, ou d’une presse à linge qui broie les ouvriers.
Les deux auteurs remontent aux sources de bien des théories : télékinésie, extraterrestre, intelligence artificielle malveillante, voyage dans le temps ou super-virus qui décime l’humanité, Stephen King n’a rien inventé, mais il a su faire à sa main les grandes terreurs humaines nées de la science pour les rendre profondément modernes et, par conséquent, bien plus terrifiantes. « Dans tous ses livres, il pose la question universelle : que se passerait-il si ? » (p. 50) Ses sources et ses inspirations sont nombreuses, et il sait glisser des références et des clins d’œil dans ses œuvres, prouvant ainsi son érudition et son intelligence.
Pour apprécier cet ouvrage, il est évident qu’il est préférable d’avoir lu un certain nombre des textes de Stephen King, de Carrie à La tour sombre, d’autant plus que les romans se répondent entre eux et forment un gigantesque puzzle narratif, un impressionnant univers littéraire. « Le plus grand talent de Stephen King est sa capacité à mélanger l’horrible à l’ordinaire. Ses romans, comme ses nouvelles, mettent en scène des gens normaux, comme vous et moi, qui rencontrent le bizarre, l’étrange et le monstrueux. » (p. 6) Preuve irréfutable avec Cujo : le gros saint-bernard autrefois débonnaire qui terrorise tout le monde lors d’un épisode caniculaire a simplement été mordu par une chauve-souris enragée. « King et Alfred Hitchcock partagent cette habileté de nous faire peur par la psychologie au lieu de mettre en scène des monstres ou de montrer du sang. » (p. 222) Pourquoi a-t-on peur de Cujo ? Parce qu’il est follement agressif, parce qu’il empêche une mère et son enfant de quitter leur voiture sans climatisation exposée en plein soleil, parce que ce qui aurait dû être une journée tranquille dans une petite ville devient une fournaise interminable.
Cet ouvrage n’est pas inintéressant, mais il souffre de quelques faiblesses, à se demander si les auteurs ont lu attentivement les romans dont ils parlent puisqu’ils les résument au mieux grossièrement, sinon avec des erreurs. En outre, certaines théories et conclusions sont hâtives et, selon moi, un peu bâclées. « Lisez n’importe quel livre de Stephen King pour observer la méfiance de l’humanité et la haine de l’étranger. C’est peut-être pour cela que les livres de Stephen King sont si populaires. Ils jouent sur nos peurs les plus profondément ancrées et notre terreur collective de l’inconnu, y compris des étrangers. » (p. 106) Ce n’est pas faux, mais les auteurs semblent méconnaître l’importance de l’amitié, de la famille et de la communauté. Certains héros de Stephen King sont curieux, courageux et ouverts au monde, même si la confrontation avec des forces malveillantes les oblige à se protéger. « Comme la science chez Stephen King est un mélange de science et d’horreur, il part du principe que les étrangers seraient forcément hostiles. » (p. 96)
Un autre reproche que je fais à cet ouvrage est de présenter des sujets scientifiques très complexes, comme la théorie des cordes ou les trous de ver. C’est certes passionnant, mais ça ne sert pas vraiment le propos du livre. Pire, les auteurs tentent à toute force de rattacher les romans de Stephen King à ses théories. Parfois, c’est crédible, parfois, c’est manifestement tiré par les cheveux… La conclusion est intéressante en ce qu’elle ramène au fonds de commerce de Stephen King, à savoir foutre les chocottes à ses lecteurs, mais elle ne dit rien du postulat des deux auteurs de l’essai : quid de la science ? Plus rien. « Il vaut mieux se permettre certaines peurs, comme celles de chiens tueurs ou de rôdeurs psychotiques. Si nous faisons disparaître la peur, comment pourrons-nous combattre Ça ou Les Tommyknockers ? » (p. 238)
Bref, cet essai n’est pas dénué d’intérêt, mais à lire avec circonspection et en connaissant un peu son King. Moi, fan ? Si peu…