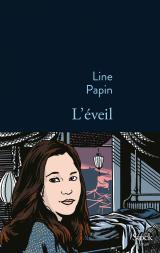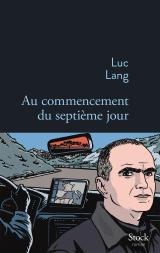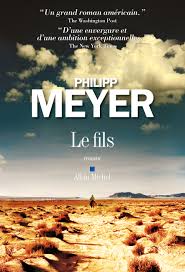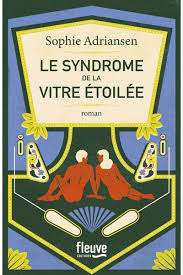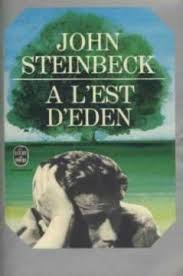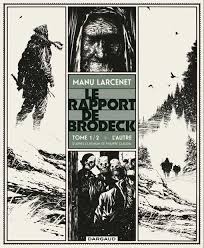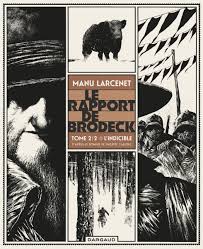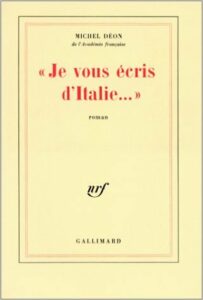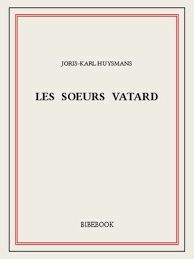Constantin Cavafy et son frère John ont quitté Alexandrie et leur famille pour faire un tour d’Europe. Alors que l’affaire Dreyfus secoue encore Paris, Constantin essaie de faire publier ses poèmes par Jean Moréas. Mais ce dernier, en trois mots, prononce une sentence douloureuse que le poète ressasse jusqu’à la nausée. Ses efforts et son acharnement ne semblent pas porter de fruits. « Ça faisait si longtemps qu’il travaillait sur ce poème et voilà qu’il lui fallait de nouveau se pencher dessus. Non, il ne pouvait pas le jeter. Il y avait de la force là-dedans. Il était remarquablement conçu. » (p. 33) Pendant des nuits entières, dans sa petite chambre et à la lueur des bougies, il reprend les mêmes vers, les mêmes mots et travaille avec obsession. « Il aspirait plus que tout à s’affranchir du lyrisme et des fioritures, à extirper le superflu, à trancher dans le gras pour aller droit à l’os. » (p. 63)
Autre chose l’obsède et le tourmente, la beauté des hommes. De cet homme surtout, si jeune, si lumineux, aperçu un soir et jamais oublié. L’évocation de ce souvenir est alors puissamment érotique et sensuelle. « On pourrait les mordre ces lèvres et elles pourraient vous le rendre passionnément, et ensuite comme on se retirerait pour les contempler, repérer un infime soupçon de débauche se dessiner aux commissures, les marques invisibles d’un probable vice. » (p. 128) Constantin passe d’un extrême à l’autre, entre morosité trouble et exaltation dangereuse, à la fois poussé et freiné par ses désirs. « Qui sait s’il ne se promenait pas dans le même quartier. Si leurs trajectoires ne les rapprochaient pas l’un de l’autre à chaque instant. Une si douce nuit. Les poèmes pouvaient attendre. » (p. 159) Mais le beau garçon a été avalé par Paris et le poète reste seul avec son désir qui est tellement lié au souvenir de sa mère, image horrifique de femme vieillissante en quête d’affection.
Constantin maudit les maîtres qui l’écrasent par leur talent, comme si leur présence tutélaire bloquait son inspiration. Mais il ne cesse jamais de chercher, même quand le désespoir guette et s’insinue dans chaque instant. « Et cependant il y avait des poèmes qui se concentraient simplement sur un infime détail, songea-t-il. Ils attrapaient un fil, une petite trame du cycle de la vie. Une chose presque inexistante dans le fatras général des passions et des évènements. Ils l’attrapaient et le décortiquaient. Et ces compositions qui s’inspiraient d’un rien s’avéraient être parfois des chefs-d’œuvre. Ils l’attiraient, ces poèmes-là. » (p. 155) Il est souvent pris d’une envie de tout détruire, de faire table rase et d’annihiler son œuvre. Éternellement insatisfait, Constantin est près de céder la tentation du néant pour ne pas subir la douleur du rejet, aujourd’hui ou demain. « Que l’œil de quelqu’un tombât sur un vers inachevé, un poème en cours d’écriture, l’eût fait bondir hors du tombeau. » (p. 230) Finalement, que retiendra l’histoire de Constantin Cavafy ?
Je ne connaissais pas ce poète largement reconnu en Grèce. Le portrait qu’en fait Ersi Sotiropoulos est tourmenté, flamboyant, digne des poètes maudits français. Je regrette un peu qu’il n’y ait pas plus de ses poèmes dans le roman. Les quelques vers qui sont présentés montrent une inspiration familiale profonde, une sorte de mythologie des origines. Tant que ça ne tombe pas dans l’autofiction qui me déplaît tant, ce substrat littéraire m’intéresse beaucoup. Je vais chercher à en savoir un peu plus sur le poète et je vous laisse avec le sublime incipit de ce texte.
« La Terre semblait encore plate alors et la nuit tombait d’un coup jusqu’aux confins du monde, là où quelqu’un de penché vers la lumière de la lampe pouvait voir des siècles plus tard le soleil rouge s’éteindre sur des ruines, pouvait voir, au-delà des mers et de ports dévastés, ces pays qui vivent oubliés du temps dans l’éclat du triomphe, dans la lente agonie de la défaite. » (p. 13)