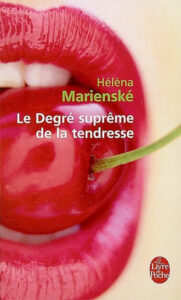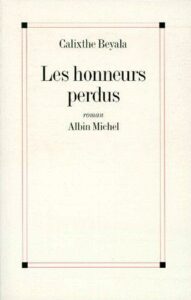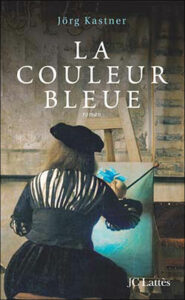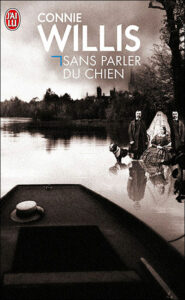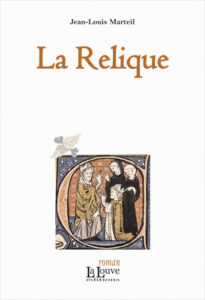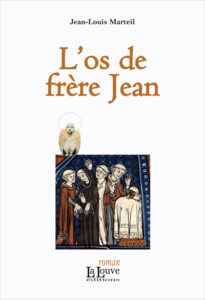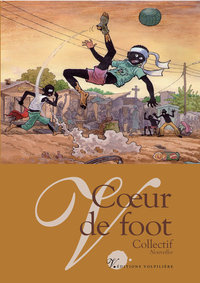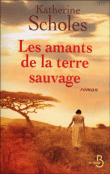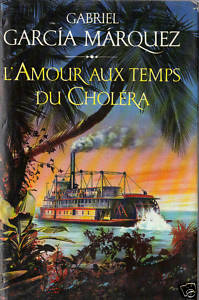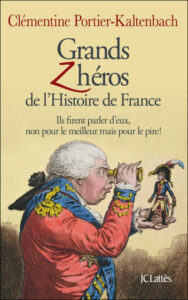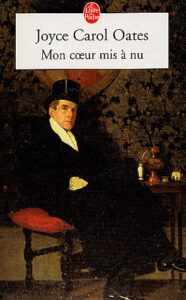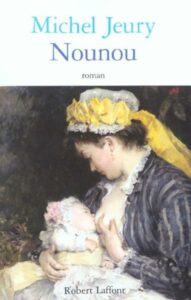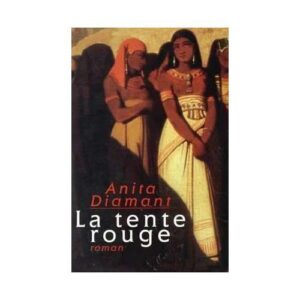Roman de Joyce Carol Oates.
Abraham Licht est un homme entreprenant à l’orée d’un siècle dont il compte profiter. Fieffé coquin et escroc patenté, l’homme est rompu au mensonge et à la mascarade. Le domaine où il excelle ? Délester les riches et les idiots de leur fortune. Abraham Licht voit en ses enfants la projection de son ambition sans fin. Dans la famille Licht, il y a l’aîné, Thurston, un homme séduisant, la fierté de son père, mais qui se détournera de ses voies. Il y a Harwood, ombrageux et jaloux, prêt à tout pour prouver à son père sa valeur. Il y a le noir Elisha qui renie sa couleur de peau pour satisfaire les projets de son sauveur. Il y a Millicent, si fine et si jolie, la fille adorée d’Abraham, aussi rouée qu’elle est belle. Il y a Darian, petit génie musical incompris et si peu considéré. Il y a Esther, gauche et inquiète, bercée de rêves romantiques et d’idéaux humanitaires. De 1891 à la veille de la première guerre mondiale, le patriarche envoie sa progéniture à travers le pays. Il la perd, la retrouve, la renie et la maudit.
« S’il prenait à un homme ambitieux l’envie de révolutionner, d’un seul coup, l’univers de la pensée humaine, l’occasion est là, la route de la renommée immortelle s’ouvre devant lui, droite et sans embarras. Tout ce qu’il a à faire est d’écrire et de publier un tout petit livre. Le titre devrait en être simple, quelques mots ordinaires: « Mon coeur mis à nu ». Mais ce petit livre devrait être fidèle à son titre. Personne n’ose l’écrire. Personne, en admettant que quelqu’un ose, ne pourrait écrire. À chaque touche de la plume enflammée, le papier se tordrait et s’embraserait. » La citation tirée de Marginalia, d’Egdar Allan Poe, en introduction du roman, promet bien des choses. Joyce Carol Oates a osé écrire et avec maestria ! Le papier ne s’est pas enflammé, et le livre n’est pas petit… et heureusement ! Le plaisir n’en est que plus grand !
L’argent est le nerf de la guerre et une entité incontournable de ce roman. « Abraham Licht est d’abord et avant tout un capitaliste américain. […] Il ne vénère qu’une seule chose: l’argent. » (p. 124) Ses entreprises sont aussi impressionnantes que les sommes qu’il perd sur un simple revers de fortune. Expert en tractations financières, en paris sportifs, en spéculations boursières ou investissements immobiliers, Abraham Licht ne vit que pour l’argent. Ses escroqueries renvoient les malversations d’un Madoff au rang de loto paroissial. Toutes les grandes villes américaines sont rançonnées: New York, Baltimore, Washington, Philadelphie, etc. Et c’est bien un pays aussi vaste que les États-Unis qui convient aux projets démesurés d’Abraham Licht.
Génie de l’arnaque et orateur hors pair, il est aussi un expert en déguisements. Pour chaque nouvelle entreprise malhonnête, il invente pour lui ou ses enfants un nouveau personnage au passé clinquant bien que mystérieux et exotique. Abraham Licht « comme Ulysse, est l’homme aux mille tours, l’homme de la ruse, du calcul et de la duplicité. » (p. 256) Les enfants Licht sont initiés très jeunes au travestissement et à la mascarade. « Il leur donne à apprendre les grands monologues de Shakespeare, qui, selon lui, contiennent toute la sagesse naturelle du monde, en miniature. » (p. 146) Les enfants deviennent des acteurs rompus à la duplicité, capables d’endosser et d’incarner une nouvelle identité puis de l’abandonner avec autant de naturel que le simple fait de s’habiller.
Le danger est toujours là d’être démasqué, reconnu, confondu. C’est pour cela que Papa Licht a mis en place son « catéchisme » (p. 152 à 154) En trois pages, le patriarche liste des règles, des principes fondamentaux de survie et de protection. Ces règles permettent de participer au Jeu. « Père a enseigné: le Jeu ne doit jamais être joué comme s’il n’était qu’un jeu. Et le butin récolté, qu’un butin. » (p. 89) Le Jeu, c’est ce qui permet à la famille Licht de s’emparer du monde, de le revendiquer. L’enseignement d’Abraham est sans appel: « Le Jeu est ce que je dis qu’il est. » (p. 335)
Les premiers chapitres du roman semblent ne pas appartenir au même récit. On assiste au dépouillement de victimes trop crédules, aux aléas des paris hippiques, sans trouver de fil conducteur. Et soudain, tout prend forme. On comprend que ces chapitres étaient, comme aux échecs, des coups pensés à l’avance dont on observe le brillant résultat sur un plateau où ne reste qu’un vainqueur. C’est aussi ça le Jeu, et le favori Licht, même s’il essuie des défaites, reste le grand gagnant.
La famille Licht est composée de coupables qui sèment le mal dans le monde. Les fautes sont nombreuses: vols, abus de confiance, mensonges, dissimulation, luxure, colère. Il y a un peu des sept péchés capitaux dans les agissements des Licht. Le plus grand de tous est l’orgueil, l’hybris des Grecs antiques : tout est démesure pour Abraham Licht et certains de ses enfants. Le monde n’a pas de frontières assez reculées ni de barrières assez infranchissables. L’orgueil des Licht est tel qu’il se rit de la mort. Thurston, Harwood, Elisha disparaissent du monde et y reviennent, sous d’autres formes, se jouant des lois de l’univers, avec une désinvolture bravache et dangereuse.
Il y a faute, et il y a Faute. La faute de l’inceste ou celle de l’adultère sont commises, mais elles ne sont pas graves dans le sens biblique, elles sont graves dans le sens d’Abraham Licht. Quand ses enfants le déçoivent, la punition est sans appel : ils sont reniés, oubliés, bannis de la famille et de la mémoire. Et pour réparer la Faute, l’offense qui lui a été faite, Abraham Licht envisage simplement de concevoir de nouveaux héritiers, qu’il modèlera davantage à son image.
Abraham Licht est le Père. Seigneur en sa demeure et sur ses héritiers, il a fait siens certains passages de la Bible dont il se moque cependant avec mépris. « Et Dieu vit que cela était bon » ou « Croissez et multipliez-vous » : tout est Genèse pour Licht et par Licht. Ses enfants sont comme issus de son sein propre. Si Abraham Licht est un homme qui cherche en toute femme une Vénus Aphrodite, s’il est un homme passionné de belles personnes, il n’arrive à garder l’affection et la fidélité d’aucune. Les enfants Licht n’ont pas de mères: elles sont mortes, enfuies, dissoutes dans les brumes d’un passé nébuleux. Abraham est père et mère. Les héritiers courent après l’affection de leur géniteur, avec la terreur de le voir disparaître. Et Abraham Licht est un père anxieux et surprotecteur: « [il] se tourmentait […] qu’une catastrophe puisse arriver à l’un ou l’autre de ses enfants. » (p. 171)
Abraham Licht a installé sa famille dans l’ancienne église des Nazaréens évangéliques, à Old Muirkirk, une terre sauvage dans la vallée de Chautauqua, cernée de marais. L’environnement semble fermé au reste de l’univers et à la marche du monde. « Les marais ne changent jamais, […] ils étaient là au commencement du monde et seront là à sa fin. » (p. 293) Les lieux sont inquiétants, propices aux légendes et aux rencontres funèbres. La vieille femme aux longs cheveux blancs est un présage funeste et le fruit noir et sucré est de ceux qu’il ne faut pas croquer. Old Muirkirk génére ses propres histoires et alimente les mystères : « Tant d’histoires couraient sur Abraham Licht, tant de récits fantaisistes sur ses femmes, ses enfants, sa profession… « (p. 115) Et Abraham Licht laisse dire: plus les gens parlent, plus ils inventent et moins ils en savent.
Dans ce roman, l’histoire se moque de l’Histoire. Mon coeur mis à nu, ce sont les mémoires d’Abraham Licht, « deux mille pages de mémoires, […], le travail de soixante ans et l’oeuvre de sa vie. » (p. 758) Abraham est un personnage d’envergure et sa vie est grandiose. En comparaison, les agissements des personnages réels qui traversent le récit paraissent bien ridicules, bien vains en regard des machinations perfectionnées du patriarche. Henry Ford ou Theodore Roosevelt sont des hommes dont l’Histoire a retenu le nom et les oeuvres, mais qui n’arrivent pas à la cheville, et encore moins au panache, d’Abraham Licht !
Le roman est fleuve, mécanique implacable qui entraîne le lecteur dans un monde de délicieuses duperies. Qu’il est bon de voir les pigeons se faire plumer ! L’écriture de Joyce Carol Oates est fine, incisive, elle dévoile avec une précision chirurgicale les purulences d’un monde dont les plus rusés savent tirer profit. Roman à lire, à lire !